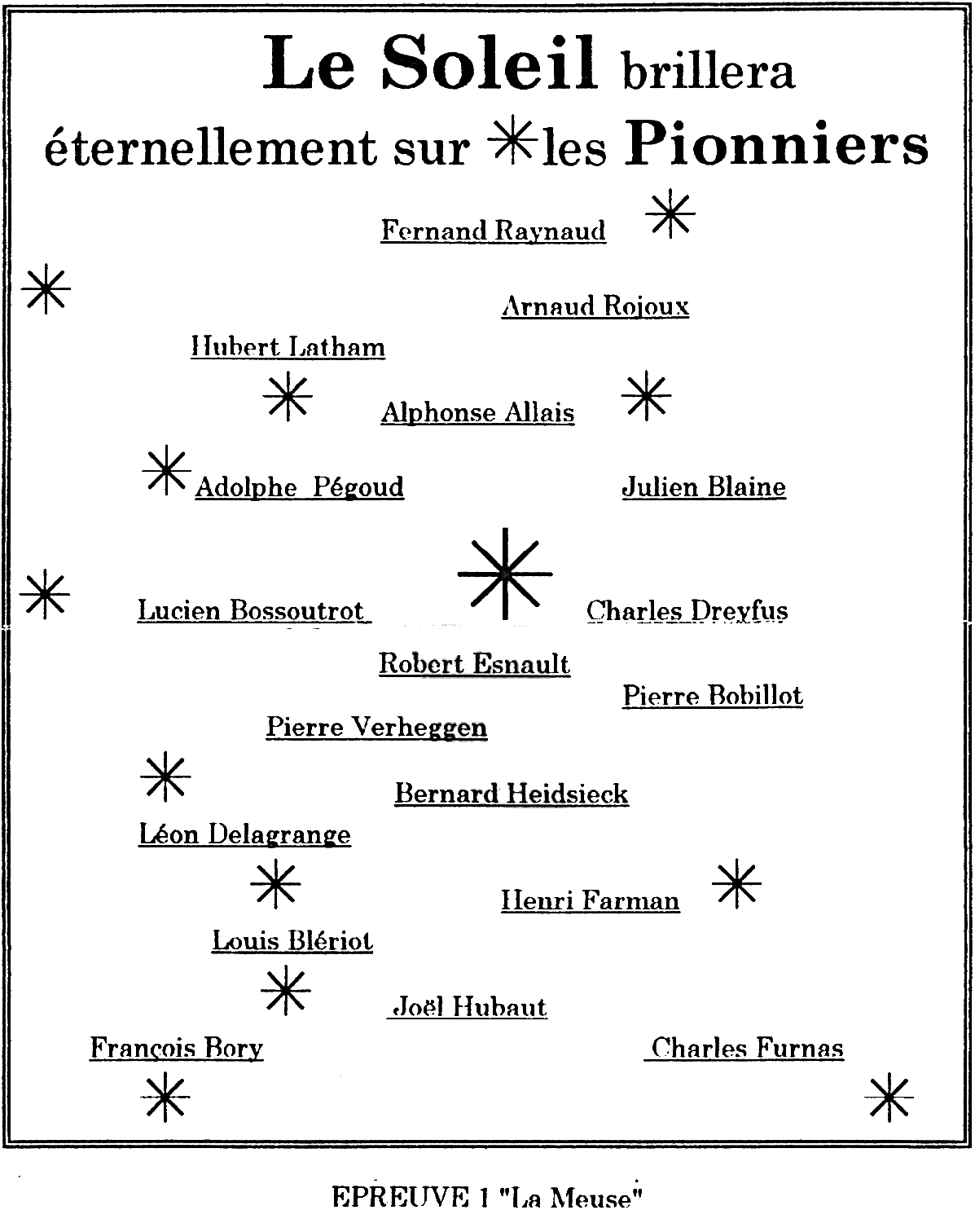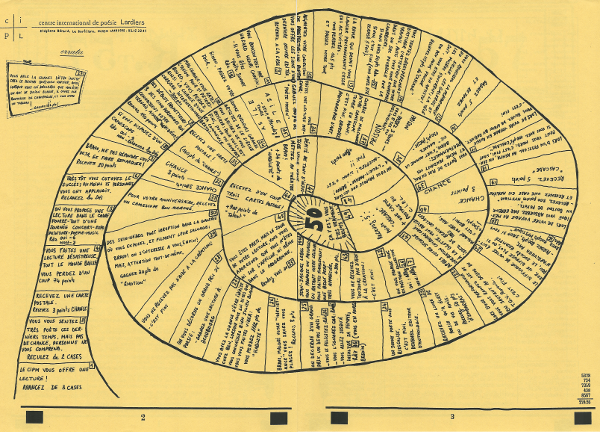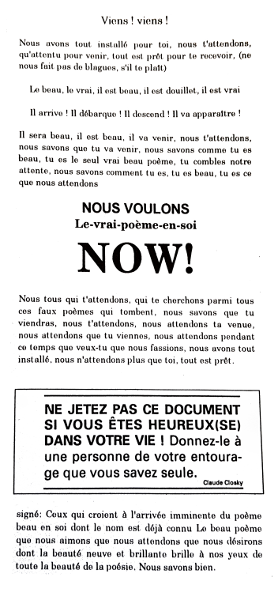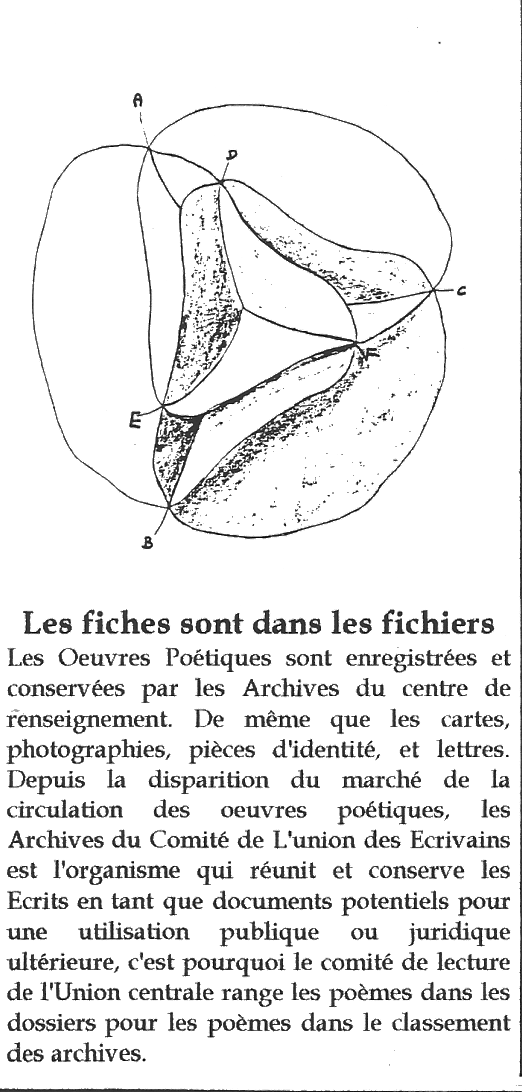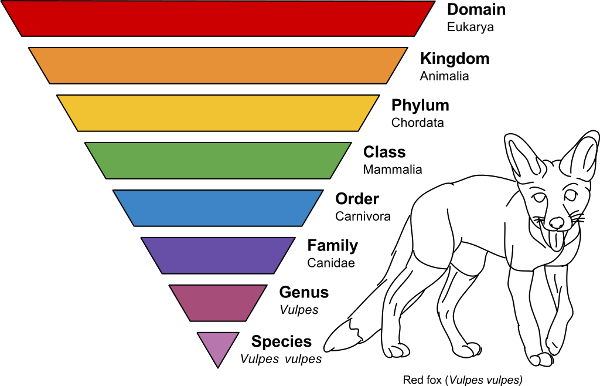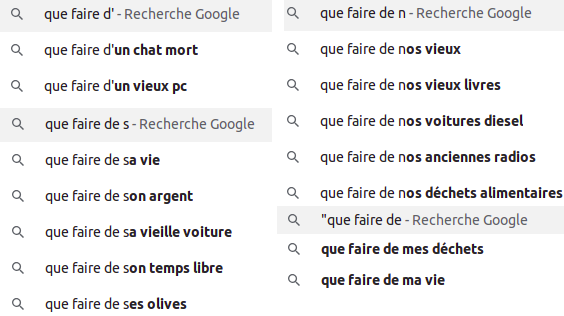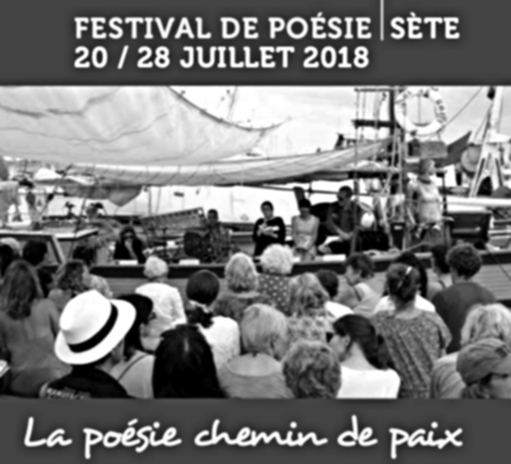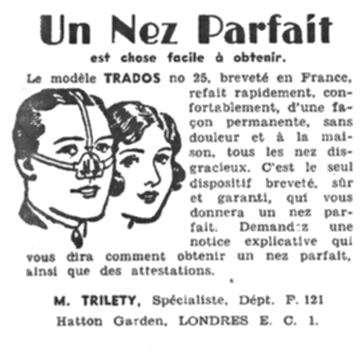« Pas spécialement poétique »
Nathalie Quintane, Christophe Tarkos
et la dé-spécialisation de la poésie (1992 - 2019)
Lire un résumé
Introduction générale
- le liturge (et sa gamme non-apophantique
: prière, ordre, menace) ; - le clerc (et son service des textes : glose, commentaire) ;
- le poète archaïque, véhicule d’une parole sans auteur (ni sujet de la compétence, ni sujet de la connaissance, mais fonctionnaire d’un texte qui ne lui appartient pas).
- Le poète contemporain ne peut jamais paraître qu’en costume de poète.
- Ce costume est nécessairement tissé d’autres habits sociaux.
- radicalisée : le poète n’est qu’un support désincarné, une tringle d’exposition ou un mannequin d’essai des costumes sociaux ;
- et atténuée, dans une respécification du rôle du poète empruntant au schème archaïque : le poète, faisant corps avec le costume de l’authentique penseur, est porteur ou véhicule d’un message essentiel à la communauté.
- ce que Quintane a appelé, au dos de Chaussure, la poésie « pas spécialement poétique » – de celle « qui ne se force » ni à en être, ni à ne pas en être (on n’est jamais poète : on joue à l’être) ;
- ce que Jean-Marie Gleize a appelé la
« postpoésie » – mais encore faut-il rappeler la valeur singulière de ce post : il désigne le moment où, une fois le terme admis ou rejeté, reste« ce qu’on peut continuer d’appeler “poésie”, si on veut » .
- En un sens, Tarkos est, s’il en est, un poète-qui-cherche-à-l’être ; il adhère à son objet (la poésie ou autre), l’embrasse dans un grand oui initial
, semble célébrer la complexité cosmique des objets les plus simples . - Quintane, elle, n’assume fonctionnairement ni missionnairement l’étiquette de « poète », mais s’en affuble tactiquement dans divers contextes où le terme est susceptible de surprendre, de jouer la diagonale, de déplacer les lignes. On peut affirmer que pour elle, tout poète qui « cherche » – à-l’être ou à-ne-pas-l’être – appartient au domaine de la poésie qui se force
.
- l’usage constituant prime le sens institué (les coups redéfinissent les limites du game) ;
- les vouloirs/pouvoirs-dire dépendent des vouloirs/pouvoirs-ouïr (les mouvements sont relatifs aux autres mouvements, sur et autour des tables de jeu) ;
- les valeurs lexicales dépendent de l’état des mises et des tactiques en cours plus que d’un intangible et disponible trésor de la langue ;
- le courant de la langue navigue parmi les tables, traverse sans les transcender les différents genres, jeux, corpus, « registres » où le sens s’est fixé dans une règle.
- Vous n’auriez pas une question plus petite ?
- le caractère procéduriel d’un tirage au clair, de la position d’une question, d’un dégrossissement de ce que Quintane appellerait un
« embarras de pensée »
et
- le caractère processuel d’une parole impromptue et cursive, qui se cherche et s’explore ex tempore, visant à faire discours du cours sans reconduire celui-là aux fers grammaticaux et à la cellule lexicale du sens,
1. lire dans le détail, attentivement, extensivement
2. parcourir rapidement, survoler légèrement. L’anglais est ici du latin tardif – per-usare : faire un usage traversant. Péruser un texte, c’est faire son deuil de la bonne focale et d’un accès à la totalité, et décider de la primauté de l’usage ordinaire sur l’idéal de la lecture cléricale informant l’
1. La question-si
Introduction : La question-de-la-poésie
Qu’en serait-il d’une question qui n’impliquerait pas de réponse ? Elle ne diviserait pas le monde en deux : la demande, la réponse ; elle se tiendrait d’emblée en leur milieu, éclatante de leur contradiction, et cependant fermée à la discontinuité que la contradiction engendre. Pareille question ne saurait pas ce qu’elle est, car niant sa nature et se niant elle-même, elle se contenterait justement d’être ce qu’elle est.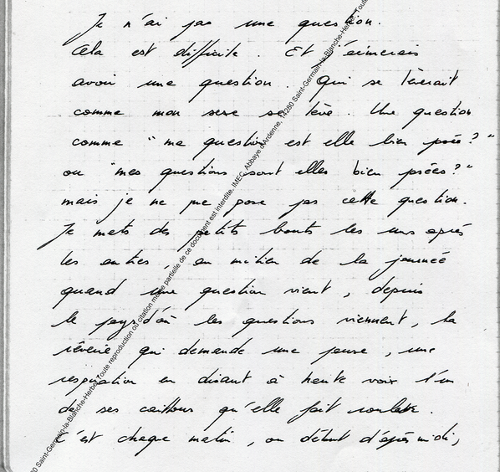 Page d’un carnet de Tarkos (« organisation II », IMEC, boîte TRK3, ca. 1989) où celui-ci écrit : « Je n’ai pas une question. Cela est difficile. Et j’aimerais avoir une question. Qui se lèverait comme mon sexe se lève. Une question comme “ma question est-elle bien posée ?” ou “mes questions sont-elles bien posées ?” mais je ne me pose pas cette question. Je mets des petits bouts les uns après les autres, au milieu de la journée quand une question vient, depuis le pays d’où les questions viennent, la rêverie qui demande une pause, une respiration en disant à haute voix l’un de ses cailloux qu’elle fait rouler. […] Sans une question, le problème est d’agencer les idées, les mots, les constructions logiques, les jalons de la quête. Vous me direz, vivons sans la quête. Oui oui bien sûr… »
Page d’un carnet de Tarkos (« organisation II », IMEC, boîte TRK3, ca. 1989) où celui-ci écrit : « Je n’ai pas une question. Cela est difficile. Et j’aimerais avoir une question. Qui se lèverait comme mon sexe se lève. Une question comme “ma question est-elle bien posée ?” ou “mes questions sont-elles bien posées ?” mais je ne me pose pas cette question. Je mets des petits bouts les uns après les autres, au milieu de la journée quand une question vient, depuis le pays d’où les questions viennent, la rêverie qui demande une pause, une respiration en disant à haute voix l’un de ses cailloux qu’elle fait rouler. […] Sans une question, le problème est d’agencer les idées, les mots, les constructions logiques, les jalons de la quête. Vous me direz, vivons sans la quête. Oui oui bien sûr… »- Les définitions selon l’espèce donnent une idée de ce que peut être une poésie
« spécialement poétique » : celle-ci appartient à un champ technique et culturel (artistique, plus précisément musical, mais aussi linguistique, mais encore épistémologique ou mnémotechnique), et tient le plus souvent d’une technique et culture de soi (lifestyle, hygiène, disposition mentale, état psychique, ascèse, exercice spirituel ou anamnestique). Elle combine volupté aristocratique (le plaisir à…, le sans prix) et condition tragique du révolutionnaire (aliénation, damnation, capacité, contrariée par le monde, à engendrer des mondes). - Les définitions selon le propre sont à la fois d’une grande diversité et d’une grande monotonie : assertoriques et suggestives, proclamatoires et propitiatoires, ce sont des définitions-de-la-poésie en costume de poète, qui semblent imiter le geste instituteur, la frappe sèche, le hiératisme de leur héros. Comme s’il fallait, en jouant à son tour au vieux jeu de la définition, participer du tapage qui fait bourdonner ce terme central et creux, « poésie », depuis le fond des âges, la cime de l’âme ou l’harmonie des sphères.
« n’est pas une solution » mais un problème (Philippe Castellin) ;
« n’est pas belle » mais « horrible »,
« n’est rien de charmant » mais « d’abominable » (Raoul Hausmann) ;
« n’est pas une chose rassurante » mais « une aventure colossale » (Eugène Guillevic) ;
 Pour qui n’a ni personnalité ni émotions, l’aventure s’arrête ici. (Capture d’écran du jeu télévisé de survie libre-et-non-faussée « Koh-Lanta »)
Pour qui n’a ni personnalité ni émotions, l’aventure s’arrête ici. (Capture d’écran du jeu télévisé de survie libre-et-non-faussée « Koh-Lanta »)« n’est pas une forme de lâcheté de l’émotion, mais une évasion de l’émotion ; n’est pas l’expression de la personnalité, mais une évasion de la personnalité (mais, bien entendu, seuls ceux qui ont de la personnalité et des émotions savent ce que cela signifie vouloir échapper à ces choses) » (T. S. Eliot)
se méfier de ce que
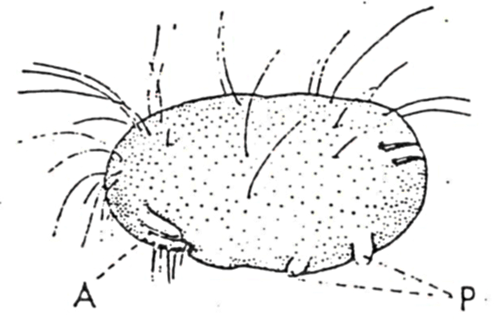 « Pourtant, cachée à l’intérieur de ce terrible trésor de la langue linnéenne, se trouve en secret, rayonnante, la patate douce. » (
« Pourtant, cachée à l’intérieur de ce terrible trésor de la langue linnéenne, se trouve en secret, rayonnante, la patate douce. » (- quels sont les traits spécifiques de la poésie comme « psychologie » (au sens restreint de Quintane : communauté de souci, champ d’inscription et milieu d’adresse) ? 1.1
- quel est l’objet spécifique de la poésie comme mode d’appréhension et de conception ? 1.2
- quels sont les caractères spécifiques de la poésie comme pratique, à la fois par rapport à la littérature en général, et par rapport à la pratique ordinaire du langage ? 1.3
1.1. R.R., un passage en revue
Je suis toujours un peu étonnée par cette idée que « nous n’aurions pas parlé ». Pour moi, les revues valent préfaces (ou postfaces). […] Alors voilà : il y a bien des revues mais on n’arrive pas à faire revue, on n’arrive pas à faire groupe, on n’arrive pas à faire tract, à faire formule, à faire déclaration collective et même pas déclaration individuelle. Bref : on est dans la merde.Introduction : Diviser la question-de
- d’un côté, une micrologie du champ – un champ vaste mais homogène, constant dans son souci (notre question, celle de la poésie) ;
- de l’autre, la macrologie suscitée par le sentiment d’un kairos – discours double, en France, à la toute fin du 20e siècle : protagonique (la situation actuelle et nos tâches) et apologétique (vive la crise).
- fondamentale (la question dont la poésie procède)
- mais appliquée (la question à laquelle la poésie procède, qu’elle « processe »),
- pas nettement transitive (≈ la question qui produit la poésie),
- ni tout à fait appositive (≠ la notion de poésie)
- ni tout à fait oblique (≠ l’envie de poésie),
- d’apparence génitive, mais d’un génitif trouble :
- propriété : la question propre de la poésie ;
- possession : la question hantée par la poésie ;
- dépendance : la question placée sous le rapport ou la tutelle de la poésie ;
- pertinence : la question adaptée à la poésie ;
- congruence : la question ajustée à la poésie.
- le Rätsel (l’énigme posée par la poésie, sa colle),
- le Fall (le cas fait de la poésie, et de là peut-être sa cause à plaider)
- la Frage (l’enjeu du procès de la poésie, le cadre élargi du litige, la question posée par son cas),
- la Fragestellung (la pose de cette question, son effort de formulation),
- et maximalement la Sache (la grande affaire, le dont-il-est-question, l’anti-quelconque, le quod-non-libet, le tout-sauf-tout-ce-qu’on-veut
. « C’est comme Dieu »).
- Rätsel par souci de la poésie,
- Fall par procès ou cause de la poésie,
- Frage par question de la poésie,
- et Fragestellung par l’expression pose de la question, plutôt que par celle, traditionnelle, de position de la question, à la fois pour éviter la confusion avec le sens plus général (position théorique ou philosophique dans un débat), et pour profiter d’une autre polysémie :
- La pose de la question-de-la-poésie comme travail de parqueterie, de carrelage, de revêtement (constitution d’un sol praticable par nivellement et recouvrement de l’ancien) ;
- La pose de la question-de-la-poésie comme placement d’une pièce sur un plateau de jeu (performance éristique, agonistique du premier coup dans le game) ;
- La pose de la question-de-la-poésie comme installation d’un garde, d’une sentinelle, d’un soldat en faction (dispositif de défense de la poésie contre ses abuseurs ou ses mauvais chérisseurs) ;
- La pose de la question-de-la-poésie comme adoption d’une attitude figée dans le but de suggérer ou d’afficher une position plus fondamentale (l’exercice qui consiste à poser se posant la question-de-la-poésie étant devenu commun au cours du 20e siècle).
- On traduira généralement Sache, après Quintane, par « grande affaire ».
- poésie-vocable (à la fois terme de référence et tutelle patronnante) ;
- poésie-Idée (invariant précédant et contraignant tout artefact) ;
- poésie-pratique (activité transformatrice de son sujet, non nécessairement orientée vers la production de « poèmes ») ;
- poésie-milieu (sociotope, champ, où s’écrit, s’écoute, se lit publiquement, de la poésie, et se pose sa question) ;
- poésie-patrimoine (mille-feuille des manifestations historiques de poésie-Idée, poésie-pratique, poésie-genre, etc.) ;
- poésie-genre (catégorie littéraire reconstituée d’après poésie-patrimoine, et constitutive d’une inscription au présent dans cette classe).
[…] Ça continue. Ça va continuer, ce n’est pas impossible. Il y a quelque chose qui va, qui va et qui va et qui dure et qui dure. Quelque chose n’arrête pas de continuer, qui va aller encore et qui dure. Quelque chose qui peut continuer comme ça. […] Cela ne veut pas s’arrêter. Cela continue. C’est incroyable. Ça va durer. Ça peut durer encore comme ça.
- devant l’impureté ou la saturation de ses « utilisations », lâcher le terme, s’en émanciper ;
- en faire une autre « utilisation », participer au jeu de la poésie, prendre part à l’inflation des discours sur la poésie : s’en faire utilisateur.
- ils ont en tête un corpus de phrases où poésie-vocable est joué en sujet ou en prédicat essentiels (la poésie est… ; faire de la poésie c’est…) ;
- ils ont conscience de l’instrumentation de poésie-Idée à des fins de maintien de l’ordre (ceci est de la poésie ; cela n’en est pas) ;
- ils observent l’extension presque maximale de poésie-pratique sous l’adjectif et le substantif élargis de poétique et de poésie (des films poétiques ; la poésie du quotidien) ;
- ils ont une connaissance assez précise de poésie-patrimoine ;
- et notamment de cette partie de poésie-patrimoine qui n’a cessé de faire de la poésie contre les règles instituées par la catégorie poésie-genre ;
- de poésie-milieu ils connaissent les codes et les tons, sont familiers du microcosme et des micrologies.
- la poésie est leur outil ou leur véhicule (la poésie n’est pas leur fin) ;
- leur rapport à la poésie est instrumental, transitif (opératoire et manipulatoire, pratique et expérimental) ;
- leur position dans le champ est moyenne : ni de maîtrise (autorité disciplinaire, virtuosité générale) ni de servitude (rapport aliéné d’usager ou de consommateur), mais d’impéritie relative (ou de relative habileté) ;
- leur rapport à la poésie est
« empirique, ponctuel » , voire nonchalant : ils n’habitent pas en poésie, ils y circulent, se ménagent la possibilité d’en sortir, d’y rentrer, de ne faire qu’y passer.
- ils en profitent (ont autre chose en vue) ;
- ils sont infidèles au terme, insincères dans leur relation à la chose ;
- la poésie, ils cherchent à la refaire ou à nous refaire d’elle ;
- la célébration béate de la poésie, fondée sur poésie-Idée, qui ne doute pas de son nom ;
- la célébration critique de la poésie, qui récuse le terme pour poursuivre l’objet.
- d’un côté, le pôle versus d’une poursuite (de l’œuvre des avant-gardes historiques) ou d’une lutte progressiste (parfois dite « formaliste », contre un oubli des formes devant l’évidence de l’expression, voire contre un oubli du pulsionnel devant l’évidence du sentimental) : « ça va continuer » contre ou en dépit de soi-même ;
- d’un autre, le pôle rursus d’une poésie fidèle à une idée immémoriale d’elle-même – inspirée, lyrique, suggestive jusqu’à l’effacement : « ça va continuer comme ça », avec et à l’aide de soi-même.
1.1.1. Une micrologie pour un microcosme
[L]es fils ou les pères mineurs, les filles ou les mères mineures, ont rempli quelques cahiers pas destinés en mélangeant un peu tout : bribes de Grands Écrivains, journalisme, poésie (etc.). Autrement dit, le travail est déjà fait.1.1.1.1. Une micrologie…
Questions : quels héritages révisent aujourd’hui vos revues ? Quels effectifs inspectent-elles ? De quel spectacle sont-elles la scène improvisée ? […] À quoi servent, chers amis, vos revues ?
- En page 1, des textes proclamatoires, des annonces formelles dont le terme clé est souvent « poésie ». Leur corps est plus grand que celui de la plupart des autres textes ; leur centralité rappelle celle de l’éditorial dans un quotidien ; le caractère péremptoire de leurs propositions préfigure les « manifestes » de Tarkos
. - À droite, sur cette même page, un authentique manifeste, signé par un « groupe » sobrement nommé d’après le numéro de la revue (« manifeste du groupe 52 », « manifeste du groupe 53 », etc.) et dont le pronom de prédilection est le nous.
- À gauche, des annonces, compte-rendus, slogans, publicités, dont la facticité pour le lecteur va du patent à l’incertain.
- En page 2, des pastiches, dont celui qui figure presque invariablement en colonne de gauche dans la rubrique
« le françois-xavier » : un mirliton, plus ou moins lyrique, moquant la poésie « poétique », habitée ou résidentielle, mais en tout cas chez elle en poésie. À la lecture du prénom-titre, on peut supposer que celle-ci est aussi, pour les R.R.ristes, une poésie de classe. - Distribuées sur l’ensemble des pages : des fiches, cartes, séries d’indications techniques plus ou moins cryptiques, avec récurrence de mindfucks genre cyclone réflexif (« bibliographie universelle des bibliographies universelles et des catalogues et bibliographies », « tableau des pays producteurs de tableaux ») ou déluge de données sous forme de diagrammes, planches, listes (température de « confision » – le devenir confit ? – des différentes substances, croquis des différents étaux et pinces, « formes d’automobiles » etc.). L’expression de Tarkos selon laquelle R.R. est son
« atelier » , prend tout son sens quand on compare ces pages avec certains de ses carnets de travail. - Des brèves au sujet d’une actualité de la poésie, du livre, de la littérature, qui souvent prennent leur poiesis au mot, faisant de faire la vérité d’une pratique spécifique : comme « le boulanger de boulange » « pétrit », « l’écrivain du Livre » « écrit », la nuit durant ; au matin, les petits poëmes et les petits pains seront prêts à la consommation
. Le personnage du poète-artisan y apparaît soit comme un symptôme de la division du travail et d’un domaine littéraire devenu recoin, soit comme la figure d’un humble parmi les humbles . - Des petites annonces ou courriers des lecteurs, saturés de salutations
et d’adresses procédurales (réclamations, remerciements, avis de recherche). - De très sobres et parfois authentiques faire-parts (décès, naissances, mariages).
- Des actualités du « Milieu », plus ou moins indiscrètes, impliquant des poètes et artistes qu’on pourrait dire alliés à l’échelle du champ : Pierre Le Pillouër, Arnaud Labelle-Rojoux, John Giorno, Jean-Jacques Lebel, « Bernard H. » (pour Bernard Heidsieck), entre autres.
- Des exercices, conseils pratiques, auxquels on peut associer certains textes en apparence esseulés, sans rapport évident avec le reste (par exemple, dans R.R. 53, la liturgie mystérieuse dont l’introït est exclusivement composé des noms de joueurs de l’AS Nancy-Lorraine, saison 1991‑1992).
- Des jeux et leurs solutions ; à la fois reflet du ludisme de la revue et de la passion de Tarkos pour le go, et possible dérision de la figure, consacrée par l’Oulipo, du poète-joueur
.
1.1.1.2. …pour un microcosme
1.1.2. Célébration, récusation : un jeu sur le code poésie
Ouvre la moindre page, ouvre n’importe quelle page. Ce que tu perçois, ce que tu lis, qui s’accumule, qui prend place, étalé, qui veut sortir sous la forme d’une poésie rêvée, accroché à l’Idéal poétique. Et qui tombe. Tombe des mains. Vois, le résultat. C’est insupportable d’engluement. C’est de la poisse.1.1.2.1. La poésie est admissible, d’ailleurs…
- ce sont des propositions sèchement définitionnelles (elles disent le quoi de la poésie, pas son comment) dont la valeur d’usage est signalétique, indicative, et la valeur d’échange nulle (« poésie » y est un terme absolu, non négociable) ;
- ce sont des annonces formelles, des énoncés péremptoires dont l’efficace est autoritaire (c’est celle d’une intimidation de la capacité de juger) ;
- ce sont des protestations de non-dupeté (dont le vocabulaire est celui de la mise au point experte et de l’authenticité), des inscriptions pour targes, des poses héraldiques de la question-de-la-poésie : elles ont l’esseulement des figures blasonnées, mises en exergue, exceptées.
- « La poésie [est quelque chose. Elle] est inadmissible [i.e. : elle est extérieure, exceptée]. D’ailleurs elle n’existe pas [i.e. : elle ne peut se manifester que comme radicale nouveauté ; elle fait toujours effraction dans son nom]. » ;
- « La poésie [est quelque chose. Elle] n’est pas une solution [à quelque problème que ce soit ; i.e. : elle est une question sans cesse repoussée, un problème spéculatif, pas un secours pratique] ».
- fixité de la référence (« c’est fait » ; le « terme », véritable cul-de-sac du sens ; sa définition nette, cadre
« reposant de la pensée » ), - définition au service d’une intelligibilité partiellement indexée sur la marchandise : que la poésie existe se vérifie dans le fait qu’on peut la « vendre », la « donner », la « posséder »),
- naturalisme du sens analogue à celui de l’apologétique du marché-qui-profite-à-tous (« L’accord [sur le sens de « poésie »] est bénéfique, est consensuel. »),
- double régime réifiant de la circulation du terme (comme objet – la poésie – et comme substance – de la poésie),
- par conséquent, infaillibilité de l’usage bien régi (« il est impossible de se tromper »),
- surplace ontologique (« la poésie est », c’est tout ce qu’on peut en dire) et triomphe du dicible (au point que l’énoncé apophantique
est maintenu comme phrase autonome, avec sa capitale, même après une virgule : « Maintenant, La poésie existe. »).
1.1.2.2. Non-merde à la poésie
1.1.3. Un exercice de poésie
Soit une leçon en forme de blague ; soit une leçon en forme de constat.1.1.3.1. « Moins insolent qu’incongru »
- Tenir R.R. pour un monstre d’irrévérence est historiquement congruent : R.R. s’adresse au champ + R.R. y est moqueuse = R.R. est plein champ, full on (pépèrement posée dans le champ). On sur-détermine peut-être l’assiduité à la question-de-la-poésie en présence ou en adhésion au souci-de. On sous-détermine peut-être l’offensivité du sarcasme en connivence taquine avec le milieu-de.
- On peut aussi dire : R.R. s’adresse au champ + R.R. le ringardise = R.R. est hors champ (est op-posée au champ). On sur-détermine peut-être l’adresse désinvolte et oblique en attaque intrépide et frontale.
- On peut encore dire : R.R. s’adresse au champ + R.R. est littérale = R.R. est simplement mais, pour ainsi dire, pleinement incongrue (R.R. est ap-posée au champ). On s’autorise à lâcher l’affaire des raisons, pour se concentrer sur celle des effets. Ce qu’R.R. est, en poésie, c’est strictement ce qu’R.R. fait à la poésie.
1.1.3.2. Élèves moyens
- le jeu assonantique sur la double valeur phonétique du
« g » ([ʒ] et [g]) dans « Turpitudes et couinements » – sorte de pastiche de poème mélopoétique– et « Vois cette gueule » ; - l’alternance [v]/[s] dans
« Va pour un sceau de sang » et « Le monde magique » (dont on peut dater la première version de 1998), l’insistance sur [tr] dans « Tragédie » et« La production et productive… » ; - l’attention steinienne aux questions méréologiques et taxonomiques, aux critères d’identité et de différence qui informent Chaussures, de nombreuses Caisses, et qu’on trouve dans R.R. sous une forme certes plus anecdotique (ne pas confondre « le taquet et la taute » in R.R. 60, faire la « différence entre une chemise et un T(ee)-shirt » in R.R. 52) ;
- le destin en trois lignes, l’heuristique du ratage, communs à certaines Remarques, certaines Caisses (« Heureusement qu’il est mort… » p. 16, « Soit soi sur une énorme boule… » p. 48) et certains avis de décès dans R.R. ; le motif de la francité (« Chanter la terre, chanter la France… » in R.R. 58,
« La France possède de grands artistes et de grands poètes » , et « Je suis un poète français… » dans) ; - le motif de l’argent (« L’argent est bien à penser » in R.R. 62 préfigure certaines propositions du long texte L’argent) ;
- l’image de la tige (« Le taquet et la taute » in R.R. 60, « Le proéminent au-dessus de la cage à trou… », C, p. 36 et « Un homme pantin, un homme en bois… », A, p. 187).
Pourquoi nous nous sommes écrit ?
Le lien de l’écrit et de l’être
Quand nous nous sommes écrit, l’écrit était en accord avec l’être, de même que l’écrit s’accordait à l’avoir, sans être, sans réfléchi. L’écrit est réfléchi, l’écrit réfléchi est sans objet, n’est pas l’objet de l’écriture, car aucun objet ne précède l’écriture. […]
- le cliché d’une littérature confessionnelle substituant le réflexif au transitif (« se dire », « s’écrire », « se raconter ») ;
- le lieu commun de l’écrire intransitif
, d’inspiration blanche d’un côté (Blanchot ), sensualiste de l’autre (Barthes ), souvent évoqué par Quintane ; - celui d’une vérité d’accord de « l’écrit » et de « l’être » débarrassés de l’objet parasite – cliché d’origine heideggerienne, particulièrement puissante en domaine poétique français
.
- qui ne se paye pas des « mots » invariants qui font les questions molaires,
- saturée d’information littéraire,
- moins
« plate » ou « blanche » qu’insensible aux reliefs et couleurs de la poétique des figures, - « schizoïde » si l’on entend par là que, redoublée plutôt que « dédoublée », elle s’offre et se refuse aux lectures issues de la partition rhétorique entre parodique et fervent.
- dans le brouillard des poses de la-question-de à laquelle il ne s’est jamais agi de répondre,
- dans les déclarations de non-dupeté qui font le seing unique des célébrants et récusants au sein de la « psychologie poétique »,
- dans l’idios cosmos affermi par l’irréductibilité affective comme par l’impénétrabilité d’une langue insoumise aux impératifs de « civilité ».
Transition : « Quand même ça, ça plutôt que rien »
La marge est patrimoniale, en poésie.1.2. Remarques, Chaussure. L’objet des malentendus
Introduction : Deux premiers-livres
On ne peut plus écrire le mot poésie – trop de malentendus et trop de malentendants. Cela signifie concrètement que vous ne pouvez pas être vraiment reconnu dans ce que vous faites parce que ce que vous faites n’est pas reconnaissable.Quelquefois, on cherche des yeux son appareil, quand un téléphone sonne à la télévision. (R, 25)
Plus le café est moulu longtemps, plus il s’écroule lentement contre le couvercle du moulin. (R, 35)
Sans pull, pas de miettes accrochées aux manches. (R, 37)
Quand je bois, ma lèvre inférieure reste rêche. (R, 45)
Dans les vitrines des magasins, les chaussures ont les lacets noués. (Ch, 11)
Le mouvement des pieds quand je conduis a ceci de semblable à la marche, que je ne pense pas à surveiller mes pieds. (Ch, 19)
En traversant une voie ferrée, un talon peut se coincer dans un rail. (Ch, 19)
Les phrases n’ont en commun ni un sujet (d’énonciation, grammatical ou réel), ni un objet (d’attention, d’expérience), pas non plus une diathèse constante (actif, passif) qui marquerait un rapport unique entre les deux. Leur ressemblance tient à une simplicité descriptive et au caractère situationnel de l’attention dont elles naissent. Mais la « rédaction rasée de près » est aussi un mouvement logique : mention de circonstances qui rappellent le cadre empirique d’observations scientifiques, suivie d’une sorte de pointe, mais une pointe rase, infra-suggestive, proto-aphoristique. L’unité de chacun des livres est donc moins phrastique que propositionnelle : l’ensemble s’appréhende moins comme un texte – appelant une lecture linéaire, codicielle – que comme un corpus de propositions de même type – appelant une lecture baladeuse, indicielle.
1.2.1. Les lecteurs malentendants
Je n’aime pas les lecteurs-sparadraps qui vous collent sans distance et dont vous ne pouvez vous dépatouiller.1.2.1.1. Trois fétichismes
- Une fois, un lecteur est venu violemment m’alpaguer : alors, vous avez lâché ? à présent vous parlez de Jeanne d’Arc, de Saint-Tropez, ou que sais-je. Il voulait dire que j’avais lâché les choses, les tomates, les maisons, les avions ; ou alors que j’avais lâché la chose, la chose importante, les choses (Ding) étant peut-être la chose (Sache) même, la grande affaire, voilà peut-être ce qu’il voulait dire.
- D’une part, la tomate se suffisait à elle-même ; d’autre part, elle ne se suffisait pas à elle-même. Cela, c’était ce que ce lecteur des Remarques s’était précipité me sous-entendre. Tendu, dense – exactement comme un poème –, […] il s’était approché tout près pour me dire que, passant à autre chose, j’avais franchi le mur, la ligne blanche ; de là où il était, où ils étaient tous, les vrais lecteurs de Remarques, ils me voyaient m’éloigner, irrémédiablement.
- Confiante dans la perspicacité et la rigueur du lecteur-trice futur-e, j’alignai alors deux cent cinquante pages de Chaussure, orientées cependant par une quatrième de couverture perso : Chaussure parle vraiment de chaussure. Je vis alors arriver, après une lecture, un monsieur tout rouge, dense et tendu, exactement comme un poème. Il me demanda aussitôt combien je possédais de paires de chaussures. C’était un fétichiste du pied.
- Un lecteur du parti des Dinge, soucieux qu’on leur demeure fidèle (qu’on ne les « lâche » pas), et qu’on pourrait dire pongien : attention aux choses pour elles-mêmes, leur perfection muette, leur matérialité et la littéralité de leur enseignement. La dévotion exclusive de ce lecteur lui fait plus loin considérer Saint-Tropez et Jeanne d’Arc comme des « mythologies » vulgaires, impures, émanées du « culturel »,
« sali[es] par l’idéologie » . - Un « vrai lecteur » des Remarques – l’expression, nous le verrons, renvoie au lectorat en phase avec la présentation de l’éditeur en quatrième de couverture –, lecteur pour qui l’objet « ne se suffit pas », et qui cherche un accès au mystère de l’ordinaire derrière l’ordinaire des objets ; au vœu pongien du premier lecteur répond un vœu de profondeur qu’on peut identifier au programme d’une certaine phénoménologie : d’une immersion dans les choses mêmes – selon l’expression de Husserl –, en remonter l’essence.
- Un lecteur à la fois thématiquement motivé et libidinalement mû (par son fétichisme), et par conséquent déçu soit du faible degré d’information d’un livre qui affirmait « parle[r] de chaussure », soit de la faible efficacité d’un livre dont le titre, dans sa simplicité, promettait de convoquer l’objet du désir.
P 1 : Une soupe lyophilisée est une vraie soupe
ou de :
P 2 : Une soupe lyophilisée est une fausse soupe
laquelle est la vraie ?
- « elle est garantie » ;
- elle est authentique, régulière, normée (« elle est cuite dans les règles ») ;
- elle est prête à l’emploi (« vous n’avez plus qu’à l’ouvrir »).
1.2.1.2. Connaissance de cause et sans le savoir
pour dire.
pour appuyer ce que je suis.
il ne sait pas sur quoi s’appuyer pour dire ce qu’il est.
pour savoir qu’il est.
pour prouver.
pour s’appuyer
je ne sais pas ce sur quoi je vais bientôt m’appuyer pour dire.
pour dire que je suis.
pour savoir
- fixation « sur l’Objet »
- (qui est aussi une) fixation de cet objet
- (et) une fiduciarisation de la référence (un forçage de correspondance entre savoir sémantique et savoir encyclopédique).
1.2.2. L’objet de référence
L’objet n’attend pas dans les limbes l’ordre qui va le libérer et lui permettre de s’incarner dans une visible et bavarde objectivité ; il ne se préexiste pas à lui-même, retenu par quelque obstacle aux bords premiers de la lumière. Il existe sous les conditions positives d’un faisceau complexe de rapports.1.2.2.1. « Arrêt sur l’Objet »
- des quodlibets, des tout-ce-qu’on-veut (« seule la fantaisie donne corps provisoire à ces instruments de fiction »),
- des outils dépanneurs, sans usage ni métier de référence (« leur nature n’est rien d’autre que leur fonction »),
- des génériques impurs, chéris pour leur saillance ou leur banalité (ils « peuvent aussi bien être des trouvailles que des lieux communs, aussi bien des agglomérats inédits que des bouts surcodés, aussi bien une bizarrerie ou un accident syntaxique qu’une phrase morte qu’on exhume »),
- des modèles, mais de rien-de-spécial (ce sont des « monstres de fidélité », « fidèles à la matière hétérogène qui les remplit, fidèles à la circonstance »),
- des unités circonstancielles, transitoires, pratiques (ils sont « tassés » mais « hétérogènes », « homothétiques et agençables », complexes par « accident ») voire tactiques (« dans un fictif premier temps […] on a intérêt à se fabriquer des objets » ).
1.2.2.2. « Une seule chaussure est impossible »
Mais comment déterminer ce moment où, d’une chose informe, d’une sorte de peau étrangère vaguement fixée à la nôtre autour du pied par des bouts de ficelle (les chaussures de Robinson Crusoé), on est passé à une forme suffisamment stable pour qu’aujourd’hui encore elle soit appelée chaussure ?
Y a-t-il eu une chaussure « primitive » ?
Pour qu’une chaussure ait commencé d’exister, il fallait qu’elle puisse être reconnue, et pour cela, qu’il y en ait eu au moins une autre, avant, à laquelle on ait pu la comparer.
La première chaussure n’a pas existé. Personne ne la fabriqua.
– c’est la seconde qui désigna la première ;
aussi vont-elles par paire.
Ce qui va par paire, une fois seul, est injustifié.
Une seule chaussure est impossible.
La chaussure s’appelle chaussure,
Même quand le vent tourne
La chaussure s’appelle chaussure,
Même après un typhon,
Même avant un typhon,
La chaussure s’appelle chaussure,
Même quand jeudi passe à vendredi, et samedi,
D’heure en heure,
La chaussure s’appelle chaussure,
Même quand des confettis
Retombent
Dans un désordre imprévisible,
La chaussure s’appelle chaussure,
La chaussure s’appelle chaussure
Parce que l’eau coule, et même
Si la définition de la seconde est plus longue que la seconde,
La chaussure s’appelle chaussure,
Que les ongles poussent, que les dents tombent,
La chaussure s’appelle chaussure,
Même quand je ferme un œil
La chaussure s’appelle chaussure,
Même si mon chien ne répond plus quand je l’appelle,
La chaussure s’appelle chaussure,
Même quand un chat tousse En mangeant des herbes.
(enfant, il portait souvent une petite caliga – sandale.)
1.2.3. Ponge, Quintane : La poésie comme « recherche » et « méthode »
J’ai écrit des livres anti-printemps (des Poètes) ; du Ponge débile, c’est-à-dire encore plus désaffublé.1.2.3.1. Ding et Sache
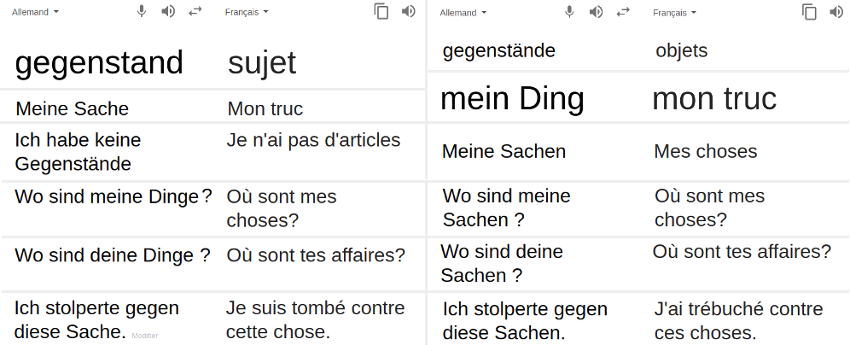 Propositions du traducteur Google Translate pour les mots « Ding » et « Sache » en contexte.
Propositions du traducteur Google Translate pour les mots « Ding » et « Sache » en contexte.
- une mission éthique : la préservation de l’humain contre l’automation quotidienne, qui correspond à la préservation du versant chéri de la dupeté ;
- une tâche métaphysique : la conquête d’un état qu’une formule de la vulgate heideggerienne en poésie française appelle une « présence au monde », opposé à la fois à « l’esprit ailleurs » et à l’occupation par les choses « sérieuses » ;
- un impératif ontologique : il s’agit de « cess[er] d’oublier » ce qui est « sans histoire », infra-culturel, pur d’arraisonnement.
- d’un côté, le voir de la vue ordinaire, qui manque la singularité de son objet (« là où, jusqu’à présent, l’on n’avait vu que de l’insignifiance ») ;
- de l’autre, le voir de la vision, poétiquement et théologiquement lesté, qui pondère le « regard », le « fixe », lui fait accéder à la dimension mystérieuse, au caché paradoxal du « plus clair de nos vies ».
- En premier lieu, sa portée commune : pour savoir, il suffit de faire (d’un « faire » manipulatoire ou opératoire, pas fabricans ni alchimiste ; d’un faire ordinaire, pas de métier).
- Ensuite, son caractère pratique : si le « vrai » de la véridicité sert à juger, à accorder les mots et les choses, celui de la vérifiabilité permet de remotiver les termes de l’expérience.
- Enfin, même si on peut douter que, selon la stricte logique propositionnelle, « la peau de la tomate maintient la tomate dans sa peau » soit effectivement une tautologie
, ce que cette mise en boîte de l’énoncé suggère, avant toute autre chose, c’est que son degré d’information sur le monde serait nul. Or, sous divers instruments d’analyse, cet énoncé trouble – il contient deux polyptotes : du nominatif à l’ablatif (« peau »), et du génitif à l’accusatif (« tomate ») – recèle une information certaine : - La cybernétique et autres théories de l’information, d’abord, qui interprètent ce genre d’énoncé comme noisy, c’est-à-dire moins redondant que brouillé. Dans cette perspective, le chiasme « peau » > « tomate » > « tomate » > « peau » est saturant avant d’être articulant : le message n’est pas « optimal » parce que sa redondance même est piégée. La phrase donne à voir la capture d’un énoncé simple mais biais (« la tomate maintient la tomate ») par un autre énoncé simple cette fois pleinement tautologique (« la peau [est] la peau »), conférant au message à la fois le caractère transparent d’une évidence et le caractère enchâssé d’un chiffre.
- L’analyse linguistique des corpus, ensuite, qui considère diachroniquement le rapport types (types) / tokens (occurrences). La densité de ce rapport (deux occurrences du token « tomate » et le même nombre du type « peau ») est un facteur d’altération des termes. Autrement dit, la « tomate » comme la « peau » subissent une transformation entre leurs deux occurrences : la tomate est seconde par rapport à la peau dans la première partie (« peau »-1 informe « tomate »-1) ; elle est première dans la deuxième partie (« tomate »-2 informe « peau »-2). Que le verbe « maintenir » joue dans ce rapport le rôle de l’échangeur – c’est-à-dire change les positions sans altérer les fonctions (« tomate » est toujours le sujet réel au sein du rapport grammatical de possession appelé génitif subjectif) – est, par exemple, de nature à fragiliser l’idée d’une possession de soi où le soi serait premier. Il ouvre pour les objets la question de la forme et du contenu, du contour.
- Enfin, et intimement lié au point précédent, l’énoncé est un paradoxe fertile pour la méréologie
. Si on considère cette fois les termes fixement (« tomate-1 » est identique à « tomate-2 »), l’information est certes impure, mais elle n’est pas nulle : le tout reçoit le même nom que la partie (l’énoncé se paraphrase en : la partie du tout maintient le tout dans sa partie ; il est donc logiquement boiteux), mais cette indistinction joue de la qualité particulière de la « peau » – à la fois constituant de l’objet-tout et surface externe de l’objet-ensemble. Il y a plusieurs façons de poser l’équation de la tomate et de sa peau en termes méréologiques ; l’une d’entre elle est de dire que la tomate comme tout est la limite supérieure moindre de deux de ses parties, dont l’une est nommée peau et l’autre tomate par métonymie ; mais, en un sens, la peau est aussi la limite supérieure moindre de la tomate métonymique (l’intérieur de l’objet-ensemble tomate).
1.2.3.2. « Ne jamais essayer d’arranger les choses »
Commençons par le parfum des fleurs, mais ne nous contentons pas de « ça », de ressentir un peu plus finement, en y mettant de plus en plus d’adjectifs.- la démarche générale de l’autrice, dont la parenté avec Ponge saute aux yeux : « entreprendre une recherche », « substituer aux multiples charges – historique, politique, religieuse, romanesque… – encadrant le mythe, un seul “vêtement” : celui d’une écriture plane, soucieuse du détail négligé », chercher « le plus petit plutôt que le sublime » ;
- un projet de livre sur Las Vegas, lequel est qualifié, dans une veine elle aussi manifestement pongienne, d’objet « gâché », « occupé », « saturé », « parasité » par la somme des paroles et des usages. Saint-Tropez n’est mentionné dans le texte que comme « ville-test », objet d’un « brouillon » (c’est finalement, après obtention de la bourse pour un séjour aux États-Unis, le « brouillon » qui deviendra – motif archipongien – le texte principal).
- c’est une adresse normée, une réponse aux critères implicites de l’Institution, une justification du travail d’écrivain apprêté en démarche d’écrivain ;
- mais cette adresse est mise à distance par sa reproduction dans le livre Saint-Tropez – Une Américaine (72‑73), où elle joue comme rature exposée ou encart autoparodique.
- d’abord, tomber dans le piège ou le trou des usages, parce que ce trou est le seul véritable lieu commun du langage (chuter, donc, plus que s’étendre sur l’herbe) ;
- ensuite, confronter le point de vue chuté à l’expérience debout ;
- puis relever le terme de ses contradictions.
1.2.4. Roses, chaussures : le sans-pourquoi ne va pas sans dire
La couille est sans pourquoi (en quel honneur la rose serait plus digne et plus belle ou plus sans pourquoi encore ?)1.2.4.1. La chaussure est dans la Nature
Pourtant, la rose n’est plus depuis longtemps une fleur sauvage.
Elle est cultivée pour être vendue. Ou offerte ; ou entrer dans un bouquet.
De nouvelles roses sont créées chaque année ; on leur donne un nom ; aucune rose ne porte seulement le nom de rose :
l’Attraction, la Dirigent, la Bit O’Sunshine, la Canche cespiteuse, la Délimitation, la Spinosissima, la Confetti, ou la Petula Clark.
La rose future ne naît pas rose, sans avoir été pensée, dessinée, avant sa naissance, puis le rosier greffé, cultivé, déplacé, greffé encore.
Il n’y a donc pas si grande différence entre une chaussure et une rose.
Mais la chaussure est une rose un peu plus utile que la rose.
La chaussure porte autant qu’une rose des noms particuliers :
la Bowen, la Babouche, la Gentleman-farmer, la Salomé, la Cuissarde, la York, la Tong, la Méduse.
La chaussure s’appelle chaussure, ainsi que toutes autres sortes de noms, comme la rose.
Le regard que nous avons sur une chaussure posée devant nous (dans une vitrine, par exemple) est sensiblement le même que celui que nous portons sur une rose.
En tant que chose, la chaussure nous concerne de la même manière que la rose.
L’une ne nous dit pas plus que l’autre.
Ce n’est pas que la chaussure soit moins « naturelle » que la rose.
Tout comme un livre, passé cinquante ans, tombe dans le domaine public, la chaussure, à force d’y être, est tombée dans la Nature.
1.2.4.2. Attention, suspicion
[C]e que j’entends par politique : une perception sensible du monde, une façon de tirer les conséquences de ce qu’on sait et de ce qu’on sent.Si vous dites deux fois de suite chou-fleur (chou-fleur chou-fleur), vous voyez deux fois plus de choux-fleurs, les voyez-vous ?
Si vous dites trois fois de suite chou-fleur très vite, vous commencez à être frappé, ou perturbé, par cette accumulation de ch, de ou, de fl, etc., si bien qu’il ne reste plus au chou-fleur authentique qu’une mince fenêtre pour ainsi dire se signaler à votre attention – furtivement il paraît.
- le premier token de « chou-fleur » convoque la chose-nom dans une célébration de la chose essentielle, de l’Idée de chou-fleur ;
- le deuxième token de « chou-fleur » convoque la chose-concept dans une répétition auto-référentielle ; la tautologie qui en résulte est une formule d’authenticité, un état congru de la référence (la référence étant stabilisée, il est désormais possible de la faire fonctionner, soit : de multiplier les choux-fleurs) ;
- le troisième token de « chou-fleur » convoque la chose-mot dans sa matérialité, fait sentir passer l’arbitraire du signe, démotive la référence.
Nathalie Quintane – Certains sont même construits à partir d’un énorme cliché, comme Jeanne Darc ou Saint-Tropez. Pour les défaire ou simplement les faire tourner en bourrique, j’essaye de m’en prendre aux plus petites unités de la langue (la lettre, comme quand je joue sur « Tropez » / « Torpez ») mais aussi au « dispositif » d’ensemble […]. De fait, le mot « suspecter » est juste : il vaut mieux être paranoïaque, quand on écrit – ça facilite le travail.
Transition : Une « hygiène du regard » ?
Je me souviens, ou plutôt je sais, parce que ça a duré longtemps, et que l’évocation de cette période ne relève pas de la mobilisation d’un souvenir et encore moins de l’effort pour se souvenir, mais de l’évidence de quelque chose qui vous a construit et est inséparable de vous-même, que pendant des années j’ai vu avec une taie sur l’œil, c’est-à-dire comme si je voyais le monde à travers le tissu blanc et fin d’une taie d’oreiller usée, et je ne pouvais voir le monde qu’à travers cette taie, mais que je ne puisse le voir qu’à travers, ou plutôt que je n’aie pu, je ne l’ai compris que lorsque, descendant les trois marches d’un cabinet psychanalytique, je vis le voile soudain se lever, et je découvris le monde dans lequel nous sommes.Alors, tu as remarqué des choses.
Voilà. J’ai pris des notes sur les choses que je remarquais, banales, mais qui étaient pour moi toutes neuves.
Quel intérêt à les dégager ? Faire gagner à l’esprit humain ces qualités, dont il est capable et que seule sa routine l’empêche de s’approprier. Quelles disciplines sont nécessaires au succès de cette entreprise ? Celles de l’esprit scientifique sans doute, mais surtout beaucoup d’art. Et c’est pourquoi je pense qu’un jour une telle recherche pourra aussi légitimement être appelée poésie.
1.3.« Pas spécialement poétique »
Introduction : Spécialistes de l'alogon
Le débat imbécile autour de la poésie oppose encore, sous divers déguisements, techniciens et inspirés.Chaussure ne résulte pas d’un pari ; il ne présente aucune prouesse technique, ou rhétorique. Il n’est pas particulièrement pauvre, ni précisément riche, ni modeste, ni même banal. Ce n’était pas un projet, mais ce n’est pas un brouillon, mais il n’a pas encore trouvé sa fin.
Chaussure s’est gorgé de tout ce qu’il a croisé sur son parcours […]
Bref, c’est un livre de poésie pas spécialement poétique, de celle (la poésie) qui ne se force pas.
- « Chaussure » maintient-il son terme ou « chaussure » varie-t-il ?
- Si « chaussure » varie, dans quelles conditions se produit cette variation, et de quel état de fait ces conditions témoignent-elles ?
- À partir de quel degré de variation y a-t-il avarie ou intrus, effondrement de la classe ou expulsion hors de la classe ?
- que Chaussure parle vraiment de chaussure (il n’y a pas de hors-champ allégorico-métaphorique, de « chaussure » mis systématiquement pour autre chose, de symbolisme biunivoque) ;
- que Chaussure ne se force pas à être poétique (ou : n’appelle pas de lecture poétique ; autrement dit : il n’y a pas de plein champ poétique qui s’établirait depuis une définition ou un corpus stables).
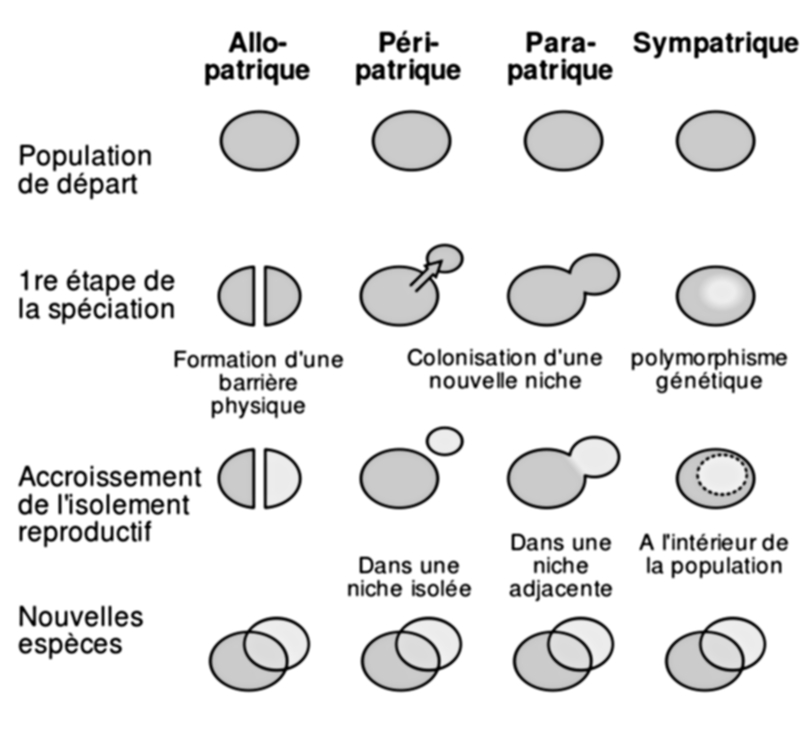 Les différents modes de spéciation (Ilmari Karonen, d’après Dana Krempels, GNU Free Documentation License).
Les différents modes de spéciation (Ilmari Karonen, d’après Dana Krempels, GNU Free Documentation License).- c’est à Prigent et Gleize que, naturellement, Tarkos et Quintane envoient leurs premiers textes après les avoir lus ;
- Prigent s’adresse explicitement au premier (plus Pennequin et Beck), et incidemment à la seconde, dans Salut les modernes
(2000) ; - Gleize, très vite, en fait des continuateurs, voire des illustrateurs de ses thèses
.
- d’un côté, le « non-savoir » flatte une poétique « couillonne » de l’humilité – Quintane cite Antoine Emaz (« se vider, réduire la vanité, ne plus savoir ») et Bonnefoy (« la chose humble […], autorité absolue »)
; - d’un autre côté – c’est la teneur d’un article polémique d’Alferi et Cadiot, dans le premier numéro de la RLG (1995) – l’« excès » bataillien flatte la poétique anti-idéaliste des « Monstres » perçue comme « culte de la cruauté », complaisance dans « l’indicible », académisme de « l’expérience des limites », cliché poétique aussi éculé que les
« fleurs bleues » .
1.3.1. La pose prigentienne de la question-de : radicalité et souveraineté littéraires
- Prigent nous a proposé de jouer avec lui, sur son terrain : parlons de la langue (mais pourquoi de la langue ?), de l’inconscient (mais pourquoi de l’inconscient ?), du corps (mais pourquoi du corps ?), de Bataille (mais pourquoi de Bataille ?), de littérature (mais pourquoi de littérature ?), et, au final, tout devient hypothèse (Dieu ? Je n’ai pas eu besoin de cette hypothèse).- Passés lalangue, l’inconscient, le corps, Bataille, la littérature, Dieu, il n’est plus resté que les façons caractéristiques du discours d’importance, comme dit Pierre Bourdieu, un sociologue.
- Dieu, c’est-à-dire la littérature.
1.3.1.1. Spécialement littéraire
[I]l y avait ceux qui me paraissaient un peu « forcer sur le style », si bien que ce n’était pas le style voulu mais la volonté du style (le forçage) qui faisait littérature, mais comme, du coup, ça faisait trop littérature, on ne voyait plus que ça, et j’en étais gênée […].Si on entend par « pouvoir » un effet transformateur sur la réalité (et, nommément, sur la réalité socio-politique), la poésie peut peu. […]
Que dire, alors ? Partir peut-être simplement de ce constat : c’est tout juste si elle peut, la poésie, être. D’où que la question traitable n’est sans doute pas la question de ce que la poésie peut faire – mais celle de son improbable possibilité d’être.
Il ne s’agit pas d’une question métaphysique sur l’être-en-soi de la poésie (sur l’essence du « poétique ») mais d’une question pragmatique sur ce qui rend possible (ou même inévitable) que cet être soit – plutôt qu’il ne soit pas. Dit autrement : il s’agit de la question de savoir pourquoi il y a de la poésie plutôt que rien – attendu que ce rien est un plein saturé : la masse commune des écrits qu’on appelle couramment « littéraires ».
En somme :
b. l’accomplissement même de la poésie.
c. la Haine comme passion pour la poésie (et non dédain ni indifférence)
d. la poésie comme ravissement : épreuve de l’instant, de la non-possibilité de l’instant : non-savoir : « déchéance et suppression de la connaissance » : souveraineté.
Ce n’est pas que je croie la question inintéressante ou obsolète. Mais m’intéresse plutôt la question de la poésie comme radicalisation frontale de la question de la littérature. Je ne veux pas dire par là que la poésie serait le mieux de la littérature. Mais plutôt qu’elle écrit la littérature au pire : qu’elle essaie de prendre pour objet la question même de la littérature – déshabillée justement des spéculations sur ce que la littérature peut, par le vecteur de ce qu’elle nous dit de notre habitation commune du monde. Ce qui, soit dit en passant, veut dire que par « poètes » j’entends aussi bien (voire mieux) Rabelais que Ronsard, Lautréamont que Verlaine, Beckett que Du Bouchet, Novarina que Bernard Noël, Guyotat que Pleynet, etc.
- à la superficialité nonchalante du faire, par un effort de réflexivité (« elle essaie de prendre pour objet la question même de la littérature ») ;
- au confort véhiculaire, en ce qu’elle requiert, face à la langue commune, beaucoup d’art, une technicité propre (ensemble des opérations du « combat littéraire ») ;
- à l’illusion d’un but, d’un usage, d’une destination de la littérature, en ce qu’elle ne se collimate sur aucune autre visée que celle d’être (elle est « déshabillée justement des spéculations sur ce que la littérature peut »).
| Faire radicalement de la littérature | « Se poser la question de la littérature » |
| Faire de la poésie | « Se poser la question de la poésie » |
- littérairement : il fait sien le paradigme du « geste poétique » comme « mise en crise » de la forme poème
; - politiquement : dans un emprunt à l’album révolutionnaire, il valorise le
« mouvement » constituant contre les « corps constitué[s] » .
Souveraineté : en fait le propre de l’individu, de la littérature (la littérature comme valeur souveraine, opération souveraine).
GB [Georges Bataille, ndr], après guerre, place la littérature au plus haut – seul(e) nécessaire. Cette idée-là, ou ambiance, perdure jusqu’à mes études (début des années 80), puis fin. La « littérature » ne peut alors se déplacer qu’en descendant, puisqu’elle est prise dans cet imaginaire social du haut et du bas, du dedans et du dehors (du sacré et du profane, du calcul et de la dépense). […]
Supérieure comme quoi ? la médecine ? la connaissance du moteur à quatre temps ? député ? ministre ? compagnon du Tour de France ? vainqueur à Roland-Garros ? Britney Spears ? Lénine ?
Supérieure parce qu’on est censé écrire avec le cerveau, qui est placé dans la tête, qui elle-même n’est surplombée que par les cheveux, chez l’homme (sauf pour les chauves) ?
Idem pour cette poésie, cette littérature d’aujourd’hui : rien, en amont, ne facilite son abord, si bien que quand vous lisez dans une médiathèque, par exemple, ou dans la plupart des facs quand on fait lire un de vos textes, c’est toujours la première fois, toujours bizarre ou sans intérêt, jamais ça ne ressemble – ou ça ressemble trop et d’un air entendu à des choses que plus personne ne connaît.
1.3.1.2. Souveraineté
La génération de 90 reprend plus ou moins ce bilan de fin de partie à son compte : pas de souveraineté de la littérature, nécessité de défaire cette sacralité. […] Non seulement, donc, il n’y a plus d’exception littéraire, mais il faut sortir de la littérature, ou de la « poésie ».Or, sacrifier le sacrifice, sacrifier le sublime, c’est commencer par renoncer à penser comme ultime et seul valable, le fait de vivre « au bord des limites où toute compréhension se décompose » [citation de Bataille dans La haine de la poésie, qui qualifie la liberté véritable, ndr], c’est faire porter à nouveau, et à nouveau frais, le soupçon sur la coupure qu’il y aurait entre le discours du penseur et celui du poète (le sublime est, pour Kant, ce moment où s’arrête le discours du philosophe et où commence celui des poètes), c’est reconsidérer la tétanie propre à une écriture poétique frisant le réel comme Kant frisa l’enthousiasme à l’annonce de la révolution française.
Quintane – Je crois que la catégorie professionnelle pour laquelle la distribution en genres est la plus utile est celle des libraires. Je vois ma libraire crouler sous les cartons, et qui me dit : Au moins les romans je les mets là, la philo là et la poésie là. […] Par ailleurs, ce souci de « marqueterie » qui est le mien est historiquement lié à la poésie (voir le prosimètre à la Renaissance, le « glanage » au XIVe siècle, qui est l’ancêtre de nos « cut-up » et autres « prélèvements », etc.) ; il est associé chez moi à l’idée que les oppositions et les contrastes amorcent efficacement (= brutalement) une pensée critique (j’en ai fait l’expérience physique et psychique en lisant Lautréamont et Jacques le Fataliste à l’adolescence). La poésie, pour moi, c’est une pensée critique et la programmation de ses effets (de rupture et de trouble) chez le lecteur. S’il y faut « l’effort au style », allons-y, allons-y pour l’effort au style. Mais quand je lis les Poésies de Ducasse, je sens moins un style qui s’efforce qu’une manip’ d’une habileté et d’une efficacité diaboliques.
1.3.2. La pose gleizienne de la question-de : un héritage critique
Comment ne pas faire que la poésie soit la poésie, donc séparée de la Littérature et beaucoup plus mobile et sonore / vivante / lisible…1.3.2.1. Un « métier d’ignorance »
Reste pour nous : la poésie. L’ignorance de ce qu’elle est. La faire, l’écrire « pour savoir ». Pour progresser dans cette ignorance. Pour savoir cette ignorance. Pour l’élucider.- une histoire de la modernité poétique qui force à poser la question d’un après la poésie ;
- une conception « tactique » de poésie-pratique qui doit permettre de continuer sans s’embourber dans poésie-Idée, poésie-patrimoine ou anti-poésie.
- le 19e siècle, moment où la poésie se constitue comme
« question à la poésie, recherche de la poésie, rupture avec la poésie » ; - le 20e siècle, âge d’une « seconde modernité », « expérimentale », sans domination incontestée d’une « formalité » sur les autres
; - le tournant du 21e siècle, où les différentes formes de poésie entrent dans une « coexistence indifférente », occasionnant diverses conceptions restauratrices de poésie-Idée et de poésie-genre
.
- Dans un premier temps, une « pseudodéfinition » de la poésie, dont le critère d’appréciation n’est plus la conformité à une Idée ou à une tradition, mais l’efficacité stratégique à motiver minimalement un nom. Une fois engagé, ce nom entraîne une série de déclarations initiales qui joueront comme support de discussion (éventuellement jusqu’à la contestation même de ce nom). Isolée, c’est une définition assez semblable à celle de Prigent (« poésie » est le nom d’une pratique exclusive du langage qui en conteste – tend à en abolir – le caractère conventionnel). Prise dans son mouvement dialectique, elle joue comme « fantasme pratique », c’est-à-dire comme duperie volontaire – ou, pour le dire à la Tarkos, oui initial
. J’ai besoin d’une certaine définition minimale de la poésie comme la seule pratique verbale, littéraire, échappant (ou tendant à échapper) aux contraintes et aux dogmes de la représentation : la poésie comme branchement direct (ah! ah!) de la langue sur du réel (de l’inconscient, du physique, du pulsionnel), la poésie comme branchement direct (!) de la langue sur de la réalité « objective » (du réel rugueux à étreindre, du réel sans nom et sans images et dénué de sens, etc.) - Dans un deuxième temps, un « refus […] des définitions admises » de la poésie. C’est le moment la poésie est inadmissible de la conception gleizienne, et c’est peut-être celle où le fond spirituel de Gleize est le plus évident, où son franciscanisme (dénuement, dénudement, dépouillement, vœu de pauvreté) rencontre la tradition mystique de la dépossession (« autonégation », « autodestruction »), dans sa dimension dialectique
. Je prétends que la poésie s’affirme ou s’invente par la négation et le dépassement de ses définitions données, admises, apprises. La poésie consiste, pour une part essentielle, en son autonégation, en son autocritique, en son autodestruction plus ou moins violente. C’est en ce sens que toute vraie poésie est antipoétique. - Dans un troisième temps : voie d’une mystique apophatique ou aphairétique, qui remotive inlassablement le nom en niant son adéquation ; non seulement il n’y a pas de définition possible de la poésie, mais l’ignorance de ce qu’est la poésie est « l’épreuve » ou « l’exercice » qui seuls spécifient la véritable poésie :
Enfin (? !), je prétends que la poésie est sans définition, et qu’elle n’est que de cette ignorance. Poésie comme métier d’ignorance, et, d’abord, de ce qu’est la poésie. Épreuve, donc, ou exercice de l’ignorance.
- D’abord, métier de poésie fait entendre une ascendance classique, préromantique (l’expression sonne antérieure à la distinction de Schlegel entre Dichtart et Dichkunst
) ; poésie-pratique correspond à un savoir-faire, à une « technicité propre » (Prigent), à un genre et une forme conventionnellement fixés. - Ignorance convoque une histoire des revendications d’impéritie en poésie, à la fois préclassique (Guillaume d’Aquitaine, Rutebeuf) et moderne (figures de l’incapable, du désœuvré, de l’improductif dans le monde de la compétence, de l’utilité, de l’affairement).
- Enfin, métier d’ignorance perpétue par l’oxymoron le mode dialectico-mystique du deuxième moment : savoir, c’est savoir ne pas savoir et, suivant : le savoir-faire des poètes consiste dans la conscience de leur impéritie. Cette impéritie est fonction d’un
« désaffublement » , d’un « dégagement », d’un dépouillement radical, dont la figure à la fois accomplie et originelle est l’infans : pur de tout « costume » social (il est « nu »), son silence est à la fois parole en puissance (promesse) et refus de se compromettre avec le monde (il« claque la porte » ).
1.3.2.2. « Poésie, et après ? »
Il se peut que cela, cette démarche que je continue d’appeler poésie, n’ait plus de nom, ce nom. Écrire, en ce sens, n’appartient peut-être pas à la littérature. Ou serait ce qui, dans la littérature, n’appartient pas à la littérature. Ou ce qui, dans la poésie « n’a rien à voir avec la poésie ».- le « réel » est le nom ambivalent d’une clarté opératoire et d’une ténèbre stratégique (il est lui-même « intérieur et extérieur », muet et parlant, donné et arraché, caractérisé dans les termes oxymoriques de la proximité lointaine qui définit l’intimité pour une certaine mystique
) ; - « écrire » est le lieu où toutes les certitudes s’absentent, sur le mode là encore mystique de l’oppositorum coincidentia
: écrire frôle ne pas ou ne plus écrire, comme le sentiment de la grâce tangente celui de la disgrâce.
- si la poésie n’est « ni leur fait, ni leur lieu », c’est encore leur faix et leur lieue, leur souci et leur mesure, leur tare et leur échelle, leur héritage (il leur faut faire après, ce qui est encore faire avec) ;
- la poésie n’est « ni leur fait, ni leur lieu », mais un de leurs terrains, et moins le terrain d’une mission, à laquelle on adhère et qui règle sa vie, que le terrain d’un jeu, dont le nom, « poésie », est aussi celui de leur handicap dans ce jeu.
1.3.3. Pas spécialement ailleurs
L’ironie : Je ne sais où se trouve ce mot dans l’ensemble des mots et quels sont les mots qui le retiennent dans son sens.1.3.3.1. Poésie-lieu, poésie-non-lieu
Le sens a été capté par les kilomètres de registres imprimés. La langue est allée s’accrocher à ça et est bien mal en point à moins de relire le registre. C’est difficile de se croire marchant dans une campagne. C’est difficile de se croire marchant, la pensée en liberté cherchant ses images, en liberté dans la campagne. L’agriculture est dépendante d’une certaine organisation administrative…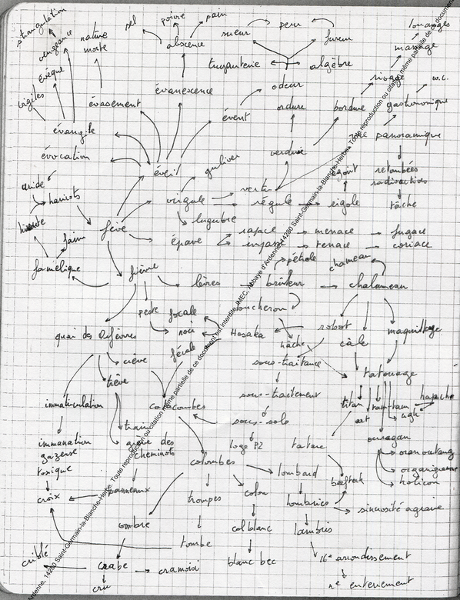 On trouve, dans de très nombreux carnets de Christophe Tarkos, un véritable examen des « registres », et une mise au travail sous la forme de cartes lexicographiques ou lexématiques, de tableaux de vocabulaire technique, de diagrammes et de listes d’affixes grecs ou latins. (Ici, une page extraite d’un cahier du fonds TRK8 de l’IMEC.)
On trouve, dans de très nombreux carnets de Christophe Tarkos, un véritable examen des « registres », et une mise au travail sous la forme de cartes lexicographiques ou lexématiques, de tableaux de vocabulaire technique, de diagrammes et de listes d’affixes grecs ou latins. (Ici, une page extraite d’un cahier du fonds TRK8 de l’IMEC.)- La voix de Valérie Tarkos prend en charge le pôle subjectif du discours sur la poésie. C’est la voie négative, le mode sensible qui fonde le jugement intime et le goût personnel. Elle rejette l’accaparement de « poésie » par une idée et repousse la conception affadie de la poésie émanée de cette idée : complaisance dans l’intime, sensiblerie, thérapeutique de l’exutoire.
- La voix de Christophe Tarkos prend en charge le pôle objectif du discours sur la poésie. C’est la voie affirmative, le mode intellectuel qui fonde la capacité de juger de tout et pour tous, de régler une norme selon des critères qui définissent l’inclusion dans le genre ou la classe « poésie », parfois au risque de la tautologie.
- d’un côté, un poème, pour être reçu comme tel, doit être indexé sur une certaine idée de la poésie (voie normative, idéaliste, de la Célébration) ;
- d’un autre côté, tout poème qui se conforme à une idée de la poésie est dégoûtant, « poisseux », irrecevable (voie antinormative, nominaliste, de la Récusation).
1.3.3.2. Dedans / dehors
Ce n’est pas le discours qui représente le dehors, c’est le dehors qui devient révélateur du discours.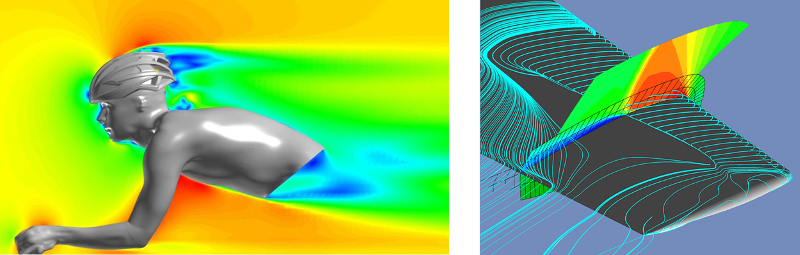 Deux images MFN représentant la pénétration dans l’air d’une aile d’avion (1) et d’un cycliste de course (2).
Deux images MFN représentant la pénétration dans l’air d’une aile d’avion (1) et d’un cycliste de course (2).1.3.4. Pas génériquement poétique
Le désir que j’ai de travailler pour l’utilité publique, m’a fait prendre le dessein de composer un livre qui se moque des autres, et qui soit comme le tombeau des romans, et des absurdités de la poésie.1.3.4.1. « Rendre les costumes visibles en tant que tels »
- un déni ingénu à vocation déflationniste, proche de ce que la ligne pongeo-gleizienne appellerait un
« désaffublement » : l’absence de mention de genre n’est ni« une volonté [ni] un désir d’abolition des genres ni même des frontières entre les genres – je ne me suis même pas posé la question… » ; - et l’assomption de plusieurs genres à la fois, opération manifeste d’un jeu de suraffublement (c’est le cas de la composition générique singulière de Crâne chaud : « fantaisie réaliste critique »).
- d’une part, de l’ordre de la cautèle fondée culturellement, justifiée historiquement. À propos du Rimbaud d’Une saison en enfer, de l’« attelage Lautréamont-Ducasse » (soit : aussi bien Les Chants de Maldoror que les Poésies) et du Nerval des
« Nuits d’octobre », elle déclare : « Je ne sais pas s’il y avait de leur part une volonté d’abolir les genres… Sans doute se pensaient-ils poètes, d’une certaine manière, même dans l’anti-poésie à fond » . Posture d’ingénuité tactique, au fond, devant la rigidité supposée et la laxité réelle des critères génériques : si le genre va de soi, nul besoin de le mentionner. - d’autre part, de l’ordre d’un jeu avec le contexte éditorial, ses attentes tacites, sa commande permanente : moins on en dit sur sa position d’écriture, moins on éclaircit les raisons et les motivations, moins on inscrit ce qu’on fait dans les catégories en place, plus on se donne la chance de surprendre, et d’abord son propre éditeur.
- un genre mineur (non canonique) et déjà impur du point de vue des critères littéraires (incohérence, volubilité, excentricité y sont valorisées comme écarts par rapport à une norme d’écriture qu’on peut appeler, après Prigent,
« la belle ouvrage » ), - mais aussi, traditionnellement, un genre anti-genres
.
Je saisis quelques phrases de l’accusation formulée à l’aide d’un organe qui semblait être celui de M. Patin :
– Du réalisme au crime, il n’y a qu’un pas ; car le crime est essentiellement réaliste. Le fantaisisme conduit tout droit à l’adoration des monstres. L’essaysme amène ce faux esprit à pourrir sur la paille humide des cachots. On commence par visiter Paul Niquet, – on en vient à adorer une femme à cornes et à chevelure de mérinos, on finit par se faire arrêter à Crespy pour cause de vagabondage et de troubadourisme exagéré !…
J’essayai de répondre : j’invoquai Lucien, Rabelais, Érasme et autres fantaisistes classiques. Je sentis alors que je devenais prétentieux.
– Qui avait imité Sterne…
– Lequel avait imité Swift.
– Qui avait imité Rabelais.
– Lequel avait imité Merlin Coccaïe…
– Qui avait imité Pétrone…
– Lequel avait imité Lucien. Et Lucien en avait imité bien d’autres… Quand ce ne serait que l’auteur de l’Odyssée, qui fait promener son héros pendant dix ans autour de la Méditerranée…
1.3.4.2. « Manifestes » de Tarkos
Christophe Tarkos :– Le signifiant = le signifié. C’est pour moi ce qu’il y a de plus important. Je vais expliquer en faisant un petit dessin et vous allez me dire ce qui est là, ce que vous voyez là.Pascale Casanova :– Je lis « chat ».
C. T. :– Et donc quand on regarde et qu’on voit « chat », on a le signe = du signifiant = le signifié. On a tout : vous avez lu chat, et vous avez compris chat.
P. C. :– Hm.
- il y a ceux d’R.R., d’abord, évidemment pasticheurs (dramatisation de la prise de conscience et de décision, récurrence d’un
« nous » qui annonce le « monde magique » et les déclarations tapageuses de « Gonfle » ) ; - il y a aussi le « Manifeste Chou », dont nous avons montré
comment il désamorçait les poses récusatrices de la question-de en affirmant la poursuite de la poésie par tous les moyens ; - il y a « Le poème de dehors », dont nous avons signalé
qu’il prenait en charge un des attendus du genre « manifeste », l’explicitation des principes poétiques (en l’occurrence, l’inhésion du flux à ce qui flue ) ; - il y a enfin Le signe =, qui radicalise le principe du « Poème de dehors », en transformant l’inhésion en pure équivalence (« le signifié = le signifiant »).
- littéralité : son adresse doit être d’une limpidité de nature à verrouiller sa réception (c’est une mise au point),
- et déclarativité : c’est une annonce formelle dont la portée et l’espace de validité sont tendanciellement le monde entier, puisque ce que le manifeste déclare, il s’y jure, il s’y attache absolument.
Gudrun de Geyter – C’est un peu comme King-Kong qui bat avec ses mains… ?:
C.T. – Ah, oui, oui, très bien, oui, tout à fait ! Et qui va dire, je vais faire beaucoup de choses, etc. Donc on va faire des tas de petits manifestes comme ça, qui sont assez microscopiques. Et parmi ces manifestes, il y a toujours une idée, quand même, de faire que les choses soient plus directes, plus concrètes.
distance
distant
la distance
distendu
le distant
un peu de distance
un distant
de la distance
distancée
distendue
une distance
sa distance
grincement et écrasement = substance
= les deux bandes noires laissées sur le sol
par les pneus du freinage juste avant
l’écrasement
Conclusion : La question-si-la-poésie
C’est comme s’il fallait à chaque fois déblayer le terrain et mettre la poésie en crise, pour que resurgisse, nue et crue dans le trou ouvert, la question de la poésie. Comme s’il fallait toujours, devant cette brûlante question, installer un cordon sanitaire, un glacis aseptique, un « ce n’est pas ça » agressif qui dessine, autour du trou de la poésie, un bourrelet tuméfié de déclarations négatrices. […] Comme si, dans la logique perverse du dispositif, [la poésie] n’était que cette question toujours reposée, cette réponse toujours différée sur sa propre nature, cet empêchement à fixer sa propre définition, ce retrait aux formes sues, cette sempiternelle renaissance à partir d’autre chose qu’elle-même.- Quintane qualifie son deuxième premier-livre, Chaussure, de « pas spécialement poétique », pour corriger les malentendus autour de son premier premier-livre, Remarques. Que recouvre ici l’adjectif « poétique » ? À quelle poésie « spécialement poétique » l’expression s’oppose-t-elle ? Peut-on l’étendre à l’ensemble des œuvres de notre corpus ?
- Tarkos commence son « Manifeste Chou » par le constat qu’« il y a quelque chose qui ne va pas dans l’utilisation du mot poésie ». Qu’est susceptible d’y désigner ce « mot » ? De quel trouble dans son « utilisation » est-il ici question ? Que distingue le choix du terme « utilisation » de celui, attendu, d’« usage » ? À considérer la dramatisation du texte (de « Ça ne peut plus durer comme ça » à « Ça va durer. Ça peut durer encore comme ça »), que signifie que « poésie » continue en dépit du diagnostic initial ? Une persistance têtue des pratiques ? Une subsistance nonchalante du vocable ? Une persévérance de la poésie dans son être ?
- d’élucider les rapports d’adhésion et de défiance des auteurs d’R.R. vis-à-vis du « Milieu » et de la « psychologie » poétiques (Quintane)
; - d’exhumer les raisons profondes du refus de Quintane d’être accaparée par une lecture « ontothéologique », et de comprendre les raisons de son égale méfiance face aux poétiques de l’objet
; - de déterminer les rapports des deux auteurs aux discours d’autorité et aux figures tutélaires du champ à l’époque de leurs débuts (en l’espèce, les œuvres poéticiennes de Christian Prigent et Jean-Marie Gleize)
; - d’appréhender les conceptions tarkossienne et quintanienne de la poésie comme genre, et de la littérature comme tutelle de ce genre, pour prendre la mesure de ce qui les sépare des conceptions de leurs aînés, reçues de Bataille (via Prigent) et de Ponge (via Gleize)
.
- En termes bataillio-prigentiens : la poésie se renouvelle de « haïr » ses manifestations consacrées
. - En termes pongeo-gleiziens : la poésie ne se demeure fidèle qu’en ne cessant pas de se débarrasser des insignes de la poésie (c’est un des sens du fameux « désaffublement »)
.
- pour Prigent, faire de la poésie c’est ne pas savoir ce qu’elle est mais savoir ce qu’on fait (on
« radicalise la question de la littérature » ) ; - pour Gleize, faire de la poésie c’est ne pas savoir ce qu’on fait mais, sinon savoir qu’on en est, reconnaître au moins qu’on y est en ce qu’on tente d’en sortir.
Une démonstration du principe heuristique de la « convention mentale », par GaelGeobiologue63 : « On va juste penser une phrase, se régler sur une fréquence, la fréquence qui correspond à de l’eau dans une canalisation (et pas à une source, ndr). J’avance et je dis « canalisation d’eau, canalisation d’eau » ; ça bouge. »
Mais derrière l’humble « mission » poétique, consacrée par l’alogon, c’est moins une « docte ignorance » qui se maintient que le vieux privilège sapientiel d’une ignorance docte.
(A) non spécialiste, opérateur moyen ;
et de
(B) manipulateur (utiliser la poésie, c’est avoir autre chose en vue, s’en servir, la mobiliser à d’autres fins qu’elle-même).
Le premier sens est moins-disant : il implique, dans le rapport au legs, un « désaffublement », un refus de la charge ; le second est renchérisseur : il implique un « suraffublement », un zèle d’aîné dans la gestion de l’héritage.
- refus de la séparation des registres (notamment parodique / non parodique
) et, par suite, conjugaison de ces registres ; - contestation de la séparation des genres, perçue comme la trace analogique de celle des savoirs et des tâches ;
- prise en compte polémique d’un morcellement du monde en discours spécialisés et de la division des intelligences sur la base des compétences entretenues par ces discours
; - refus d’un partage du monde entre dupes et non-dupes, auquel certaines poses de la question-de sacrifient (la poésie comme pratique héroïque devant le langage, dans un monde dupe de la véhicularité de celui-ci)
; - atténuation du partage entre « lyriques » et « formalistes », et substitution d’un autre partage, entre poétiques exceptrices (ou poétiques de l’alogon) et poétiques inclusives
; - refus du partage entre activités souveraines (littérature, poésie) et marasme démocratique (éducation populaire, littérature générale), considéré comme un partage classiste (un idéal relationnel de lecture se substituant, explicitement chez Quintane, à l’idéal aristocratique de l’« écriture » souveraine
) ; - de manière afférente, modération du partage entre pratiques marginales (ou « souterraines » ; Prigent) et pratiques majoritaires, consensuelles (ou « mainstream » ; le même)
;
- de manière afférente, modération du partage entre pratiques marginales (ou « souterraines » ; Prigent) et pratiques majoritaires, consensuelles (ou « mainstream » ; le même)
- refus du partage entre « expérience des limites » (trope bataillien) et expérience ordinaire
.
- dans R.R., par des pastiches et styles d’emprunt, une diversité de tons et de registres, des ragots plus ou moins railleurs sur le « Milieu » (la capitale est de Quintane), des proclamations politico-théoriques bouffes
; - ensuite, dans les deux œuvres, par une critique des conceptions de la poésie qui dispensent celle-ci de récolement (de confrontation avec ses raisons) ; c’est ce que nous avons appelé une chasse du sans-pourquoi de la rose et au-delà
).
- du côté de Quintane, enterrement du terme sans pompe
(son « Poésie, c’est mort » faisant écho, par la familiarité de l’expression, au « Poésie, c’est crevé » de Prigent, repris de Denis Roche) ; - du côté de Tarkos, mutation tactique qui, comme le dit Castellin, préfère « l’infiltration parasite » à la « guerre ouverte », et la poursuite d’
« un “oui” plus qu’ambigu » au « non ! qui coupait court » .
2. La question-qui
Introduction : « Dé-spécialiser tout »
Au poète de droit divin, à celui qui dit la « vérité », Pindare oppose avec mépris, « ceux qui ne savent que pour avoir appris » : pareils à des corbeaux dans le bavardage intarissable, ils « croassent vainement ».- d’une part, de casser le bloc, théoriquement impraticable, de la « poésie » en appareillant le terme pour en préciser les occurrences (poésie-vocable, -Idée, -pratique, -patrimoine, -champ, -Milieu, -espèce, -genre, -lieu-du-discours). Ces distinctions travaillent le terme, de l’intérieur, en épaississement (elles étoffent le problème qu’une « question » supposée immémoriale offusquait) et, de l’extérieur, en réduction (elles rendent patent le caractère absurdement générique du signifiant au regard d’un signifié en miettes) : « poésie » y apparaît, pour paraphraser une remarque de Quintane, comme ce qui
« maintient la [poésie] dans sa peau » . - d’autre part, d’établir une distinction importante sous la forme de deux questions-types correspondant à deux dispositions devant le lieu du discours que désigne l’assomption du terme « poésie » : la question-de-la-poésie ; la question-si-la-poésie.
- La version de Quintane, d’une indifférence au terme, peut se dire dans les mots de Laplace devant l’objection de Dieu :
« je n’ai pas […] besoin de cette hypothèse » . - La version de Tarkos, d’une trivialisation des débats autour du terme et d’une voie cataphatique avariante donc désacralisante, peut se dire dans les termes d’une aggravation du quodlibet gleizien
: poésie, c’est tout ce qu’on veut, plus un.
- toujours l’autre d’une foi positive, naïve, béate dans la poésie (Prigent
) ; - « le contraire de ce que vous pensez, toujours le contraire, et même elle serait tout simplement le contraire, sa définition la plus simple serait d’être le contraire. » (Gleize
)
- en conteste l’institution (la légitimité du savoir dont s’autorise sa parole),
- émancipe la poésie des rôles qui lui revenaient de droit dans la société archaïque (dire l’éloge et le blâme notamment),
- fait d’une ancienne prérogative d’inspiré (la mémoire-mnêmosúnê) une compétence (tekhnê) du monde : la mnémotechnique,
- et transforme ce que Platon nomme la
« possession » poétique – c’est-à-dire un don qui fondait l’idée que le poète était sciens nesciens l’interprète de la providence – en pratique autonome (Simonide, notamment, monnaye ses poèmes).
2.1. Le logothète et le parlant ordinaire
Introduction : Division du prophétariat
- Le poète ne sait pas ce qu’il dit
. - Le poète n’est le spécialiste de rien
. - Le poète n’est capable ni de vérité ni d’opinions justes
.
- la question des ressources spécifiques (lexique, syntaxe) ;
- la question de la représentation dans le discours des intentions ou vouloirs-dire ; posée de manière pragmatique, cette question couvre les distinctions traditionnelles de mention et d’usage, de nomination et de prédication.
- Au plan lexico-syntaxique, de même que la poésie est à la fois la trace d’une langue naturelle (cliché classique) et un langage spécifique (cliché post-romantique), la philosophie est à la fois la langue du bon sens, de la curiosité naturelle, de l’entretien intérieur de tout honnête homme, et la langue de l’abstraction métaphysique, de la technique conceptuelle.
- Au plan poétique, un cliché définit la poésie par ses ressources propres, comme relevant de la pure mention ou d’actes impérieux de nomination (par opposition à la rationalité discursive ayant les mots en usage).
- sa parole est une institution du langage ;
- sa langue est ab-solue, détachée du tissu référentiel qui fait les usages ordinaires.
2.1.1. Permanence du schème archaïque
Nous sommes encore en domaine romantique – d’un seul tenant, la fin du XVIIIe et aujourd’hui.2.1.1.1. « Le poème », « le poète »
4717. LE poète ? ouille ! Des poètes, oui.4718. « Poète » est un nom, un nom propre avec, éventuellement, le supplément d’un qualificatif, d’un nom de rue, d’une statue, d’un monument…
4719. Un nom de poète mis sous un poème est comme un mot indo-européen reconstruit :
4720. Les poètes ? Peut-être.
- le poète n’a pas à donner les siennes : il est comme sa rose, ohne warum, aut-hentique (Badiou dit après Lacan : il « ne s’autorise que de lui-même ») ;
- le philosophe, lui, est tenu par un système de légitimation, responsable de son usage des mots devant l’usage commun de ces mêmes mots
.
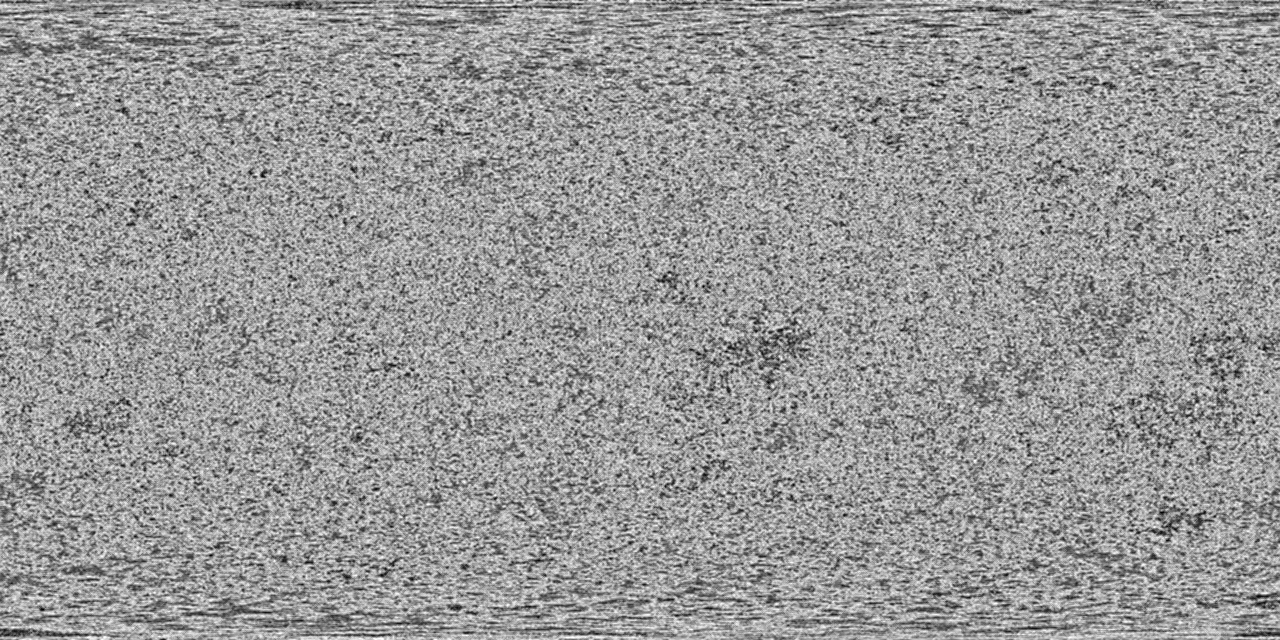 Représentation du fond diffus cosmologique (Cosmic microwave background) par l’Observatoire Planck de l’Agence Spatiale Européenne. Le fond diffus cosmologique est une sorte de « photo de l’univers primordial », 380 000 ans après le Big-Bang.
Représentation du fond diffus cosmologique (Cosmic microwave background) par l’Observatoire Planck de l’Agence Spatiale Européenne. Le fond diffus cosmologique est une sorte de « photo de l’univers primordial », 380 000 ans après le Big-Bang.- la parole philosophique n’est l’apanage d’aucun, c’est simplement la voie de qui ne se prévaut pas d’être quelqu’un ;
- parce qu’elle est anti-statutaire et non-fonctionnaire, elle s’oppose à la parole des « roi[s], [des] devin[s], [des] prophète[s] », figures de l’
« inspir[ation] » ou du « pouvoir » .
2.1.1.2. L’instituteur princier du langage
Il faudrait faire voir que le langage contient des ressources émotives mêlées à ses propriétés pratiques directement significatives. Le devoir, le travail, la fonction du poète sont de mettre en évidence et en action ces puissances de mouvement et d’enchantement, ces excitants de la vie affective et de la sensibilité intellectuelle, qui sont confondues dans le langage usuel avec les signes et les moyens de communication de la vie ordinaire et superficielle. Le poète se consacre et se consume donc à définir et à construire un langage dans le langage…- les mots comme unité lexicales, c’est die Wörter ;
- les mots comme unité expressive continue de la parole (formule biblique, parole prophétique, promesse), c’est die Worte.
2.1.2. Le mot
2.1.2.1. Les mots ne veulent rien dire
Pâte-mot est la substance, est la substance de mots assez englués pour vouloir dire.- le refus de la correspondance entre unité lexicale du sens et unité expressive du discours ;
- le refus d’une limitation de la question du sens à la catégorie de signification, qui s’attache traditionnellement au contenu propositionnel (Tarkos lui préfère la notion pragmatique de vouloir-dire
) ; - le refus de la confusion entre lieu-tenance conventionnelle du signe et présence de l’objet dans le nom (« un mot désignerait un être »).
umingmakhiuriaqtuqatigitqilimaiqtara
(= je ne retournerai plus chasser le boeuf musqué avec lui).
2.1.2.2. L’expression est « toute faite »
L’humain possède la faculté de construire des langues qui permettent d’exprimer chacun des sens [jeder Sinn] sans avoir la moindre idée ni de la signification de chaque mot, ni de la façon dont chaque mot signifie [wie und was jedes Wort bedeutet]. De la même manière, on parle sans savoir comment chaque son individuel est produit. La langue ordinaire [die Umgangssprache] fait partie de l’organisme humain et n’est pas moins compliquée que celui-ci.Connaissance de l’ennemi
Connaissance de soi
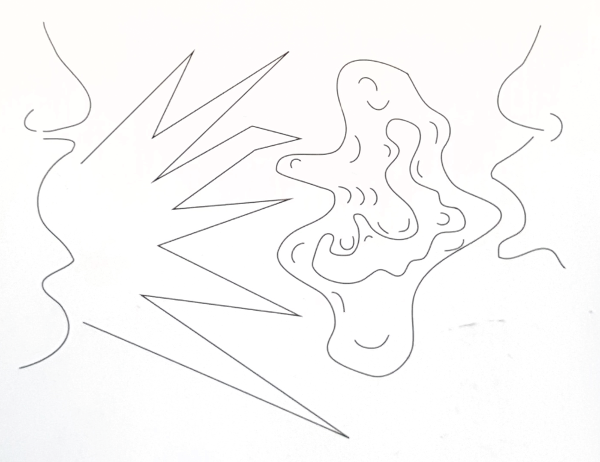 Dessin de Tarkos, extrait du cahier Le baroque (p. 73), et reproduit en couverture de l’édition Al Dante.
Dessin de Tarkos, extrait du cahier Le baroque (p. 73), et reproduit en couverture de l’édition Al Dante.2.1.3. La référence
2.1.3.1. La convention, une possession collective
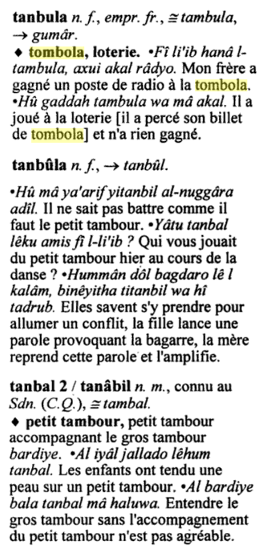 En arabe tchadien, une fois les deux mots translittérés en alphabet latin, tambour et tombola ne se distinguent que par leurs accents. (P. Jullien de Pommerol, Dictionnaire arabe tchadien-français, Paris : Karthala, 1999)
En arabe tchadien, une fois les deux mots translittérés en alphabet latin, tambour et tombola ne se distinguent que par leurs accents. (P. Jullien de Pommerol, Dictionnaire arabe tchadien-français, Paris : Karthala, 1999)- dans le sens d’une alchimie communautaire : former le monde, c’est constituer ce monde ;
- dans le sens d’un façonnement actif : former le monde, c’est le faire.
 Si on en croit le rayon « images » de Google, Christophe Tarkos, avec son improcédure « Tambour et tombola », a réussi à briser le monopole des brosses pour balayettes autoportées de marque Kärcher sur l’expression « tambour mou ».
Si on en croit le rayon « images » de Google, Christophe Tarkos, avec son improcédure « Tambour et tombola », a réussi à briser le monopole des brosses pour balayettes autoportées de marque Kärcher sur l’expression « tambour mou ».2.1.3.2. La référence rigide
Il y a une chose dont on ne peut dire qu’elle mesure un mètre ni qu’elle ne mesure pas un mètre, c’est le mètre étalon de Paris. Mais il ne s’agit pas, bien sûr, de lui attribuer une propriété extraordinaire ; il s’agit seulement de signaler son rôle particulier dans le jeu de langage consistant à mesurer au moyen du mètre.- la situation des lieux : la logique de l’adresse conduit l’utilisateur ordinaire de la langue et des rues (et jusque les professionnels de l’adresse, les facteurs) à des impasses. Le suivi strict des normes, en matière de numérotation des voies, rend le monde moins clair, moins lisible, moins praticable, et ce en dépit des noms qui les nomment d’après des particuliers univoques (noms de personne, de lieux, de batailles)
; - la mesure du poids : le kilo est improprement nommé
, immotivé , hypersensible (tout soin d’entretien le menace d’altération matérielle, donc de nullité fonctionnelle ).
C.T. – Bin, pour avoir les papiers : c’est là où la loi est floue. C’est-à-dire que… les papiers demandés pour avoir des papiers, qui sont des justifications d’être présent et travailler en France depuis des années, ne sont pas pris en compte comme la loi le dit parce qu’il y a d’autres raisons qui viennent superposer là-dessus. Il n’y a pas qu’une chose toute simple et administrative : apportez-moi vos justificatifs et vous aurez vos papiers de droit de travailler ici mais il y a une raison supplémentaire qui est une sorte de quota… ; on va trouver des raisons pour ne pas donner les papiers. Mais là, on est dans le hasard et le flou total. Il y a beaucoup de moments comme ça où on est dans le flou par rapport à la loi.
Que voulez-vous mesurer sinon la longueur ?
Une épaisseur est une longueur
Une hauteur est une longueur
Une vitesse est une longueur
Un trajet est une longueur
.
.
.
.
.
 Franck Bielsa, physicien spécialiste en métrologie au Bureau international des poids et mesures, explique au journaliste Karim El Hadj le choix de la constante de Planck pour la redéfinition du kilogramme, dans une vidéo diffusée le 12 novembre 2018 par Le Monde (lien).
Franck Bielsa, physicien spécialiste en métrologie au Bureau international des poids et mesures, explique au journaliste Karim El Hadj le choix de la constante de Planck pour la redéfinition du kilogramme, dans une vidéo diffusée le 12 novembre 2018 par Le Monde (lien).- On peut considérer « un kilo » à partir de ce que Dan Sperber appelle, dans une opposition aux savoirs sémantique et encyclopédique, un
« savoir symbolique » . Un des exemples de Sperber est la proposition E=MC2. Un groupe de locuteurs l’utilisera sur la base d’une confiance dans l’autorité garante de sa validité (l’autorité scientifique, en l’occurrence), pas sur la base d’une connaissance objective, d’un examen des preuves, d’une démonstration renouvelée. - La confiance dans l’utilisation courante de l’expression « un kilo » tient aussi, dans les termes de la célèbre thèse de Putnam de la
« division du travail linguistique » , du « stéréotype » véhiculaire, c’est-à-dire d’un « tout fait » dont la valeur d’usage est fournie par une communauté d’experts (et pas par l’or d’un sens commun issu d’une exploration permanente des critères d’extension). - « Le kilo » de l’Observatoire fonctionne encore comme le « mètre étalon de Paris » dans l’exemple de Wittgenstein
: de lui, et de lui seul, on ne peut dire ni qu’il pèse ni qu’il ne pèse pas un kilo. « Le kilo » et « un kilo » ne peuvent pas être prédicats l’un de l’autre, comme si le premier était le nom propre du second . Le vide et le plein de la référence fixe sont ceux qui servent à Wittgenstein à caractériser - la tautologie : Le kilo pèse un kilo laisse la totalité de l’espace logique (der logische Raum) à la réalité (Wirklichkeit)
; - et la contradiction : Un kilo pèse le kilo sature tout l’espace logique
.
- la tautologie : Le kilo pèse un kilo laisse la totalité de l’espace logique (der logische Raum) à la réalité (Wirklichkeit)
- Mais, dans les termes de Saul Kripke, on peut aussi considérer qu’un énoncé selon lequel « le kilo pèse un kilo à t0 » est possible (il est recevable, n’est ni tautologique ni contradictoire), à condition de distinguer :
- son « statut épistémologique » (sa modalité de dicto – relative au langage), qui est celui d’un savoir a priori (la convention suffit à considérer l’énoncé vrai, sans qu’il soit besoin de prendre quelque mesure que ce soit) ;
- et son « statut métaphysique » (sa modalité de re – relative aux choses du monde), qui est celui d’une
« vérité contingente a priori » .
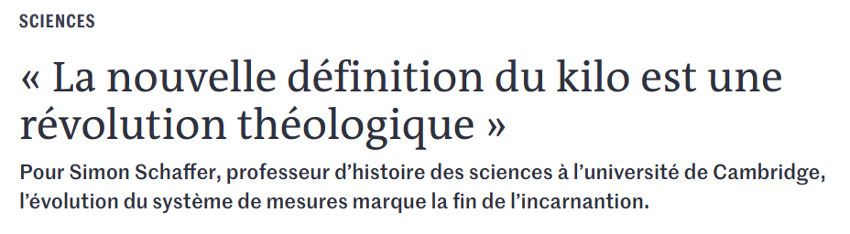 Titre et sous-titre d’un article de Nathaniel Herzberg (lemonde.fr, 12/11/2018). Jusqu’à la 26e réunion de la Conférence générale des poids et mesures, du 13 au 16 novembre 2018 à Versailles, le kilo était la dernière unité de mesure à avoir pour étalon un objet matériel (le « kilo de l’Observatoire », ou « grand K », qui a tant intrigué Tarkos). Il est désormais défini à partir de la « constante de Planck ». Dans un article, daté du 20 décembre 2018, à propos du mouvement des « Gilets jaunes », le satiriste libanais Karl Sharro, raillant le regard fréquemment porté par la presse européenne sur les événements politiques du monde arabe, note : « En dehors de France, [la nouvelle définition du kilo] fut traitée comme une historiette scientifique de plus. Mais dans les campagnes françaises, son annonce eut pour effet quasi immédiat la destruction du pouvoir représenté par Paris. L’autorité de l’ordre cartésien émanant de la capitale s’affaissa, comme un fromage vieillissant ».
Titre et sous-titre d’un article de Nathaniel Herzberg (lemonde.fr, 12/11/2018). Jusqu’à la 26e réunion de la Conférence générale des poids et mesures, du 13 au 16 novembre 2018 à Versailles, le kilo était la dernière unité de mesure à avoir pour étalon un objet matériel (le « kilo de l’Observatoire », ou « grand K », qui a tant intrigué Tarkos). Il est désormais défini à partir de la « constante de Planck ». Dans un article, daté du 20 décembre 2018, à propos du mouvement des « Gilets jaunes », le satiriste libanais Karl Sharro, raillant le regard fréquemment porté par la presse européenne sur les événements politiques du monde arabe, note : « En dehors de France, [la nouvelle définition du kilo] fut traitée comme une historiette scientifique de plus. Mais dans les campagnes françaises, son annonce eut pour effet quasi immédiat la destruction du pouvoir représenté par Paris. L’autorité de l’ordre cartésien émanant de la capitale s’affaissa, comme un fromage vieillissant ».2.1.4. Le nom
2.1.3.1. Nommer sans instituer. Dire le comment plutôt que le quoi
La France, autrefois, c'était un nom de pays ; prenons garde que ce ne soit, en 1961, le nom d’une névrose.- Ils sont comme ça, les Indiens ! (exotisme colon),
- et : C’est tout les Indiens, ça ! (ravissement touristique),
- puis : Ça c’est bien les Indiens ! (essentialisme raciste),
- et enfin : Tous pareil, ces Indiens ! (paradigme génocidaire).
- puis : Ça c’est bien les Indiens ! (essentialisme raciste),
- et : C’est tout les Indiens, ça ! (ravissement touristique),
- manières d’être spécialement Arabe, mais selon des modalités différentes que celles délimitées par l’assignation postcoloniale à l’algérianité (par exemple : un barbu en vêtements du Golfe) ;
- manières d’être pas spécialement Arabe, c’est-à-dire dire singulièrement quelconque (un touriste à Vesoul, un chômeur impénitent).
- son nom était garant d’une fixité conventionnelle (on voyait immédiatement et nettement ce qu’on voulait dire quand on disait, en France, « l’Arabe ») ;
- cette fixité conventionnelle était elle-même garante du souvenir d’un état préféré du monde (l’état d’un monde où la France est une grande puissance, dont l’idéal universel se réalise dans un empire colonial).
2.1.3.2. Le nom propre : un commun
On donne aux enfants et aux animaux, aux établissements publics et privés, aux organisations, des noms en forme de pense-bête : Lionel Jospin, Plan Quinquennal, Médecins Sans Frontières, Cour des Comptes.Toute ma vie.
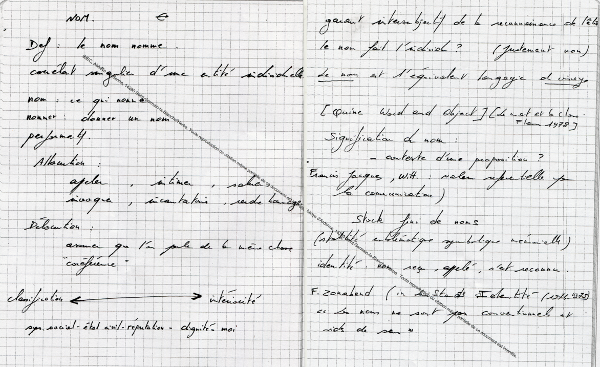 Une double-page du cahier « Process II » de Tarkos (IMEC, TRK2, ca. 1989) témoigne de lectures sur la question du nom proches de celles que nous mobilisons (philosophie analytique, philosophie du « langage ordinaire »).
Une double-page du cahier « Process II » de Tarkos (IMEC, TRK2, ca. 1989) témoigne de lectures sur la question du nom proches de celles que nous mobilisons (philosophie analytique, philosophie du « langage ordinaire »).Toute ma vie. Je ressemble au bûcheron en fer blanc des Livres d’Oz
Méconnaissable sous la rouille [rusted beyond recognition].
Je suis, Sire, un chevalier. Troublé [puzzled]
Par la façon [By the way] dont les choses arrivent sur moi et de derrière. Et finalement jusque dans ma bouche et tête et sang rouge
O, foutues choses qui cherchent à m’atteindre [to maim me]
Cette armure
Dupée
Vivante en
Elle
-Même.
[Fooled
Alive in its
Self]
Les Noms ne sont pas construits à partir de lettres au hasard.
Ils suivent des lois phonétiques nationales et régionales, et les variations de transcription.
De plus il existe un stock de Noms qui a un rôle de poids. Car les Noms théoriquement ne doivent pas varier à partir de ce stock.
(Surtout depuis qu’il n’est plus question d’une variation orale ou de transcription):
Le mieux est de prendre un nom commun ancien ou de métier, ancien.
Car la préparation à la guerre me donne le goût de l’invention.
Il s’agit de rendre les choses concrètes par l’action.
Plus les batailles s’accumulent, plus ma virginité s’étend
- Pour le moment, je suis plutôt radicale et spontanée :
si tu n’aimes pas la guerre, change de guerre.
- Par la transformation qu’elle s’est imposée (cheval, cheveux) par l’influence conjuguée de Michel et Catherine, elle, Jeanne Darc, s’est extraite, fille, d’une ancienne et plus enfantine Jeannette. C’est à présent la Jeanne soldate qui veille et surveille la gardeuse de moutons :
- Voilà pourquoi Jeanne étant fille de Jeanne, elle ne peut nommer sa fille future Jeanne sans se déposséder de sa propre partie postérieure.
- Car c’est par ce titre que bien des têtes indirectement furent coupées :
Et voilà qu’entre mes jambes ils font leur procès.
Trans. : Logothétie seconde
Les croyants et certains pratiquants s’en sortent en expliquant que la littérature (et singulièrement, le roman) nous livrerait une richesse, une complexité du monde inaccessibles autrement, et parce qu’elle le ferait (double effet, atout et ratatout) en lavant en quelque sorte le langage de tous les péchés de la communication (et de citer à ce propos la phrase de Mallarmé qui continue à laver plus blanc les mots de la tribu). La langue que parle la littérature est spéciale et, sinon supérieure et sacrée, du moins à part, voire coupée. Dans une manière d’isolationnisme esthétique, la littérature nous léguerait, immémorialement, des textes beaux et complets mais ouverts, tombés là pour nourrir l’incomplétude du lecteur et l’ouvrir, ce pécheur qui, dès le livre refermé, part traîner sa langue à tous les caniveaux.- Le philosophe parle de ne pas savoir. Dans le monde des savoirs fragmentés, son unique compétence tient dans une ingénuité critique qui constate, n’affirme rien que l’entretien, dans sa poussée dialectique, n’ait déjà rendu patent. En ce sens, il a le monopole de la question-si.
- Le poète, lui, en tant qu’il hérite du schème archaïque, parle de savoir – ce savoir répondant à un principe d’inspiration (ou de possession) que le philosophe ne lui conteste pas mais qu’il cantonne, en quelque sorte, à sa dimension révélée
: ce qu’il sait, le poète ne peut de toute façon pas en « rendre compte » .
- d’un côté, la « parole » poétique, qui affirme, proclame, institue ;
- de l’autre, le « discours » philosophique, qui articule, raisonne, objecte (c’est cette sorte de liturgie dianoétique que Tarkos doit avoir en tête quand il écrit que
« la philosophie fait la chenille » ).
- le cœur igné de la langue (où les « mots » ont gardé leur motivation d’origine),
- et son foyer de (re)création (où les « mots » prennent, par le fait d’un seul, un sens nouveau pour tous).
- On a avancé que, pour Tarkos, la poésie a moins à voir avec l’inventivité qu’avec ce qu’on peut appeler la conventivité : dans le sillage des Nominales médiévaux et des philosophies de l’ordinary language au 20e siècle, la convention y est considérée dans sa dépendance radicale à un courant de la langue. Tarkos, dans une certaine mesure, antiphrase Sartre : la poésie, c’est utiliser le langage.
- Quintane interroge également le trope moderne de l’invention, dont Ducasse a pour elle initié la critique avec ses Poésies
. Comme Ducasse, Quintane, dans une large mesure, ne trouve pas, elle « controuve » , fait avec les paroles en cours, qui pour être signées sont comme sans auteurs et dispensent, en fait de sagesse immémoriale, une science du général inapte à saisir la spécificité de ses objets. Réinvention, donc, sur la base des paroles instituées et instituantes : le nom (propre et commun), dans son actualité, est le produit des « incidences » de l’usage. L’impositio nominis dans Jeanne Darc est une reimpositio, mais pas à la manière d’une« retrempe » à la source de « l’origine » , qui doit sauver les mots de l’usure à laquelle leur emploi « commercial » les expose.
2.2. Poétique des spécialités
…les philosophes aimeraient que chaque homme soit philosophe, les économistes que chacun soit économiste, et les poètes que la poésie soit faite par tous.Introduction : Les trois critères platoniciens
2.2.1. Véridicteur ou parrêsiaste ? La vérité comme rapport
La vérité n’a de constante que sa prétention à être et cette prétention est formelle.2.2.1.1. Une vérité sans norme de véridiction
La « vérité » n’est […] pas une chose qui existerait et qu’il s’agirait de trouver, de découvrir ; mais une chose qu’il faut créer et qui fournit un nom pour un certain processus, plus encore pour une volonté de faire violence aux faits à l’infini ; introduire la vérité dans les faits, par un processus in infinitum, une détermination active, ce n’est pas la venue à la conscience d’une réalité ferme et définie par elle-même. C’est un des noms de la « volonté de puissance » […].- Le schème « didactique », de tradition platonicienne, affirme que la poésie, inutile et incertaine, quand elle n’est pas simplement trompeuse et
« complice […] de la sophistique » , n’est pas porteuse de vérité. Le schème didactique instaure un partage entre le Poème et son autre depuis le critère d’une vérité-réalité (dire ce qui n’est pas est certes possible, mais n’a aucun sens). - Le schème « classique », de tradition aristotélicienne, ne donne à la poésie ni le rôle ni la prétention de dire une vérité « cognitive ou révélante ». La poésie tire son privilège d’un autre projet, qui donne sa mesure au vrai : dire le vraisemblable
. Le schème classique instaure un partage entre la poésie et son autre depuis le critère d’une vérité-actualité (dire ce qui n’est pas, sous la forme de ce qui pourrait être, a du sens). - Le schème « romantique » considère le poème seul capable de vérité. Une formule heideggerienne donne un aperçu de ce qu’implique un tel sacre :
« En tant que mise en œuvre de la vérité [das Ins-Werk-Setzen der Wahrheit], l’art est Poème [Dichtung]. […] L’essence [das Wesen] de l’art, c’est le Poème. L’essence du Poème, c’est l’institution [Stiftung] de la vérité. » Le schème « romantique » opère un partage entre le Poème et son autre depuis le critère d’une vérité-authenticité (la vérité ne se disant pas, mais s’instaurant, aucune norme instrumentale du langage ne peut venir la juger).
- immanente (elle ne se dit pas autrement et ailleurs que dans le moment et le lieu de son « actualisation », qui est peut-être ce qui s’appelle « poème » en propre),
- singulière (dans la mesure où il n’existe pas une vérité mais des vérités),
- partielle (car une vérité est par essence incomplète, toute véridiction contenant sa tache aveugle – son « innommable »).
- un accès est possible dans toute la rigueur de la règle apophantique (« dire quelque chose » de quelque chose)
, - un usage est possible dans toute la rigueur d’une conception computative du savoir qu’il contient (« une addition d’axiomes »).
- sans le secours d’aucune loi morale, mais tenue par / contenue dans un impératif éthique (Tarkos écrit que le poème
« est l’endroit où on ne peut pas dire n’importe quoi comme ça nous arrange » ; en ce sens, « arranger les poèmes et les choses », ce serait surtout « nous arrange(r) » nous-mêmes) ; - sans le secours d’aucune norme véridictionnelle.
- le schème platonicien-didactique (a) est une « torsion » – un sale coup et un mauvais pli : Platon oppose au poème un (« super- ») poème qui ne dit pas son nom et s’excepte des « performances » ; il définit les règles du discours vrai en constituant le sien comme non-lieu du discours ;
- le schème artisotélicien-« classique » (b) est le véritable acte de légifération quant au poème, en ce qu’il règle unilatéralement le différend sans recours à l’exclusion (qui est autant un jugement qu’un non-lieu) : le poème sera excepté, et son autonomie aura l’extension de son cantonnement.
- la vérité du parrêsiaste tient à l’adéquation du discours à l’objet, un type de « conformité » qui diffère du critère épistémologique de la « correspondance » aux états de choses, en ce qu’elle nomme un rapport de congruence : toute la vérité, rien que la vérité ;
- l’exigence de vérité du parrêsiaste tient de la discipline, de l’ascèse, du dépouillement, ce qui lui donne le caractère solennel d’un serment, celui du discours intégral
parce qu’intègre, intègre parce qu’intégral.
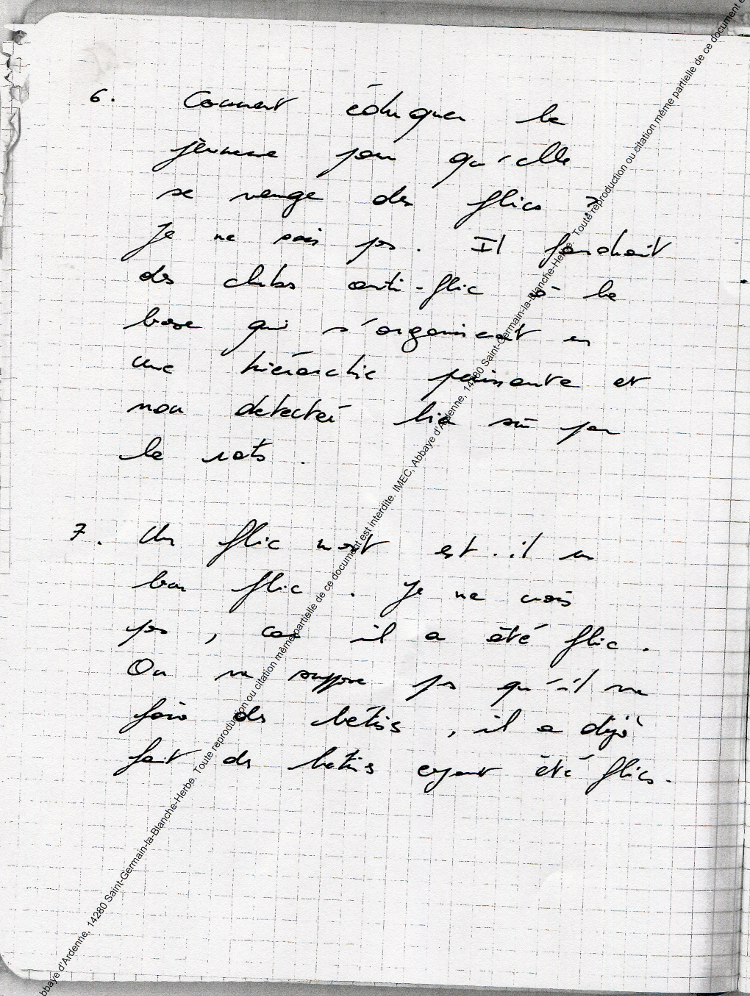 Christophe Tarkos, un jeune homme radicalisé avant Internet, écrit dans un de ses carnets (sans titre, couverture illustrée d’un monument aux morts de Compiègne et d’un paquet de cigarettes Lucky Strike, IMEC, boîte TRK3, ca. 1991) : « Comment éduquer la jeunesse pour qu’elle se venge des flics ? Je ne sais pas. Il faudrait des clubs anti-flics à la base qui s’organisent en une hiérarchie puissante et non détectée bien sûr par les rats. Un flic mort est-il un bon flic ? Je ne crois pas, car il a été flic. On ne suppose pas qu’il ne fait des bêtises ; il a déjà fait des bêtises ayant été flic. »
Christophe Tarkos, un jeune homme radicalisé avant Internet, écrit dans un de ses carnets (sans titre, couverture illustrée d’un monument aux morts de Compiègne et d’un paquet de cigarettes Lucky Strike, IMEC, boîte TRK3, ca. 1991) : « Comment éduquer la jeunesse pour qu’elle se venge des flics ? Je ne sais pas. Il faudrait des clubs anti-flics à la base qui s’organisent en une hiérarchie puissante et non détectée bien sûr par les rats. Un flic mort est-il un bon flic ? Je ne crois pas, car il a été flic. On ne suppose pas qu’il ne fait des bêtises ; il a déjà fait des bêtises ayant été flic. »L’« agonistique générale » des actes de langage (Lyotard, 1979), environnement épistémologique propice aux expérimentations et gestes éruptifs (en matière de « science » comme de poésie), et qui annonce une interrogation sur la valeur d’échange des « phrases » après le linguistic turn et la chute des normes transcendantes de légitimation commune. - Le fameux « dissensus » ranciérien, cette « organisation du sensible » littérale et pluraliste qui forme le lieu, agonistique lui aussi, où « n’importe qui », le tout venant des « hommes sans qualités », vient contester
« la distribution des capacités et incapacités » .
- Empruntant au schème « didactique » (a), il affirme qu’on ne peut effectivement pas dire ce qui est, ne serait-ce que parce qu’on ne peut pas dire tout ce qui est (deuil d’un discours de la totalité : le jeu postmoderne ne compte pas les points).
- Empruntant au schème « romantique » (c), il déclare qu’aucune norme de vérité ne s’appliquera a priori (fin d’une légalité transcendante des discours : le jeu postmoderne ne permet pas qu’on l’arrête pour s’en déclarer vainqueur).
- Empruntant au schème « classique » (b), il acte de la permanence des enjeux éthiques (ou thérapeutiques
), moins en vertu d’une puissance poétique à troubler la vérité historique que d’une mesure immanente des discours (le jeu postmoderne n’exclut pas sceptiquement le critère de vérité ; il en fait simplement un rapport plutôt qu’une norme).
2.2.1.2. « On pourrait tout dire… »
L’effet apparent de vérité qui vient jouer dans le sophisme est en réalité un lien quasi juridique entre un événement discursif et un sujet parlant. De là, le fait qu’on trouve chez les Sophistes les deux thèses : Tout est vrai (dès que tu dis quelque chose, c’est de l’être). Rien n’est vrai (tu as beau employer des mots, ils ne disent jamais l’être).J’existe. Évidemment cela ne prouve rien. Cela ne prouve pas que j’existe. Mais je suis là. Et je ne suis pas fou. Je suis un vrai témoin, je suis capable de dire la vérité telle qu’elle me semble, je peux témoigner.
- « Nous pourrions tout dire d’un caillou » = nous pourrions épuiser le prédicable « caillou » (tout = totus, la totalité) ;
- « Nous pourrions tout dire d’un caillou » = nous pourrions dire n’importe quoi
d’un caillou (tout = quodlibet, le quelconque).
- L’objet d’une velléité définitionnelle, dans les limites de la totalité supposée (tout ce qu’on prédiquera du caillou rejoindra le « sac » de prédicabilité du caillou – pour mobiliser une forme tarkossienne
). - L’objet d’une variation potentiellement infinie, d’un travail d’
« indéfinition » dans un monde radicalement pluraliste à la structure « additive », où tout prédicat« traîne un et qui l[e] prolonge » (il reste toujours quelque chose à dire du caillou).
- une intuition quant à la variabilité des appréciations sur l’échelle caillou - pierre,
- et une convention qui admet le caractère réducteur (ou « limité ») des deux termes-positions (« pierre » et « caillou ») au regard de la diversité du monde (en l’occurrence, la diversité des formations minérales).
- les velléités du parrêsiaste sont « modales » (ses deux seules « positions » sont tout-dire ou ne-rien-dire, comme ouverte et fermée pour une porte),
- et les objets du monde sont « flous » (on pourrait donc décréter à tout moment en avoir tout dit, et on pourrait décider, à tout moment également, qu’il y a encore tout à en dire).
- une forme idéale : le caillou est par excellence celle du particulier, de l’unité individuelle, de l’être isolable et comptable parce que bien « rond », bien contouré, précisément délimité ;
- et un symbole : le caillou est une image naïve, parce que « matérielle », du token comptable mais à valeur propre, de la pièce de monnaie.
- Un homéomère est un étant constitué de parties semblables. Lorsqu’il est brisé, un homéomère distribue ses propriétés essentielles, de sorte qu’1x/2 = 2x. Exemple : Un caillou. Tu le brises. Il y a (au moins) deux cailloux.
- Un anhoméomère est un étant constitué de parties dissemblables. Lorsqu’il est brisé, un anhoméomère ne distribue pas ses propriétés essentielles, et ne les conserve dans aucune des parties obtenues, de sorte que 1x/2 = x-brisé + non-x. Exemple : Un humain. Tu le brises. Il n’y a pas deux humains.
C.T. – Oui, c’est pour ça que ce n’est pas une vérité absolue. C’est plutôt la vari/ la var/ la vérit/ la variété…, la variété matérielle de l’imprimé.
- d’une condition poétique commune où les façons de dire sont au « futur antérieur » (Lyotard) des velléités à dire,
- d’une condition épistémologique commune où les « vérités [sont] plurielles et analogiques » (Veyne
).
2.2.2. Licencieux ou strict-parleur ? Le discours constituant
Partout raideur et entrave, langage alambiqué, néologismes et maniérisme, tonalité infantile, incohérence, stéréotypes, allitérations vaines, mots bouche-trous et rajouts banals ; le sens du style, de la distinction entre langage poétique et idiome courant, a complètement disparu chez le poète, des formules vides se sont substituées à des notions claires.2.2.2.1. Rien d’innocent
Le réel raconté dicte interminablement ce qu’il faut croire et ce qu’il faut faire. […] Cette institution du réel est la forme la plus visible de notre dogmatique contemporaine.- Prémisse majeure : L’expérience du monde n’est jamais « une expérience de la clarté » mais celle d’un « chaos, d’une opacité »,
« une expérience de l’absence de sens » . - Prémisse mineure : La littérature véritable, dont la poésie est la pointe
, est le mode d’exploration par excellence de « l’absence de sens », tout entier adverse à « la positivité des énoncés » communicants, théorisants, informatifs. - Reprise et conclusion :
« Si le monde est clair, l’expérience simple et la vie lisible, il n’y a pas d’œuvre d’art […]. Il y a donc une fatalité de l’illisibilité dans toute œuvre d’art » .
- D’une part, Tarkos affirme que tout est déjà très clair, mais cette clarté acquise concerne essentiellement ce qu’il « faut faire » pour produire un effet certain, obtenir un résultat précis, accorder une pratique à un corpus technique. Ce qui est clair, en somme, ce sont les énoncés prescriptifs donnés pour descriptifs.
Je crois que toutes les choses sont bien dites, très clairement, elles sont très bien écrites, très clairement. Il y a une foule de gens qui sont là pour expliquer des choses qui sont déjà très claires, et peut-être il n’y a pas le besoin d’y ajouter. D’ailleurs, c’est bizarre, parce que cette volonté de vouloir entendre quelque chose de clair, ça me paraît toujours étrange dans le sens où j’ai l’impression que ça existe déjà, qu’il y a déjà suffisamment de clarté. Par exemple, dans les livres de cuisine, dans les livres de jardinage. On explique très clairement ce qu’il faut faire ! - D’autre part, Tarkos déclare
« essaye[r] […] de dire les choses très clairement et de dire des choses très importantes le plus clairement possible pour que ça fasse un effet, un effet important, une mention importante, un effet vital ! » Cette clarté-là soumet la question du sens à celle de l’efficacité, mais une efficacité – que Quintane disait « sociale » et que Tarkos dit « vitale » – qui n’est pas nécessairement braquée sur un effet déterminé chargé de « rendre compte » du réel. Elle désigne plutôt, après Prigent cette fois, la clarté opératoire d’un piège littéral, qui ne se cache pas comme truc, machine, dispositif, et expose même son fonctionnement. Cette clarté-là évoque l’efficace des énoncés de « l’hypnotiseur », figure chère à Tarkos.
- En régime littéraire marchand, où la réification relaie la sacralisation, la clarté comme critère d’évaluation rétrospectif est réduit à une norme de lisibilité établie par le rapport entre ce que ça dit et ce que ça veut dire, et maintenue dans l’oblitération du rapport entre ce que ça décrit et ce que ça prescrit.
- En matière de littérature, et spécialement de poésie, se perpétue un paradigme religieux de la lecture selon lequel il y a des sens seconds ou cachés, et globalement plus à lire (saisir) ou moins à lire (sentir) que ce qui est écrit.
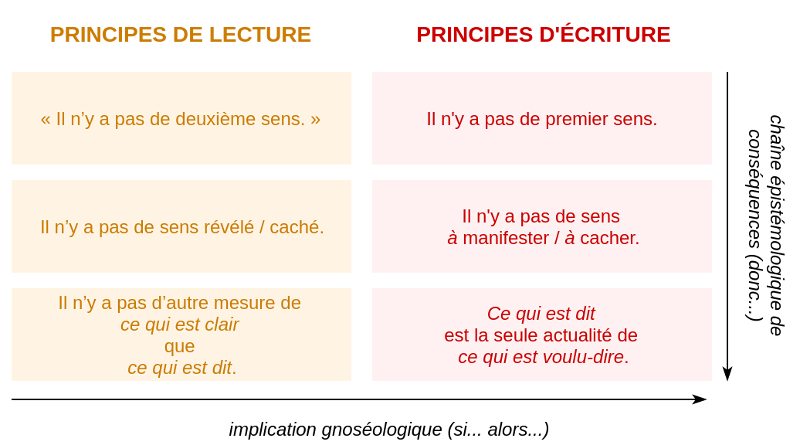 Espace contractuel de la littérature en régime séculier
Espace contractuel de la littérature en régime séculier2.2.2.2. Il n’y a rien à dire, il n’y a qu'à dire
Il n’y a pas de langue ordonnée silencieuse. C’est, en somme, déjà mélangé.« la pensée n’est pas un empire dans l’empire de la langue, mais l’avance que le langage prend sur lui-même » ;- la clarté n’est pas la propriété d’une phrase bien conçue mais un événement de sa conception – événement bavard ou pas, mais de
« surface », où sont « déployées, mises à plat les possibilités du langage » .
- la sensibilité ordinaire : éprouver de manière conséquente qu’on ne sait pas ce qu’on va dire ;
- et la plus radicale des éthiques scientifiques : ne pas soumettre la recherche à des questions préposées.
- élaborer un discours, c’est to address, c’est-à-dire s’adresser à quelqu’un et traiter une question ou un problème, ce que synthétise l’expression d’Antin : « dialoguer avec une idée avec » quelqu’un
. Une telle modalité trouble la définition simple du « monologue » pour la réconcilier avec le « dialogue intérieur » (Wittgenstein) ; - « parler pour découvrir » est le genre discursif de la subjectivation
; - élaborer un discours, c’est
« penser à ce qu[’on va] penser » , et expérimenter la récursivité de parler et penser, plutôt que l’inquiétude d’une fidélité du parler au pensé ; - l’élaboration du discours est un « accordage » (tuning) entre la nécessité de dire et le rien (de spécial) à dire, où rien n’est effaçable mais tout est amendable
.
2.2.3. Utile ? Inutile ? « Il faut changer de question(s) »
Derrière un sens, déceler une constellation filamenteuse de rapports sociaux. Qui dit cela ? À qui ? Quand ? Où ? Pourquoi ? C’est alors que les énoncés sont des actes, des déclencheurs. Et qu’un énoncé peut, circonstanciellement, viser, et tuer. Ou plus communément : faire sens.2.2.3.1. « Supérieurement in/utile ». Idéalismes platonicien et anti-platonicien
La poésie est le foyer de résistance de la langue vivante contre la langue consommée, réduite, univoque.| Utilité (ôphelia [ὠφέλια]) | Mutilité | |
| physique / général | accroissement de la puissance |
diminution de la puissance |
| polémologique | avantage gagné |
dommage subi, avarie |
| moral / légal | bénéfice |
préjudice |
| pharmacologique (moyen) | douleur nécessaire |
plaisir facile et fugace |
| thérapeutique (effet) | bien, bienfait |
mal, méfait |
| épistémologique | profitabilité du savoir particulier dans la computation générale des savoirs | usage dépensier de la parole, dupli- / multiplicité |
| politique / rhétorique | contribution à la situabilité des discours |
séduction par l’agréable, le flatteur (biais sophistique / rhétorique) |
| civique | participation au « bien » commun | tort fait au bien commun |
- Dans le monde de la profitabilité intégrale, la poésie est « sans prix », comme la rose « sans pourquoi » ; elle est inestimable.
- Dans le monde de la marchandise, la poésie échappe par sa rareté supérieure au système de la rareté comptable ; elle est inépuisable.
- Dans le monde de la comptabilité-accomptabilité
, elle a la grâce et la gratuité de ce qui passe et qui pousse (un coucher de soleil, une rose) sans répondre de soi ; elle témoigne sans comparaître.
 Des manifestants transforment du mobilier de chantier et des cailloux en armes par destination, à Marseille, le 1er décembre 2018.
Des manifestants transforment du mobilier de chantier et des cailloux en armes par destination, à Marseille, le 1er décembre 2018. Lorsque, en décembre 2016, un homme a recouvert Manuel Valls de farine, les avocats de l’ancien Premier Ministre ont envisagé de demander la qualification de la farine comme « arme par destination ».
Lorsque, en décembre 2016, un homme a recouvert Manuel Valls de farine, les avocats de l’ancien Premier Ministre ont envisagé de demander la qualification de la farine comme « arme par destination ».- Dans « effet de réel » (reality-effect, Realitätseffket), le terme indique une conséquence interne : l’effectivité, dans la lecture, d’une indication mimétique. Le « réel » est identifié, reconnu, à l’aune d’un monde-référence, et évalué depuis le critère de vérité-fidélité à cette référence (
« ce qui est […] ou a été » ). - Dans « effet social », il indique une conséquence externe : l’effectuation de la lecture outre la lecture – qu’il s’agisse d’une incidence (social impact), ou d’une activation (soziale Auswirkung). L’effet est vérifié ou attesté à l’aune d’un monde-circonstance (c’est ce dont le vague de l’adjectif « social » semble tenir le lieu), et depuis le critère de félicité-performance (au sens austinien : accomplissement relatif à un projet ou une intention, ou réalisation d’un état de fait dans la rencontre avec un monde institué).
2.2.3.2. Différence de nature, différence d’usage. L'économie sophistique des discours
[L]a sophistique n’est pas seulement le pavé qui casse les vitrines de la régulation philosophique du langage ; ou alors il faut singulièrement réévaluer le sens, l’intérêt, l’impact de la casse.- dire une vérité qui ne soit pas vérité légale ou « vérité du monde » (à la fois fidélité au monde et probation de ce monde), mais vérité d’un rapport
; - dire depuis ne pas savoir ce qu’on va dire, « parler pour [le] découvrir » (Antin)
.
- tout le monde est au même régime du discours ;
- tout le monde fait des
« super-poèmes » (Tarkos) ; - « parler pour parler » est une condition commune.
| Anciennes questions | Questions changées | |
| Nature | Qu’est-ce que c’est ? | ✕ |
| Provenance | ✕ | |
| Fonctionnement | Comment c’est fait ? | Comment ça (se) fait ? |
| Effet | Qu’est-ce que ça fait au texte / à la langue ? (« effet de réel ») |
Qu’est-ce que ça fait au monde ? (« effet social ») |
| Destination | À quoi ça sert ? À quel besoin ça correspond ? (questions de l’utilité) |
« Qu’est-ce qu’on peut en faire ? » (« question de la valeur d’usage ») |
- est une question d’usager·e, d’utilisateur·ice
, de lecteur·rice (focale inversée par rapport à la traditionnelle question de l’engagement : que faire ?) ; - modifie le sens de faire, traditionnellement aimanté, en poésie, par l’étymon poiein (qui désigne, notamment dans son opposition à prassein chez Aristote
, l’action de fabriquer, d’ajouter quelque chose au monde) ; - transforme en auxiliaire le verbe pouvoir, qui dans la version intransitive de Prigent (« que peut la poésie ? ») servait à poser la question d’une puissance propre de la poésie.
- ce qui est hors d’usage (vieux livres, vieilles radios, vieux tout court, chat mort), ou ce à quoi on ne trouve plus sens/destination (ma vie, mon temps libre, mes olives) ;
- ce dont on dispose en abondance, voire en excès (déchets, argent) ;
 Dans 2001, l’odyssée de l’espace (Stanley Kubrick, 1968), une scène montre un singe trouvant pour la première fois une destination à un élément de carcasse ; son usage le mènera de la première chasse armée au premier meurtre.
Dans 2001, l’odyssée de l’espace (Stanley Kubrick, 1968), une scène montre un singe trouvant pour la première fois une destination à un élément de carcasse ; son usage le mènera de la première chasse armée au premier meurtre.Trans. : « Au nom d’un nom qui manque »
Il nous faut la [poésie] afin de retrouver l’apaisement qui nous manque dans ce climat de crise qui caractérise l’époque actuelle. Notre époque est une époque de bouleversements, et la [poésie] nous équilibre en nous apportant la paix. Car la paix est nécessaire pour équilibrer notre énergie déployée à résoudre les problèmes que nous pose cette époque de crise. Et dans cette époque, où l’homme bouleverse tout, il est indispensable que nous retrouvions, dans la [poésie], les éléments nécessaires à la récupération de notre énergie ; l’énergie calme et sereine de la [poésie] nous aide ainsi à retrouver la sérénité qui nous manque dans l’époque que nous traversons. Car, il est vrai que la [poésie] nous apaise.- ni à un retournement des termes platoniciens de l’exclusion (la poésie serait vérité révélante, obscurité ou opacité mieux fidèles à la complexité du réel ou au tumulte de l’expérience, « supérieure » in/utilité),
- ni à une absence de normes discursives qui ferait de la poésie un discours « libéré », affranchi de toute exigence véhiculaire.
- Devant la vérité, tout discours est a priori illégitime. Il constitue sa propre mesure en se faisant (on retrouve une dimension de la polysémie de logos : « ratio et oratio »), et ne saurait être évalué depuis un critère légal de correspondance aux états de choses
. - En matière de clarté, ce qui est dit (pu-dire) étant la seule actualité de ce qui est voulu-dire, tout discours est nécessairement clair ; pas au sens d’une transparence aux intentions mais d’une clarté opératoire (tout discours fait ce qu’il dit et dit ce qu’il fait). Tout le monde est susceptible de « parler pour découvrir » ce qu’il pense (Antin), et aucune loi ne permet a priori d’évaluer le degré de fidélité à « la pensée ». Dans ce modèle, la poésie ne s’oppose ni à la technicité philosophique ni au « langage ordinaire », mais aux discours qui ont une intention constituée, c’est-à-dire un « sens », une « émotion », un
« état d’esprit […] particuliers » à « partager » . - À la lumière des textes de notre corpus, la question de l’utilité a paru spécialement mal posée. Rien n’étant utile par nature, la véritable question, pour sortir du schéma licencieux du « tout entier le contraire » (Quintane lisant Bataille), est celle de la destination ou de l’usage, que l’économie sophistique du discours nous a permis de mieux concevoir, notamment dans l’opposition de la notion de khrêsis à la vertu platonicienne de l’ôphelia
.
- D’abord, « s’autoriser de… » ne signifie pas « être autorisé par… » mais « s’appuyer de… », « se soutenir de… », idée dont tient lieu le suffixe grec -phore repris par Tarkos dans le « Manifeste chou » : les « lois des phores » ne règnent plus, ne règlent plus ; tout discours n’en reste pas moins audible à la seule mesure du boucan dans ce qu’on a pu appeler le casino des discours.
- Ensuite, Lacan lui-même complète son propos polémique :
« le psychanalyste ne s’autorise que de lui-même… et de quelques autres » . Ces « quelques autres » sont, a priori, indéterminés, illégitimes, il-légaux.
2.3. La condition séculière
Introduction : Nostalgie du sacré
Le poète existait dans l’homme des cavernes, il existera dans l’homme des âges atomiques parce qu’il est part irréductible de l’homme. De l’exigence poétique, exigence spirituelle, sont nées les religions elles-mêmes, et par la grâce poétique, l’étincelle du divin vit à jamais dans le silex humain.| clérical | La sécularisation est le transfert graduel de prérogatives du domaine religieux au domaine laïque, fondant un régime de sens plus instable, une autorité moins légitime et un récit des origines moins cohérent avec l’ordre immuable qui continue de les régir |
La poésie participe de cette expropriation du théologique ; elle assume sa mission spécifique dans l’ordre intact des « désirs », « besoins », « aspirations » anthropologiques. Elle conquiert une autonomie endeuillée, rêvant un état infra-historique (« primitif », « naïf ») où le langage n’était pas distance réflexive ou « privation » « conceptuelle », mais véhicule immédiat de l’expérience ou expression spontanée d’un savoir total |
| doctrinal | La sécularisation est dépossession, relégation ou assignation de « l’élément transcendant », et recherche de lois universelles de légitimité, de subsistance et de reproduction qui ne défèrent pas à la raison théologique (causes, fondements, fins). | La poésie revendique son privilège archaïque d’une ligne directe avec la transcendance, tout en substituant au « nom » du transcendant des vocables laïques « aux noms desquels » parler – ce que nous avons appelé après Quintane des alogons |
| spirituel | La sécularisation correspond à un « oubli de la transcendance » à l’origine d’un « désenchantement du monde » |
La poésie peut « réenchanter le monde » en prenant le relais de questionnements dont la religion, sous sa forme dégradée, n’a pas suspendu l’angoisse. Elle substitue à la clôture du monde révélé une autre forme d’orbe, la |
- L’émancipation vis-à-vis du domaine religieux : autonomie, spécialisation, professionnalisation des anciennes « fonctions » de l’ordre sacré, autrefois liées entre elles et tenues dans l’orbe du monde révélé. Ce mouvement inaugure l’ère des rationalités plurielles, ou chaque discipline constitue un rapport au monde, une intelligence spécifique. Mais une telle sécularité bientôt reproduit les sécurités discursives et les clergés qui vont avec – la division du travail et l’inégalité des intelligences, par exemple, se trouvent rejustifiées selon un type d’argument voisin de ceux mobilisés par la raison théologique (déterminisme de la génétique dans son usage vulgaire, ingénierie sociale au service d’une répartition prométhéenne en « types d’hommes »).
- Au-delà, il y aurait une sécularisation à « poursuivre » dialectiquement, dans le travail d’une déprise du transcendant en reste dans le cantonnement disciplinaire. Les deux pratiques issues du modèle sapientiel antique – la philosophie et la poésie – seraient concernées au premier chef par ce mouvement : leur exception sacrée s’étant muée en spécialité laïque, conservant dans la conversion une partie des anciennes prérogatives, il s’agirait de quitter l’une et l’autre comme « milieux » autonomes, de les retrouver comme discours derrière le mythème défraîchi de la parole instituée/instituante, inspirée/inspirante, et de les tenir pour tels dans le « Qual des Kampfes ».
2.3.1. Supérieurement, authentiquement
J’ai besoin du magma poétique, mais c’est pour m’en débarrasser.2.3.1.1. Le poétique, valeur sublime
Grandeur, ineffable, lenteur, solennité, oraculation, beauté. Ces poètes s’emploient à redéfinir le fait que le poète est un personnage supérieur qui parle nettement au-dessus des frondaisons, là où souffle un vent sans accrocs. Ils sont tous sortis de la cuisse de Perse. Ce qui est un tout petit peu au-dessus de la cheville ; ou ils ne cessent de jouer au Grand Tout de l’Univers. Ce qui est évidemment trop pour une cheville ou une cuisse.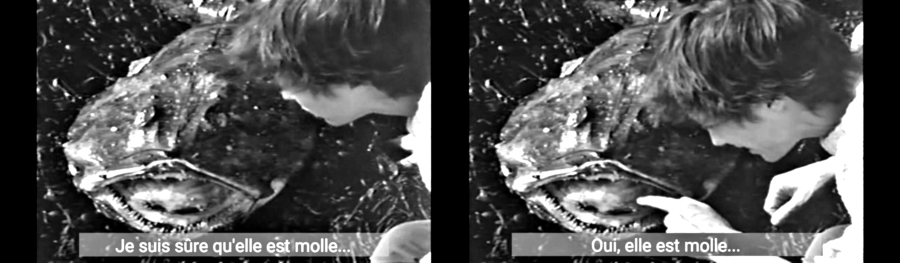 La volupté de confirmation. Photogrammes du film Kung-fu master (ou : Le petit amour) d’Agnès Varda (1988)
La volupté de confirmation. Photogrammes du film Kung-fu master (ou : Le petit amour) d’Agnès Varda (1988)2.3.1.2. Si tout est poétique…
Si on considère l’humanité dans son ensemble et dans les siècles des siècles, c’est sûr qu’on est à peu près tous en quête d’une « place pour l’authentique » […] – quand on emploie les gros mots, on est sûr de tomber juste.Tout. Tout en travaillant inconsciemment jette ses poèmes.
[…]
Les poèmes sont tout faits.
Alors le poète ne prend pas les poèmes, il trie…
Le poète regarde et doit prendre, il choisit, il a regardé, il voit la réalité. Il veut (voudra) faire un poème avec ce qui est réel.
Il trie ce qui est poétique et ce qui est vrai pour faire un poème.
Le poète voit ce qui est poétique. Cela (ne sera pas) n’est pas assez vrai pour faire un poème.
Il faudra le laisser et continuer à chercher ce qui est vrai.
- Si la vie prodigue a l’exclusivité du poiein,
- « alors le poète » n’ajoutera rien au monde ; il se contentera de trier – et il faudrait entendre, dans ce verbe, un concentré des sens du lego latin et du legein
grec : cueillir, ramasser, passer en revue, rassembler, choisir, sérier des mots ou des énoncés pour ne garder que ceux dont la valeur est trouble, le sens incertain, l’authenticité douteuse.
- « alors le poète » n’ajoutera rien au monde ; il se contentera de trier – et il faudrait entendre, dans ce verbe, un concentré des sens du lego latin et du legein
- Si le poétique est une valeur universellement attribuée, émise continûment par l’instance transcendante de la « vie »,
- « alors le poète » a pour objet ce qui court dans le monde et s’est déprécié dans ce cours,
« ce qui n’est plus de la poésie » , ce qui a perdu sa valeur d’émission, ce qui se correspond mal et répond mal de soi, ce qui ne porte plus la marque originale de sa frappe.
- « alors le poète » a pour objet ce qui court dans le monde et s’est déprécié dans ce cours,
- Si « la vie » est porteuse d’une positivité absolue,
- « alors le poète » préférera à ce qui est « poétique » – valeur instituée – ce qui a chuté dans le cours des valeurs relatives, susceptibles de « vrai » donc de faux, et d’une
« honnêteté » jamais assurée de n’être pas accotée à des « malversations » .
- « alors le poète » préférera à ce qui est « poétique » – valeur instituée – ce qui a chuté dans le cours des valeurs relatives, susceptibles de « vrai » donc de faux, et d’une
2.3.2. Séculariser les Muses
L’authentique, c’est un collage de réel.Il suffit d’être inspiré, et les choses vont toutes seules. Je voudrais bien qu’il en fût ainsi. La vie serait supportable. Accueillons, toutefois, cette réponse naïve, mais examinons-en les conséquences.
Celui qui s’en contente, il lui faut consentir ou bien que la production poétique est un pur effet du hasard, ou bien qu’elle procède d’une sorte de communication surnaturelle ; l’une et l’autre hypothèse réduisent le poète à un rôle misérablement passif. Elles font de lui ou une sorte d’urne en laquelle des millions de billes sont agitées, ou une table parlante dans laquelle un esprit se loge. Table ou cuvette, en somme, mais point un dieu, – le contraire d’un dieu, le contraire d’un Moi.
Et le malheureux auteur, qui n’est donc plus auteur, mais signataire, et responsable comme un gérant de journal, le voici contraint de se dire : « Dans tes ouvrages, cher poète, ce qui est bon n’est pas de toi, ce qui est mauvais t’appartient sans conteste. »:
Il est étrange que plus d’un poète se soit contenté, – à moins qu’il ne se soit enorgueilli, – de n’être qu’un instrument, un médium momentané.
2.3.2.1. De l’expérience authentique à l’existence authentique. La « théo-linguistique » de Heidegger
La poésie est plus que l’art de faire des poèmes, elle […] égale l’habiter primordial ; l’homme n’habite que lorsque les poètes sont.Eigen-. Le réseau sémantique de eigen- dit la solidarité de l’authentique, de l’original, du propriétaire et du nécessaire
Stimm-. Dans un monde où l’élection domine« appropriés » . Le poème accompli est la validation de cet être bien « fondé » (autre sens de stiften), la vérification dans le monde d’une résonance fondamentale entre une tonalité de l’âme (Stimmung) et une voix (Stimme)
Heil-. Le radical heil- est en charge d’une autre affinité, celle du sacré et du salut. Et c’est encore « der Dichter » qui, héritier d’un privilège archaïque conjecturé, est en charge de cette compacité précieuse à la communauté« événement du sacré » (Ereignis des Heiligen – où Ereignis rejoue le morphème eigen-, d’une façon qui désempare toute autre langue que l’allemand). L’eschatologie de Heidegger est tout entière indexée sur cette idée d’un monde en « crise », d’une inauthenticité du présent historique privé de la « parole » (das Wort, dont le double sens est mis à profit dans la « théo-linguistique » : il tient lieu du « mot » hypostasié et du souvenir de la voix archaïque, profondément religieuse). C’est logiquement que cette eschatologie se tourne vers le passé d’un monde intact, préservé, non encore vicié (die heile Welt, en allemand ordinaire) ou vers le futur grandiose qui ne se laisse dire et penser que dans les termes du destin.
Schick-. L’eschatologie heideggerienne s’organise autour du morphème schick- (envoi, envoy-), qui fait converger le destin, la destinée, le sort vécu, le lot reçu (Schicksal, Geschick, Schickung
Ion – La différence est grande, Socrate ! et il est bien plus beau de passer pour un homme divin .
Socrate – Eh bien, nous te l’accordons, ce titre plus beau, Ion, d’être par une inspiration divine et non en vertu d’un métier, le panégyriste d’Homère.
2.3.2.2. Dire « ce qui transite ». Le cours et les discours
Des poèmes qui suivraient la dictée de la langue elle-même [?] Ça me semble absurde. La langue fait partie des meubles de la chambre. La langue n’est rien en soi. C’est quelque chose qui est dans l’esprit du poète, et que le parasite (le poème) envahit.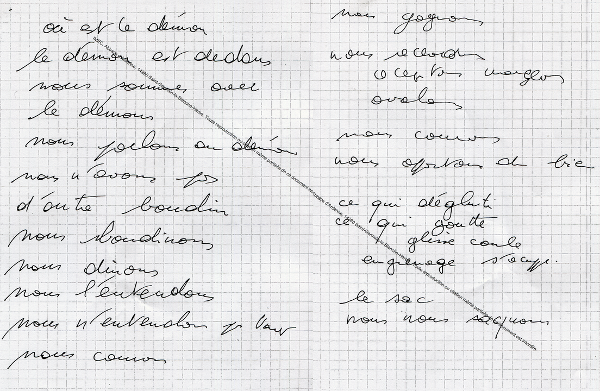 Dans les cahiers déposés à l’IMEC (ici : fonds TRK14), les motifs du « démon », du « monde magique », et les anaphores au « nous », sont presque systématiquement associés.
Dans les cahiers déposés à l’IMEC (ici : fonds TRK14), les motifs du « démon », du « monde magique », et les anaphores au « nous », sont presque systématiquement associés.
Les énoncés de « Gonfle » dans un ordre random (Ma Pomme, 2019)
- met sur le même plan les événements du passé, du présent et du futur
; - est également susceptible de dire le vrai et le faux
.
Spicer – Par hasard ? Voyons voir… Est-ce que, si tu allumes la radio maintenant, tu dirais que c’est juste par hasard si les mots sont en anglais et pas en albanais ?
Alors là, je dois dire qu’il y a tout de même un saut, car, comment peut-on passer de : je ne sais pas d’où ça vient (i.e. Je ne m’en soucie guère/Marchand de pommes de terre) à : prenons une position heideggérienne (au hasard, tiens, je prends une position heideggérienne, ou encore : bah, pourquoi ne pas prendre une position heideggérienne ? i.e. ça ne mange pas de pain, etc. – tout ça dans le however). Or, Spicer n’a pas ne serait-ce qu’évoqué une position heideggérienne, et il n’a pas non plus dit rien […]
2.3.3. Faire l’expérience. Principes d’une expérimentalité exotérique
Changement de paradigme = changement de position (place) : non plus le surplomb de la Grande Langue Poétique mais la mise à niveau. Une langue de locataire.2.3.3.1. Essais de « places »
La société est composée d’absolument personne – tous en habit.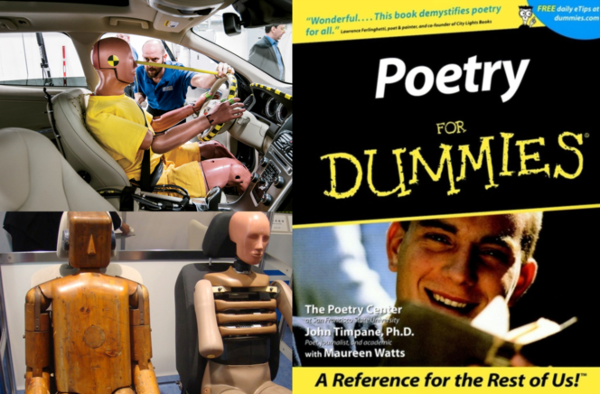 Un « crash test dummy » – en français : mannequin d’essai de choc ou dispositif anthropomorphe d’essai, et familièrement : fantôme – est une réplique d’être humain à taille réelle, utilisée pour enregistrer des informations concernant les accidents et perfectionner, dans l’industrie des véhicules, les protections contre ces chocs. « Dummy », en anglais, signifie à la fois : mannequin, homme de paille, et idiot, comme le rappelle le titre de la célèbre collection « … for dummies » (« ... pour les nuls », en France), sous-titrée : « a reference for the rest of us » (« une référence pour nous les manants »). « Dummy », comme adjectif, est aussi associé à la facticité, à la feinte, au piège.
Un « crash test dummy » – en français : mannequin d’essai de choc ou dispositif anthropomorphe d’essai, et familièrement : fantôme – est une réplique d’être humain à taille réelle, utilisée pour enregistrer des informations concernant les accidents et perfectionner, dans l’industrie des véhicules, les protections contre ces chocs. « Dummy », en anglais, signifie à la fois : mannequin, homme de paille, et idiot, comme le rappelle le titre de la célèbre collection « … for dummies » (« ... pour les nuls », en France), sous-titrée : « a reference for the rest of us » (« une référence pour nous les manants »). « Dummy », comme adjectif, est aussi associé à la facticité, à la feinte, au piège.- mannequin d’essai de choc,
- dispositif anthropomorphe d’essai,
- fantôme,
- homme de paille pour sorties de route,
- prête-nom pour expérience intense,
- idiot de collision expérimentale,
- andouille d’essai fracassant.
- un corpus de phrases sentencieuses, autoritaires, définitives, qui jouent d’une intimidation de la capacité de juger (premier fascicule) ;
- un corpus comparable, dont les phrases procèdent d’une réécriture de maximes de moralistes français des 17e et 18e siècles – mais aussi de phrases de poètes (Dante, Shakespeare, Lamartine, Hugo, Baudelaire), ainsi que de certains passages des Chants de Maldoror (second fascicule).
- à celle de l’honnête homme, au maître de sa raison et de ses sens, supérieurement capable de discernement ;
- à celle du maître – professeur ou démiurge – distribuant les prix, partageant les gloires, sauvant ou damnant tels auteurs, prenant à part et corrigeant tels autres
, à commencer par celui des Chants, cet ancien testament.
- d’une part, parce que l’inspiration des Poésies –
« trépied raisonnable » – ressemble à un simple renversement de la fureur des Chants –« trépied désordonné » (Poésies, I) ; - d’autre part, parce que la réécriture des maximes est presque systématique (elles sont niées, inversées, radicalement contrariées), donnant l’impression, plus que d’une sincère profession de foi, d’un protocole méthodiquement vandale (Poésies, II).
- un je « cobaye » ou « hameçon », sujet/objet d’expériences, d’observations, de
« réactions » ; - un je
« intermédiaire » ou« général » (puisque« il n’y a pas de passé personnel pur, et [qu’]il est possible que le seul passé dont je puisse vraiment faire l’expérience soit le passé commun » ), et qui est une sorte de je potentiel tapi dans le je actuel; - un je qui trouve l’occasion de son propos dans une affection (
« particulièrement défigurant[e] » ou spécialement dévastatrice, en tout cas par laquelle il est possible qu’on ne se reconnaisse plus) ; - un je-coordonnées, sujet/objet hypothétique n’existant que dans le cadre de rapports posés par l’expérience, supposés par un théorème, inscrits dans une équation
.
 De nombreux blogs, dans les années 2005, étaient consacrés à la comparaison des photos figurant sur les boîtes de plats préparés (« suggestions de présentation ») et de l’aspect réel du contenu de ces boîtes.
De nombreux blogs, dans les années 2005, étaient consacrés à la comparaison des photos figurant sur les boîtes de plats préparés (« suggestions de présentation ») et de l’aspect réel du contenu de ces boîtes. « How to basic » est le nom d’une chaîne Youtube qui publie des tutoriels pratiques pour cuisiner rapidement (ici, la recette d’une « pizza goût cheeseburger »). La plupart des vidéos donne à voir une débauche de plus-ou-moins-ingrédients projetés sur une table, résultant en un « plat » – littéralement, si par là on entend une « mise à plat ». (Lien)
« How to basic » est le nom d’une chaîne Youtube qui publie des tutoriels pratiques pour cuisiner rapidement (ici, la recette d’une « pizza goût cheeseburger »). La plupart des vidéos donne à voir une débauche de plus-ou-moins-ingrédients projetés sur une table, résultant en un « plat » – littéralement, si par là on entend une « mise à plat ». (Lien)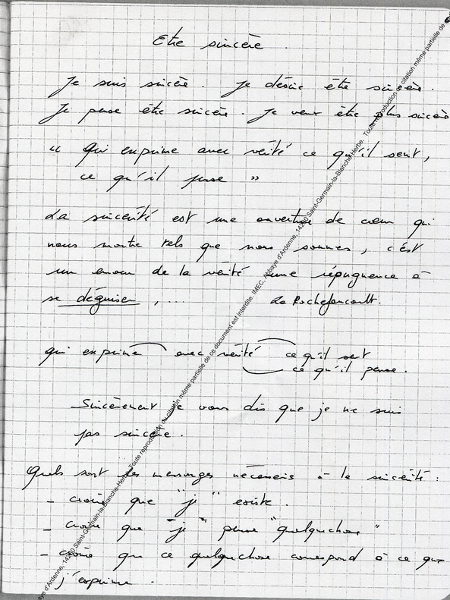 Sur une page du carnet intitulé « Réflexions » (IMEC, TRK5, ca. 1988), Tarkos écrit : « Je suis sincère. Je désire être sincère. Je pense être sincère. Je veux être sincère. […] Sincèrement, je vous dis que je ne suis pas sincère. Quels sont les mensonges nécessaires à la sincérité :- croire que “je” existe ; - croire que “je” pense “quelque chose” ; - croire que ce quelque chose correspond à ce que j’exprime. »
Sur une page du carnet intitulé « Réflexions » (IMEC, TRK5, ca. 1988), Tarkos écrit : « Je suis sincère. Je désire être sincère. Je pense être sincère. Je veux être sincère. […] Sincèrement, je vous dis que je ne suis pas sincère. Quels sont les mensonges nécessaires à la sincérité :- croire que “je” existe ; - croire que “je” pense “quelque chose” ; - croire que ce quelque chose correspond à ce que j’exprime. »2.3.3.2. Essais de « phrases »
C’est moins relativisme que chose posée à côté d’une autre qui n’y était pas, sans souci de provoquer quelque choc que ce soit.- D’un côté, insistance sur
- la dimension conjoncturelle des commencements, thèmes, motifs ni totalement choisis ni totalement imposés, ni totalement nécessaires ni totalement fortuits
(anecdotes embrayeuses de « démarrages critiques », affections déclencheuses d’« embarras de pensée », prétextes légers ou symptômes lourds de sens ), - et sur le caractère erratique et cursif du processus d’écriture
: absence de propos et de projet (d’à dire et d’à faire constitués), notation au jour le jour, sans anticipation ni projection.
« agents de rapports imprévus, sérendipiens – sérendipiens c’est-à-dire poétiques, puisqu’ils arrivent en cours de recherche. » Le « poétique », comme rarement chez Quintane, se voit positivement caractérisé ; c’est un mode de composition exploratoire, qui trouve, dans la mise en rapport d’éléments disparates, ce qu’il ne cherchait pas, fait confiance au mouvement constituant de la pensée dans ou par l’écriture. - la dimension conjoncturelle des commencements, thèmes, motifs ni totalement choisis ni totalement imposés, ni totalement nécessaires ni totalement fortuits
- D’un autre côté, insistance aussi grande sur le caractère procéduriel des modes de composition, que les livres, surtout jusqu’au début des années 2000, rendent explicites, en reprenant des éléments du jargon de la pragmatique scientifique (« essais »,
« dispositifs » ). En contradiction apparente avec la recherche sérendipienne, la« poésie […] est une pensée critique et la programmation de ses effets chez le lecteur » : elle ne trouve peut-être pas ce qu’elle cherche, mais elle s’accorde à une visée pratique, et place son adresse, donc son environnement de réception, au cœur de sa démarche. Elle est peut-être erratique et sans objet propre, mais elle est appliquée : si le rapport établi – par exemple entre deux termes éloignés ou opposés dans le corpus commun – a pour effet de « poser un diagnostic », alors il« est poétique » .
- les prépositions et conjonctions sont aussi déterminantes que les substantifs et les adjectifs
; - les « abstraits » et les « concrets » « confluent », rendant inopérante la distinction classique entre expérience intellectuelle et sensible, philosophique et poétique ;
- la copule « est » n’est pas spécialement en charge du déterminatif, de l’existentiel ou du véritatif, elle fait partie de « l’ensemble des connexions offertes par l’expérience », sur un site en friche, la légopole explosée d’un « réel » où « rien […] n’est absolument simple ; toute parcelle de l’expérience, si petite soit-elle » n’est pas un totus in toto en vertu d’une infinie communication des idiomes, mais
« un multum in parvo par ses relations multiples » .
- au plan de l’expérience vécue, chacun a à faire avec un courant continu sans séquences naturelles, un flux sans pointillés ;
- au plan de l’expérience menée, la méthode est une
« poétique généralisée » , qui n’a pas à faire au trésor de la langue mais au casino des discoursqui se jouent, s’échangent, se prisent, sans qu’aucune devise ne garantisse les usages et les normes du sens.
- Les « dispositifs » – euphémisme de guerre
– sont des modèles de rapports de R.G. : observation, description, transcription (en l’occurrence de films projetés lors de « L’Année de l’Algérie »). - Le « roman » – métaphore nationale – fait une apparition littérale : il vient avec son appareil éditorial, indiquant que c’est bien une expérience de roman en vase clos qui est menée là, expérience à la fois sèchement analytique et saturée de détails réalistes, tissée de chapitres à dimension propositionnelle et de dialogues sortis d’une « méthode de langue » française pour étrangers (avec tout ce que la supposée neutralité communicationnelle des échanges et des situations charrie d’idéologie). Bref, le roman, intégré tel quel à un ensemble hétérogène, apparaît dans sa qualité d’expérience formelle, de biais spécifique ; lieu d’une « une heureuse rencontre » entre le quelconque et l’improbable, le vraisemblable et la fiction, c’est en fin de compte une machine à tout faire signifier sans jamais rien dire
. - Encadrant le « roman », des
« faux-barrages » – terme emprunté à l’« ambiance rhétorique » de la décennie noire – tentent d’interpeller ou de filtrer les gros porteurs mémoriels (familiaux-nationaux notamment). - Enfin, des « grands récits » décortiquent des éléments du Grand Récit national, qui met le passé au profit d’un « présent général » (le déduit), en proposant des récits logiques alternatifs où des éléments plus petits, à échelle praticable, conduisent à une mémoire nouvelle de faits, gestes, phrases, qui n’ont pas été directement vécus
.
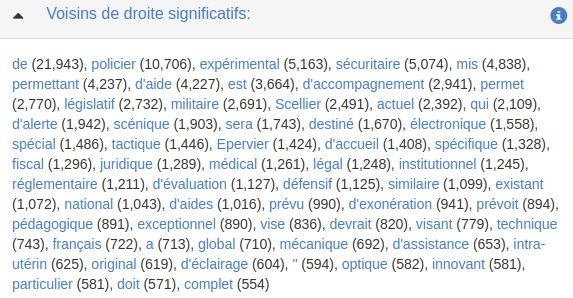 Voisins de droite les plus fréquents pour le terme « dispositif » dans le corpus francophone de l’Université de Leipzig (2012) : policier, expérimental, sécuritaire, d’aide, d’accompagnement, législatif, militaire, Scellier (optimisation fiscale), d’alerte, scénique, électronique, spécial, tactique, Épervier, d’accueil, spécifique, fiscal, juridique, etc.
Voisins de droite les plus fréquents pour le terme « dispositif » dans le corpus francophone de l’Université de Leipzig (2012) : policier, expérimental, sécuritaire, d’aide, d’accompagnement, législatif, militaire, Scellier (optimisation fiscale), d’alerte, scénique, électronique, spécial, tactique, Épervier, d’accueil, spécifique, fiscal, juridique, etc.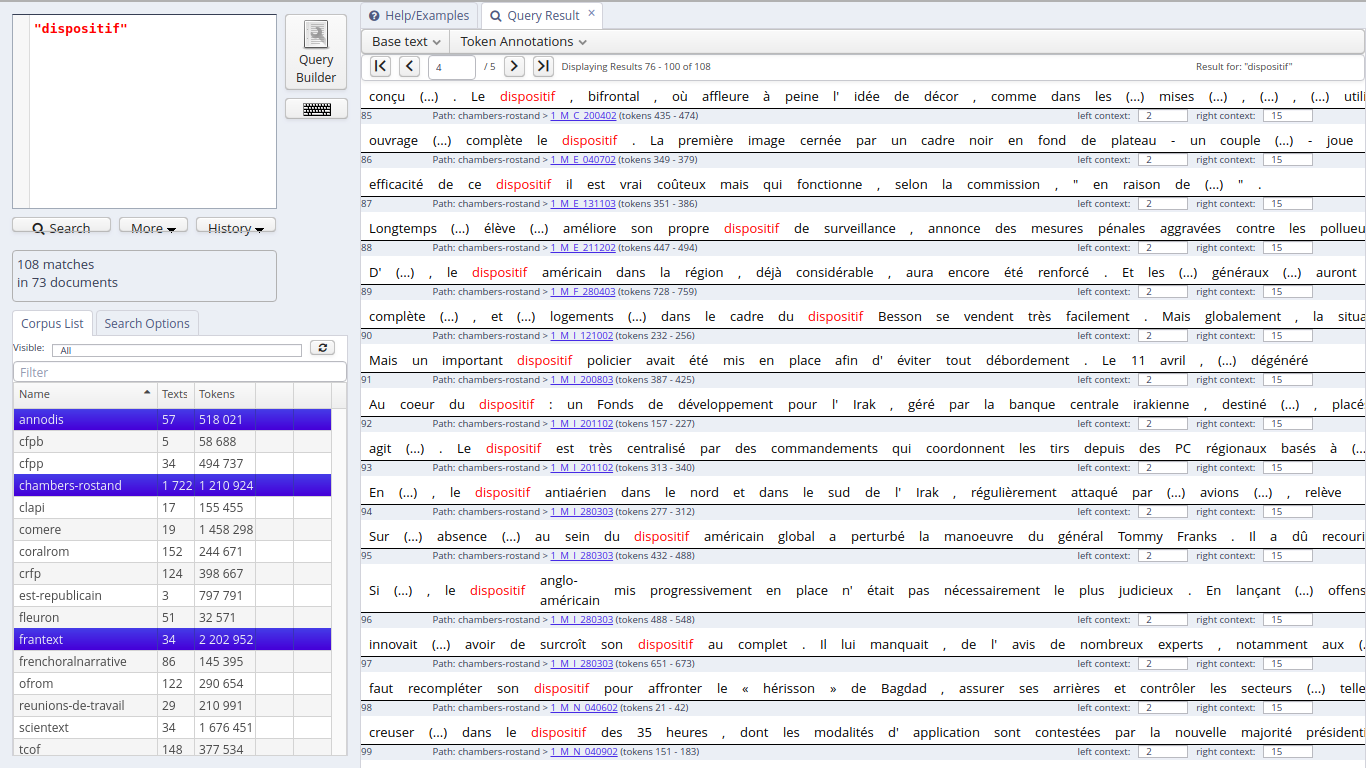 32 – Capture d’écran des résultats d’une requête sur Annis pour le terme « dispositif » en contexte, dans quelques corpus francophones (annodis, chambers-rostand, frantextet valibel) jusqu’à 2003.
32 – Capture d’écran des résultats d’une requête sur Annis pour le terme « dispositif » en contexte, dans quelques corpus francophones (annodis, chambers-rostand, frantextet valibel) jusqu’à 2003.Munissez votre bibliothèque personnelle du seul dispositif permettant son sabordage et son renflouement à volonté. […]
Ouvrez Lautréamont ! Et voilà toute la littérature retournée comme un parapluie !
Fermez Lautréamont ! Et tout, aussitôt, se remet en place…
Pour jouir à domicile d’un confort intellectuel parfait, adaptez donc à votre bibliothèque le dispositif MALDOROR-POÉSIES. […]
2.3.4. Des « essais de phrases » aux « tests de lecture »
Cartographier l’Empire, pour un poète, c’est, par exemple, recenser ses énoncés – la carte de l’Empire est la liste de ses énoncés.2.3.4.1. « Relever les contextes, vérifier les formules »
Chacun, le plus souvent, travaille et s’acharne séparément soit sur les progrès de la formalisation mathématique, soit sur les variations, montages, autour de : Bougnoul va niquer ta race, etc. (ex. : va te faire sucer) ; le matin, sur un problème logique ou mathématique (tant que le cerveau est clair) ; le soir, sur Va niquer ta race (quand le cerveau est trop chaud pour les maths), mais qui travaille réellement sur la liaison entre les deux ? Qui tente d’établir des connexions ? Qui propose la formalisation mathématique de Dégage sale Arabe sinon je te coupe les couilles et je te les fais bouffer ? Qui s’attaque à la poétique de ça ?« La France vient du fond des âges » (De Gaulle, 1970) La première, chez Quintane, est retournée à la Ducasse, et ce retournement suit le modèle déductif des Remarques
- appliquée, puisqu’elle travaille un texte antérieur considéré comme dominant, voire hégémonique ;
- « casseuse », puisqu’elle négocie unilatéralement, sans s’y adresser, l’« exactitude et l’inexactitude » des propositions visées ;
- mais également satirique, puisqu’elle pose son « diagnostic » à partir des termes de l’ennemi, suggérant qu’une vérité refoulée se logeait dans l’énoncé faux, faisant de la langue et du dogme du « monde renversé » le symptôme d’un déni systématique.
20. Entre deux maux il faut choisir le moindre.
[…]
29. Qui éleva La France (avec nos moyens) à l’immensité du ciel poétique (sans outrecuidance).
30. Comme tout le monde ; le parcours habituel : l’ordre qui règne nous est familier dans sa structure et sa forme.
31. Il faut ce qu’il faut. Entre deux maux il faut choisir le moindre (l’aumônier de Massu).
Ou : on y mettra tous les moyens
32. Le trait trivial ne doit pas faire oublier que la sobriété est, aussi, classique.
33. Il n’y a pas de solution de continuité entre nos mots d’esprit, cette sorte d’élégance, ce goût, qu’on nous envie encore, et les […] rapportés ici. Le mot d’esprit tel que nous le pratiquâmes, l’effort pour que perdure une certaine élégance, sa certaine idée, produisent […] - un poème d’état.
[…]
37. L’ordre qui règne nous est familier dans sa structure et sa forme.
38. C’est pourquoi nous avons pu nous y faire jusque dans ses dernières
conséquences.
[…]
42. L’esprit n’est pas une cause à laquelle il faudrait remonter pour comprendre
telle ou telle production, telle ou telle « conséquence », mais la création d’une ambiance dans laquelle couler telle opération, telle ou telle expérience,
43. qui éleva La France (sans outrecuidance) à l’immensité du ciel poétique.
- le passage, sur des archives militaires, d’opérations à opérations de sécurité et de maintien de l’ordre
; - la cohabitation, dans les figures éminentes des années algériennes, du trivium et du tripalium, de l’honnête homme et du tortionnaire
.
2.3.4.2. L’argent, corps de doctrine du monde renversé
Je suis les relations telles qu’elles sont. Je serais une machine face au capitalisme.[C’]est plus qu’une valeur, [c’]est une valeur de la réalisation, il n’y a pas un mouvement qui ne soit extérieur à son programme, son programme inclut tous les aspects du métabolisme humain. […]
L’argent est le pouvoir d’avoir un pouvoir sur une mise en œuvre.
- L’argent est alpha et oméga, premier moteur (puissance factitive : il
« fait faire » ) et cause dernière (puissance causative : il « conduit » ou « mène à » faire). - C’est l’arbitre universel du bien et du mal, du bon et du mauvais
, la garantie générale sur les actes et les pensées, la « référence commune » et « sûre » de leur bonté, de leur efficacité, de leur félicité. Il assure, dans tous les sens, les actions et les paroles, accorde les intentions aux actes . - Il est tout ce qui effectue, réalise, actualise, tient le monde à jour (sa puissance est
« immédiate » ). - Il est infaillible, magnanime, omniprésent, omnipotent,
« omnirelationnel » , disponible, absolument fiable; il est omniscient, compréhenseur (il comprend tout le présent et connaît tout l’avenir ) ; c’est un principe pan-noétique . - Il sanctionne ou rétribue, condamne ou sauve avec autorité, prend, donne, reprend ce qu’il a donné, etc.
; sa loi étant naturelle, ses sanctions sont en dernier effet de vie et de mort . - Il est juste et profitable, à la condition qu’on lui soit fidèle, dévoué
.
- L’argent est
« la seule chose qui nous [soit] commune. » - L’argent est
« la chose essentielle qui nous rend tous communs. »
- L’argent est ce qui donne une mesure commune (= fonde la communauté des sorts).
- L’argent est ce qui est l’unique mesure (= constitue la seule véritable communauté, celle des intérêts).
Sinon on est dans une tribu : ta tribu et son pouvoir. Si vous voulez vivre ensemble jusqu’à la mort sans aucune possibilité d’y échapper. Celui qui s’échappe est un traître. La notion d’argent supprime la notion de traître.
- Elle menace les récalcitrants sur un mode qui, malgré la tournure euphémistique, fait penser au management des Présidents les plus réformistes et les plus volontaristes envers les assistés et les profiteurs du système.
- Elle laisse entrevoir un arsenal de sanctions parfaitement totalitaire.
- Elle suggère, dans une interrogation toute rhétorique, que there is no alternative au bon sens, au pragmatisme de son dogme.
- Elle s’égale finalement à l’apologie la plus distinctive du totalitarisme (toujours teintée de l’élément libéral) : la fabrique des possibles.
- « Tout est possible », admise l’hégémonie de la « doctrine de l’argent ». Et tout est permis passée la soumission à la tutelle.
- insistance sur la toute puissance (
« L’universalité de sa qualité est la toute-puissance de son essence » ), - analogie explicite avec dieu (« il est la divinité visible »,
« la force divine » qui « fait fraterniser toutes les impossibilités » ), - caractère d’omnirelationnalité (« l’argent est le lien de tous les liens », il peut les « dénouer et nouer » ; c’est « le moyen universel de séparation » et le « liant » de la société
), - premier et dernier terme, cause et fin, moyen et but (dans le schéma de la
« circulation A-M-A » ).
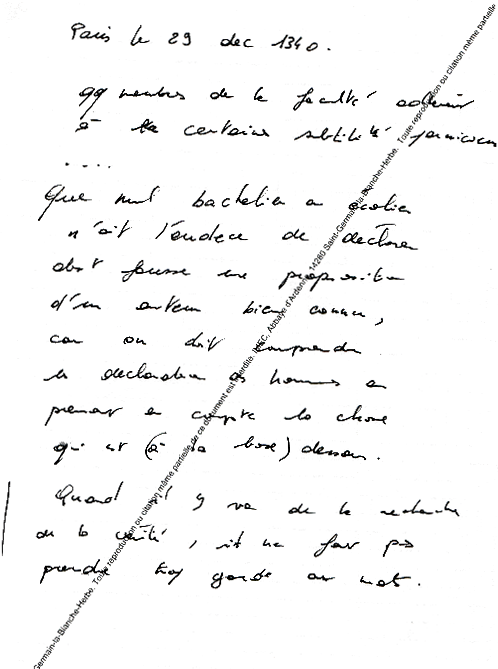 La page du cahier « Process II » (IMEC, boîte TRK2), où Tarkos a recopié une traduction du statut du 29 décembre 1340. Voir note 2114.
La page du cahier « Process II » (IMEC, boîte TRK2), où Tarkos a recopié une traduction du statut du 29 décembre 1340. Voir note 2114.Conclusion générale
La littérature est avant tout une activité critique. Seulement, contrairement à d’autres disciplines, elle n’a aucune réponse préalable, elle n’a pas de plan. Comme les chevaliers du Moyen Âge, elle ne connaît pas le nom de l’aventure qu’elle va vivre.- Dé-cantonner la poésie, c’est ouvrir la poésie à d’autres questions que la sienne propre ; c’est confondre et troubler toute « poésie pure » ; c’est faire parler la poésie, bavardement, c’est faire usage des mots sans considérer que cet usage les use.
- Dé-cléricaliser la pratique de la poésie, c’est la désarrimer de toute idée de vérité de l’objet, renoncer à toute fidélité à cet objet, lui refuser toute prérogative ou licence dans le jeu des discours ; c’est aussi penser la parole, comme l’« écriture », loin de toute « compétence ».
- la figure mythique du logothète (l’instituteur-impositeur du langage) et celle du thesmothète ou logothète second (qui négocie l’expression avec les usages collectifs, sur une base conventionnelle, où le sens appartient à l’interlocution plus qu’au parlant lui-même)
; - l’unité lexicale de la valeur poétique (le « mot » hypostasié
) et l’unité discursive du sens (la phrase, et même l’holophrase à la « complètement-collé ») ; - l’idée d’une mot-nnaie poétique – langue dans la langue
, voire lexique dans le lexique – et celle d’une mot-nnaie générale, d’une langue telle qu’en son cours, désindexée de toute devise .
- ils délaissent la tradition d’une herméneutique inspirée, embrassant celle, pragmatique, pour laquelle un texte est un « test » ou un « jeu », et l’expérience vécue une expérience menée, une mise en situation, le retraitement exotérique d’un matériau commun
; - ils relativisent le canon moderne des vertus (originalité, authenticité), lui opposant, après Ducasse notamment, un jeu fluent d’identités accidentelles, artificielles, voire factices
; - ils renégocient les termes traditionnels de la donation du poème, substituant à une conception élective une conception accidentelle de l’inspiration : un poème naît d’une rencontre entre un stock et un « current » (au sens double de ce mot dans l’anglais de Spicer : un « cours » et un « actuel », un ce-qui-a-cours et ce-qui-est-en-cours)
.
– Celle que je parle est celle que nous parlons tous. Celle que j’écris inclut celle que je parle en la malmenant, en la farcissant d’autres.
- Il sait : qu’il n’a plus de lieu sûr, plus de gars sûr.
- Il peut compter sur : aucun ren-phore.
- Il ne sait pas : ce qu’il dit, ce qu’il va dire.
- Sa mission :
« il n’y a rien à faire » , rien à dire.
▼
Annexes
Présupposée : « …l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue… » (Pascal)
Résultante : « …il ne serait pas plus déshonoré que ce qui ne le préserve pas » (Ducasse).
On peut considérer le cas suivant selon le même principe :
Présupposée : « Ceux qui manquent de probité dans les plaisirs n’en ont qu’une feinte dans les affaires : c’est la marque d’un naturel féroce, lorsque le plaisir ne rend point humain. » (Vauvenargues)
Résultante : « Ceux qui ont de la probité dans leurs plaisirs en ont une sincère dans leurs affaires. C’est la marque d’un naturel peu féroce, lorsque le plaisir rend humain. » (Ducasse)
Kristeva écrit : « Nous constatons qu’à travers cet “abus” des négations, la fonction même de nier se trouve mise en doute, comme fonction logique, pour ne dégager qu’une négativité propre à la fonction sémiotique et visant à s’approprier le présupposé. » (Ibid., p. 348)
Bibliographie
Les bibliographies de référence ont été établies, pour Nathalie Quintane, par Benoît Auclerc (Nathalie Quintane, Paris : Classiques Garnier, « Écrivains francophones d’aujourd’hui », 2015, p. 229-247. En ligne.) ; pour Christophe Tarkos, par Katalin Molnár et Valérie Tarkos (Écrits poétiques, p. 409‑414). Nous ne mentionnons ici que les ouvrages que nous avons consultés et les textes que nous avons mobilisés pour le présent travail.
TARKOS, Christophe. Morceaux choisis de Christophe Tarkos, Paris : Les Contemporains Favoris – Morceaux Choisis, 1995.
QUINTANE, Nathalie. Remarques, Le Chambon-sur-Lignon : Cheyne Éditeur, « Grands fonds », 1997.
QUINTANE, Nathalie. Chaussure, Paris : P.O.L, 1997.
QUINTANE, Nathalie. Jeanne Darc, Paris : P.O.L, 1998.
TARKOS, Christophe. Caisses, Paris : P.O.L, 1998.
TARKOS, Christophe. Le signe =, Paris : P.O.L, 1999.
QUINTANE, Nathalie. Début (autobiographie), Paris : P.O.L, 1999.
QUINTANE, Nathalie. Mortinsteinck (le livre du film), Paris : P.O.L, 1999.
TARKOS, Christophe. Pan, Paris : P.O.L, 2000.
QUINTANE, Nathalie. Saint-Tropez – Une Américaine, Paris : P.O.L, 2001.
TARKOS, Christophe. Anachronisme, Paris : P.O.L, 2001.
QUINTANE, Nathalie. Formage, Paris : P.O.L, 2003.
QUINTANE, Nathalie. Les Quasi-Monténégrins, suivi de Deux Frères (pièces), Paris : P.O.L, 2003.
QUINTANE, Nathalie. Antonia Bellivetti (roman), Paris : P.O.L, 2004.
QUINTANE, Nathalie. Cavale (roman), Paris : P.O.L, 2006.
QUINTANE, Nathalie. Une Oreille de chien (dessins Nelly Maurel), Nolay : Les Éditions du chemin de fer, 2007.
QUINTANE, Nathalie. Grand ensemble (concernant une ancienne colonie), Paris : P.O.L, 2008.
QUINTANE, Nathalie. Tomates, Paris : P.O.L, 2010.
QUINTANE, Nathalie. Crâne chaud, Paris : P.O.L, 2012.
QUINTANE, Nathalie. Plomb polonais, Bordeaux : Confluences / FRAC Aquitaine, « Fiction à l’œuvre », 2013.
QUINTANE, Nathalie. Descente de médiums, Paris : P.O.L, 2014.
QUINTANE, Nathalie. Les années 10, Paris : La Fabrique, 2014.
QUINTANE, Nathalie. Que faire des classes moyennes ?, Paris : P.O.L, 2016.
QUINTANE, Nathalie. Ultra-Proust, Paris : La Fabrique, 2018.
QUINTANE, Nathalie. Un œil en moins, Paris : P.O.L, 2018.
TARKOS, Christophe. Le baroque, Limoges : Al Dante, 2009.
TARKOS, Christophe. L’enregistré, éd. Philippe Castellin, Paris : P.O.L, 2014.
QUINTANE, Nathalie. Recension de LA RÉDACTION. Valérie par Valérie (Paris : Questions théoriques, « Réalités non couvertes », 2008), Sitaudis, 05/09/2008. Lien.
QUINTANE, Nathalie. « Faire de la poésie une science, politique. Tentatives d’expulsion de la littérature, du “montage” ducassien aux cut-up contemporains », dans COËLLIER, Sylvie (dir). Le Montage dans les arts aux XXe et XXIe siècles, Aix-en-Provence : Publications de l’Université de Provence, 2008.
QUINTANE, Nathalie. Recension de HANNA, Christophe. Nos dispositifs poétiques (Paris : Questions théoriques, « Forbidden beach », 2010), Sitaudis, 23/07/2010. Lien.
QUINTANE, Nathalie. « Critique des nous », Cahier critique de poésie, Marseille : Centre International de Poésie Marseille, n°22 (« Critique de la poésie », 2011).
QUINTANE, Nathalie. « J’étais une petite-bourgeoise de gauche éclectique-révisionniste (difficultés de communication entre les dernières avant-gardes et la génération de 90) », Formes poétiques contemporaines, n°7, 2010, p. 85‑97. Lien.
QUINTANE, Nathalie. « La Sénéchale », Vacarme, n° 52, 2010. Lien.
QUINTANE, Nathalie. « Astronomiques assertions », dans Toi aussi tu as des armes, Paris : La Fabrique, 2011, p. 175-197.
QUINTANE, Nathalie. Remarques de 2013, non publiées, transmises par l’autrice.
QUINTANE, Nathalie. « Un présent de lectures troublées », dans dir. GORRILLOT, Bénédicte. LESCART, Alain. L’illisibilité en questions, Villeneuve-d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2014, p. 50-58.
QUINTANE, Nathalie. « On va faire quelque chose qui ne se verra pas dans un endroit où il n’y a personne », dans dir. BRUN, Catherine. Guerre d’Algérie. Les mots pour la dire, Paris : CNRS éditions, 2014 ; reproduit dans Artichoke, n°4, Berlin : 2016. Lien.
QUINTANE, Nathalie. L’art et l’argent (collectif, dir. J.-P. Cometti, N. Quintane), Paris : Éditions Amsterdam, 2017.
QUINTANE, Nathalie. « Prigent/Bataille et la “génération de 90” », dans dir. GORRILLOT, Bénédicte. THUMEREL, Fabrice. Christian Prigent : trou(v)er sa langue, Paris : Hermann, 2017, p. 297-313.
QUINTANE, Nathalie. Recension de COSTE, Florent. Explore (Paris : Questions théoriques, « Forbidden beach », 2017), Sitaudis, 08/05/2017. Lien.
QUINTANE, Nathalie. Préface à TARKOS, Christophe. Le petit bidon et autres textes, Paris : P.O.L, 2019, p. 9-19.
TARKOS, Christophe. DE GEYTER, Gudrun. Entretien [1997], Rotterdam International Poetry Festival, reproduit dans L’enregistré, p. 237‑249.
TARKOS, Chistophe. CHRISTOFFEL, David. Entretien [1998], partiellement retranscrit dans Écrits poétiques, p. 361‑389 ; fichiers audio de l’entretien complet fournis par D. Christoffel.
TARKOS, Christophe. CASANOVA, Pascale. Entretien, « Les jeudis littéraires », France Culture, 08/07/1999, reproduit sur le DVD de L’enregistré.
QUINTANE, Nathalie. FARAH, Alain. « Trois questions pour Nathalie Quintane », entretien réalisé le 2 février 2008, reproduit dans FARAH, Alain. « La Possibilité du choc : invention littéraire et résistance politique dans les œuvres d’Olivier Cadiot et de Nathalie Quintane ». Thèse de doctorat, Lyon/Montréal, ENS de Lyon / UQAM, 2009, p. 290‑300.
QUINTANE, Nathalie. PRADOC, Roland. « Les eurêkas littéraires de Nathalie Quintane », Chronic’art, 25/05/2009. Lien.
QUINTANE, Nathalie. FARAH, Alain. « Poudre de succession, pensée de la bombe ou désamorçage des avant-gardes », dans GORRILLOT, Bénédicte (dir.). LESCART, Alain (dir.). L’Illisibilité en questions, Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, « Littératures », 2014, p. 177-182.
QUINTANE, Nathalie. PRIGENT, Christian. « D’une génération l’autre (1) », dans GORRILLOT, Bénédicte (dir.). LESCART, Alain (dir.). L’Illisibilité en questions, Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, « Littératures », 2014, p. 183-191.
QUINTANE, Nathalie. GLEIZE, Jean-Marie. « D’une génération l’autre (2) », dans GORRILLOT, Bénédicte (dir.). LESCART, Alain (dir.). L’Illisibilité en questions, Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, « Littératures », 2014, p. 193-198.
QUINTANE, Nathalie. « Il n’y a pas qu’une seule manière de vivre », entretien avec ventscontraires.net, 23/11/2014. Lien.
QUINTANE, Nathalie. AUCLERC, Benoît. « À inventer, j’espère », entretien avec AUCLERC, Benoît (dir.). Nathalie Quintane, Paris : Classiques Garnier, « Écrivains francophones d’aujourd’hui », 2015.
QUINTANE, Nathalie. BORTZMEYER, Gabriel. « Comment planter des tomates avec une caméra », Débordements, 01/02/2016. Lien.
QUINTANE, Nathalie. TRUONG, Nicolas. « Une partie de l’extrême gauche lit davantage de littérature », Le Monde, 14/03/2018. Lien.
QUINTANE, Nathalie. RICHEUX, Marie. « Nathalie Quintane : “Trahissons la littérature pour qu’enfin elle vive” », Par les temps qui courent, France Culture, diff. 29/03/2018. Lien.
QUINTANE, Nathalie. FRANZONI, Andrea. « Intatti fantasmi chiedono il realismo : Jack Spicer », Nazione Indiana, 04/07/2018. Lien. Version française remise par A. Franzoni.
QUINTANE, Nathalie. JAWAD, Emmanuèle. « Les grands entretiens de Diacritik (5) : Nathalie Quintane (Un œil en moins) », Diacritik, 25/07/2018 . Lien.
QUINTANE, Nathalie. LORIS, Marius. WAJEMAN, Lise. « Boussole. Entretien avec Nathalie Quintane », Écrire l’histoire, n°18, 2018, 187‑194.
QUINTANE, Nathalie. « Rencontre-lecture avec Nathalie Quintane », séminaire Benoît Auclerc, Université Lyon 3, 21/02/2017. Lien.
QUINTANE, Nathalie. « Rencontre avec Jacques Rancière et Nathalie Quintane au TNBA ». Lien.
QUINTANE, Nathalie. Conférence à l’École Supérieure d’Art Pays Basque (ESAPB), 12/02/2019. Lien.
AUCLERC, Benoît. « Lecture, réception et déstabilisation générique chez Francis Ponge et Nathalie Sarraute (1919‑1958) ». Thèse sous la direction de Jean-Yves Debreuille, soutenue à l’Université Lumières Lyon 2 en 2006.
BERTRAND, Jean-Pierre. CLAISSE, Frédéric. HUPPE, Justine. « Opus et modus operandi : agirs spécifiques et pouvoirs impropres de la littérature contemporaine (vue par elle-même) », COnTEXTES [En ligne], n°22, 2019. Lien DOI.
BOISNARD, Philippe. « D’un mot-au-mot poétique ». Lien.
BOISNARD, Philippe. « Poésie de face sans fond : quelle fut la prétention de la poésie faciale ? ». Lien.
BOURASSA, Lucie. « “Il n’y a pas de mots” et “Ma langue est pleine de mots” : continu et articulations dans la théorie du langage de Christophe Tarkos. », Études françaises, vol. 49, num. 3, 2013, p. 143‑166. Lien DOI.
BOUQUET, Stéphane. « Le pirate du litanique. C. Tarkos écrit des poèmes flux pour dire la violence du monde, et que la guerre vient de finir, "il y a quelques jours" », Libération, 01/06/2000. Lien.
CAILLÉ, Anne-Renée. « Théorie du langage et esthétique totalisante dans l’œuvre poétique de Christophe Tarkos ». Thèse sous la direction de L. Bourassa & A. Farah, soutenue à l’Université de Montréal (Faculté des arts et des sciences) en 2014.
CAILLÉ, Anne-Renée. « Faire entendre » (compte rendu de Christophe Tarkos, L’enregistré), dans Liberté, n°308, Montréal, 2015, p. 58‑59.
CASTELLIN, Philippe. « Christophe Tarkos. “Poète de la lecture” », introduction Christophe Tarkos, L’enregistré, éd. Ph. Castellin, Paris : P.O.L, 2014, p. 13‑93.
CASTELLIN, Philippe. « Tout-se-tient », entretien avec Jérôme Mauche, Cahier critique de poésie, « Dossier Christophe Tarkos », Marseille : Centre international de poésie Marseille, 2015, p. 5-12.
CHARRON, Philippe. « Du "métier d’ignorance" aux savoir-faire langagiers. L’environnement de la littéralité chez Emmanuel Hocquard, Pierre Alferi et Jérôme Mauche ». Thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal, 2014. Lien.
CHRISTOFFEL, David. MOLNÁR, Katalin. Il est important de penser, 2009 (01h01). Lien.
EGO, Renaud. « D’un langage perpétuel », La pensée de midi, 2001/2, n°5‑6, Arles : Actes Sud, 2001, p. 206‑222.
EGO, Renaud. « Poésie-infinie-réalité. La poésie de Christophe Tarkos », La pensée de midi, vol. 28, n°2, Arles : Actes Sud, 2009, p. 185‑190.
FARAH, Alain. « La Possibilité du choc : invention littéraire et résistance politique dans les œuvres d’Olivier Cadiot et de Nathalie Quintane ». Thèse de doctorat, Lyon/Montréal, ENS Lyon / UQAM, 2009.
FARAH, Alain. Le gala des incomparables. Invention et résistance chez Olivier Cadiot et Nathalie Quintane, Paris : Garnier, 2013 (adaptation de la thèse ci-dessus).
FARAH, Alain. « Situation de l’écrivain en 1997 : Christophe Tarkos, commentateur de son émergence », @nalyses, Vol. 5, n°3, aut. 2010. Lien DOI.
GIRARD, Xavier. « Christophe Tarkos : Les écrits poétiques », Journal Sous-Officiel, n°39, ventôse 2009. Lien.
HANNA, Christophe. Nos dispositifs poétiques, Paris : Questions théoriques, « Forbidden beach », 2010.
GORRILLOT, Bénédicte. THUMEREL, Fabrice. Christian Prigent : trou(v)er sa langue, Paris : Hermann, 2017.
HAMEL (Jean-François). « De Mai à Tarnac. Montage et mémoire dans les écritures politiques de Jean-Marie Gleize et Nathalie Quintane », dans Le Roman français contemporain face à l’Histoire. Thèmes et formes, sous la direction de Gianfranco Rubino & Dominique Viart, Macerata, Quodlibet Studio, « Ultracontemporanea », 2014.
HUPPE, Justine. « L’insurrection qui vient par la forme », COnTEXTES [En ligne], n°22, 2019. Lien DOI.
LAVERDURE, Bertrand. « La pensée liquide / Christophe Tarkos, Anachronisme, P.O.L, 223 p. », Spirale, n°183, mars-avril 2002, p. 9. Lien URI.
LEQUETTE, Samuel. « Ecrits poétiques de Christophe Tarkos », Sitaudis. Lien.
LYNCH, Eric. « Nathalie Quintane : « Nous », le peuple », Marges [En ligne], n°21, 2015. Lien DOI.
MAGNO, Luigi. « Seuils prosaïques (notes sur quelques faits de poésie) », Revue italienne d’études françaises [En ligne], n°5, 2015. Lien DOI.
MALUFE, Annita Costa. « The Poetics of Christophe Tarkos : the Word-Paste », Bakhtiniana, Rev. Estud. Discurso, vol. 10, n°1, p. 137‑155, São Paulo, avril 2015. Lien DOI.
MAUCHE, Jérôme (coord.). Cahier critique de poésie, « Dossier Christophe Tarkos », Marseille : Centre international de poésie, 2015.
PINSON, Jean-Claude. « Où va la poésie ? », Critique, vol. 846, n°11, 2017.
PROULX, Gabriel. « Fluidité générique dans Tomates de Nathalie Quintane : poésie, roman, essai littéraire. », Études littéraires, vol. 46, num. 3, aut. 2015, p. 157–168. Lien DOI.
THOLOMÉ, Vincent (dir.). « Tarkos et compagnie », TTC, n°3, 1997.
WOURM, Nathalie. Poètes français du 21e siècle : entretiens, Leiden ; Boston : Brill Rodopi, 2017.
ALFERI, Pierre. Chercher une phrase [1991], Paris : Bourgois, 2007.
ANTIN, David. Accorder, Genève : héros limite, 2012.
ANTIN, David. je n’ai jamais su quelle heure il était [i never knew what time it was], Genève : héros limite, 2008.
BADIOU, Alain. Petit manuel d’inesthétique, Paris : Seuil, 1998.
BADIOU, Alain. Que pense le poème ?, Caen : NOUS, 2016, et l’intervention du même nom à la Maison de la poésie de Paris (Lien).
BARTHES, Roland. Le degré zéro de l’écriture [1953], dans OC, t. 1, éd. É. Marty, Paris : Seuil, 2002 [1993].
BATAILLE, Georges. La littérature et le Mal [1957], Paris : Gallimard, « folio/essais », 2013.
BRIAND, Michel. « Inspiration, enthousiasme et polyphonies : ένθεος et la performance poétique », Noesis, n°4, 2000, p. 97‑154.
BRIAND, Michel. « L’invention de l’“enthousiasme” poétique », Cahiers « Mondes anciens » [En ligne], n°11, 2018. Lien DOI.
COSTE, Florent. Explore. Investigations littéraires, Paris : Questions Théoriques, « Forbidden Beach », 2017.
DUCASSE, Isidore (dit Comte de Lautréamont). Œuvres complètes, éd. H. Juin, Paris : Gallimard, « Poésie », 1973.
GLEIZE, Jean-Marie. « Où vont les chiens ? », Littérature, « De la poésie aujourd’hui », Paris : Larousse, n°110, 1998, p. 70‑80.
GLEIZE, Jean-Marie, Les chiens noirs de la prose, Paris : Seuil, « Fiction & Cie », 1999.
GLEIZE, Jean-Marie. Littéralité, Paris : Questions théoriques, 2015.
GLEIZE, Jean-Marie. Sorties, Paris : Questions théoriques, 2014.
HANNA, Christophe. Nos dispositifs poétiques, Paris : Questions théoriques, 2010.
HOCQUARD, Emmanuel. ma haie, Paris : P.O.L, 2001.
KRISTEVA, Julia. La révolution dans le langage poétique, Paris : Seuil, 1974.
MESCHONNIC, Henri. Célébration de la poésie, Lagrasse : Verdier, 2001.
NOVALIS. Œuvres complètes, trad. A. Guerne, Paris : Gallimard, 1975.
PINSON, Jean-Claude. Habiter en poète, Seyssel : Champ Vallon, 2001.
PINSON, Jean-Claude. Poéthique. Une autothéorie, Seyssel : Champ Vallon, 2013.
PONGE, Francis. Œuvres complètes, t. 1 (1999) & 2 (2002), dir. Bernard Beugnot, Paris : Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade ».
PRIGENT, Christian. Ceux qui merdRent, Paris : P.O.L, 1991.
PRIGENT, Christian. La langue et ses monstres, Paris : P.O.L, 1989.
PRIGENT, Christian. Retour à Bataille, entretien avec Sylvain Santi, Paris : P.O.L, 2010.
PRIGENT, Christian. Salut les anciens / Salut les modernes, Paris : P.O.L, 2000.
PRIGENT, Christian. Une erreur de la nature, Paris : POL, 1996.
ROUBAUD, Jacques. Poétique. Remarques – Poésie, mémoire, nombre, temps, rythme, contrainte, forme, etc., Paris : Seuil, 2016.
SPICER, Jack. C’est mon vocabulaire qui m’a fait ça, trad. É. Suchère, Bordeaux : Le bleu du ciel, 2006.
SPICER, Jack. GIZZI, Peter (éd.). The House That Jack Built : the Collected Lectures of Jack Spicer, Middletown : Wesleyan University Press, 1998.
SPICER, Jack. Trois leçons de poétique, trad. B. Rival, Courbevoie : Théâtre typographique, 2013 (version française du précédent).
STRACK, Friedrich. EICHELDINGER, Martina (éd.). Fragmente der Frühromantik, Berlin/Boston : De Gruyter, 2011.
VALÉRY, Paul. HYTIER, Jean (éd.). Œuvres, t. 1,Paris : Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1957.
CASSIN, Barbara (dir.). Vocabulaire européen des philosophies, Paris : Seuil / Le Robert, 2004.
CERTEAU (de), Michel. L’invention du quotidien [1980], t. 1, « Arts de faire », Paris : Gallimard, « Folio essais », 1990.
DETIENNE, Marcel. Les Maîtres de Vérité dans la Grèce archaïque [1967], Paris : Le livre de poche, 2006.
FOUCAULT, Michel. Leçons sur la volonté de savoir – Cours au Collège de France, 1970‑1971, Paris : Gallimard/Seuil, 2011.
LIBERA (de), Alain. Penser au Moyen Âge, Paris : Seuil, 1991.
VEYNE, Paul. Comment on écrit l’histoire, Paris : Seuil, 1971.
VEYNE, Paul. Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? [1983], Paris : Seuil, 2014.
AUSTIN, John Langshaw. Quand dire, c’est faire [How to do Things with Words (1955, 1962)], trad. G. Lane, Paris : Seuil, 1970.
BOURDIEU, Pierre. « L’ontologie politique de Martin Heidegger », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 1, « La critique du discours lettré », n°5‑6, nov. 1975, p. 109‑156.
BOURDIEU, Pierre. Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques, Paris : Fayard, 1982.
CASSIN, Barbara. L’effet sophistique, Paris : Gallimard, 1995.
CASSIN, Barbara. Quand dire, c’est vraiment faire, Paris : Fayard, 2018.
GOLDSCHMIDT, Georges-Arthur. Heidegger et la langue allemande, Paris : CNRS éditions, 2016.
KLEIST (von), Heinrich. « De l’élaboration progressive de la pensée par le discours » [« Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden », v. 1805], Petits écrits, dans OC, t. 1, Paris : Gallimard, « Le Promeneur », 1999.
MESCHONNIC, Henri. Le langage Heidegger, Paris : PUF, 1990.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophische Untersuchungen [1953] (fr. : Recherches ou Investigations philosophiques), Francfort-sur-le-Main : Suhrkamp Verlag, 1971.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus [1921], Francfort-sur-le-Main : Suhrkamp Verlag, 1969.
AGAMBEN, Giorgio. Le feu et le récit [Il fuoco e il racconto, 2014], trad. M. Rueff, Paris : Payot & Rivages, 2015.
ARISTOTE. Sauf indication contraire : PELLEGRIN, Pierre (dir.). Œuvres complètes, Paris : Flammarion, 2014. Pour le texte grec, nous nous sommes référé au site de la Tufts University (lien).
CUES (de), Nicolas. De la docte ignorance. [De Docta Ignorantia (1440)], Paris : Payot & Rivages, 2011.
ECKHART (von Hochheim, dit Maître). Sermons-traités, trad. P. Petit, Paris : Gallimard, 1987.
HEIDEGGER, Martin. Gesamtausgabe, Francfort-sur-le-Main : V. Klostermann, 1975‑2019 (publication toujours en cours).
LIBERA (de), Alain. La querelle des universaux : de Platon à la fin du Moyen Âge, Paris : Seuil, « Des travaux », 1996.
LYOTARD, Jean-François. La condition postmoderne, Paris : Minuit, 1979.
LYOTARD, Jean-François. Le différend, Paris : Minuit, 1984.
MARX, Karl. Manuscrits de 44, trad. J.-P. Gougeon, éd. J. Salem, Paris : Flammarion, « GF », 1996.
PLATON. Sauf indication contraire : BRISSON, Luc (dir.). Œuvres complètes [2008] Paris : Flammarion, 2011. Pour le texte grec, nous avons consulté en parallèle l’édition de John Burnet Platonis opera, Oxford : Clarendon, « Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis », 1900.
Corpus (ordre chronologique)
Livres et revues
BÉRARD, Stéphane. QUINTANE, Nathalie. TARKOS, Christophe. R.R., revue non paginée, ca. 1993‑2000.TARKOS, Christophe. Morceaux choisis de Christophe Tarkos, Paris : Les Contemporains Favoris – Morceaux Choisis, 1995.
QUINTANE, Nathalie. Remarques, Le Chambon-sur-Lignon : Cheyne Éditeur, « Grands fonds », 1997.
QUINTANE, Nathalie. Chaussure, Paris : P.O.L, 1997.
QUINTANE, Nathalie. Jeanne Darc, Paris : P.O.L, 1998.
TARKOS, Christophe. Caisses, Paris : P.O.L, 1998.
TARKOS, Christophe. Le signe =, Paris : P.O.L, 1999.
QUINTANE, Nathalie. Début (autobiographie), Paris : P.O.L, 1999.
QUINTANE, Nathalie. Mortinsteinck (le livre du film), Paris : P.O.L, 1999.
TARKOS, Christophe. Pan, Paris : P.O.L, 2000.
QUINTANE, Nathalie. Saint-Tropez – Une Américaine, Paris : P.O.L, 2001.
TARKOS, Christophe. Anachronisme, Paris : P.O.L, 2001.
QUINTANE, Nathalie. Formage, Paris : P.O.L, 2003.
QUINTANE, Nathalie. Les Quasi-Monténégrins, suivi de Deux Frères (pièces), Paris : P.O.L, 2003.
QUINTANE, Nathalie. Antonia Bellivetti (roman), Paris : P.O.L, 2004.
QUINTANE, Nathalie. Cavale (roman), Paris : P.O.L, 2006.
QUINTANE, Nathalie. Une Oreille de chien (dessins Nelly Maurel), Nolay : Les Éditions du chemin de fer, 2007.
QUINTANE, Nathalie. Grand ensemble (concernant une ancienne colonie), Paris : P.O.L, 2008.
QUINTANE, Nathalie. Tomates, Paris : P.O.L, 2010.
QUINTANE, Nathalie. Crâne chaud, Paris : P.O.L, 2012.
QUINTANE, Nathalie. Plomb polonais, Bordeaux : Confluences / FRAC Aquitaine, « Fiction à l’œuvre », 2013.
QUINTANE, Nathalie. Descente de médiums, Paris : P.O.L, 2014.
QUINTANE, Nathalie. Les années 10, Paris : La Fabrique, 2014.
QUINTANE, Nathalie. Que faire des classes moyennes ?, Paris : P.O.L, 2016.
QUINTANE, Nathalie. Ultra-Proust, Paris : La Fabrique, 2018.
QUINTANE, Nathalie. Un œil en moins, Paris : P.O.L, 2018.
Recueils et éditions posthumes
TARKOS, Christophe. Écrits poétiques, éd. Katalin Molnár, Valérie Tarkos, Paris : P.O.L, 2008.TARKOS, Christophe. Le baroque, Limoges : Al Dante, 2009.
TARKOS, Christophe. L’enregistré, éd. Philippe Castellin, Paris : P.O.L, 2014.
Ouvrages collectifs, articles
QUINTANE, Nathalie. « Monstres et Couillons, la partition du champ poétique contemporain », Sitaudis, 19 octobre 2004. Lien.QUINTANE, Nathalie. Recension de LA RÉDACTION. Valérie par Valérie (Paris : Questions théoriques, « Réalités non couvertes », 2008), Sitaudis, 05/09/2008. Lien.
QUINTANE, Nathalie. « Faire de la poésie une science, politique. Tentatives d’expulsion de la littérature, du “montage” ducassien aux cut-up contemporains », dans COËLLIER, Sylvie (dir). Le Montage dans les arts aux XXe et XXIe siècles, Aix-en-Provence : Publications de l’Université de Provence, 2008.
QUINTANE, Nathalie. Recension de HANNA, Christophe. Nos dispositifs poétiques (Paris : Questions théoriques, « Forbidden beach », 2010), Sitaudis, 23/07/2010. Lien.
QUINTANE, Nathalie. « Critique des nous », Cahier critique de poésie, Marseille : Centre International de Poésie Marseille, n°22 (« Critique de la poésie », 2011).
QUINTANE, Nathalie. « J’étais une petite-bourgeoise de gauche éclectique-révisionniste (difficultés de communication entre les dernières avant-gardes et la génération de 90) », Formes poétiques contemporaines, n°7, 2010, p. 85‑97. Lien.
QUINTANE, Nathalie. « La Sénéchale », Vacarme, n° 52, 2010. Lien.
QUINTANE, Nathalie. « Astronomiques assertions », dans Toi aussi tu as des armes, Paris : La Fabrique, 2011, p. 175-197.
QUINTANE, Nathalie. Remarques de 2013, non publiées, transmises par l’autrice.
QUINTANE, Nathalie. « Un présent de lectures troublées », dans dir. GORRILLOT, Bénédicte. LESCART, Alain. L’illisibilité en questions, Villeneuve-d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2014, p. 50-58.
QUINTANE, Nathalie. « On va faire quelque chose qui ne se verra pas dans un endroit où il n’y a personne », dans dir. BRUN, Catherine. Guerre d’Algérie. Les mots pour la dire, Paris : CNRS éditions, 2014 ; reproduit dans Artichoke, n°4, Berlin : 2016. Lien.
QUINTANE, Nathalie. L’art et l’argent (collectif, dir. J.-P. Cometti, N. Quintane), Paris : Éditions Amsterdam, 2017.
QUINTANE, Nathalie. « Prigent/Bataille et la “génération de 90” », dans dir. GORRILLOT, Bénédicte. THUMEREL, Fabrice. Christian Prigent : trou(v)er sa langue, Paris : Hermann, 2017, p. 297-313.
QUINTANE, Nathalie. Recension de COSTE, Florent. Explore (Paris : Questions théoriques, « Forbidden beach », 2017), Sitaudis, 08/05/2017. Lien.
QUINTANE, Nathalie. Préface à TARKOS, Christophe. Le petit bidon et autres textes, Paris : P.O.L, 2019, p. 9-19.
Entretiens
TARKOS, Christophe. VERDIER, Bertrand. Entretien [1996], TTC, n°3 : « Tarkos et compagnie », 1997, reproduit dans Écrits poétiques, p. 353‑360.TARKOS, Christophe. DE GEYTER, Gudrun. Entretien [1997], Rotterdam International Poetry Festival, reproduit dans L’enregistré, p. 237‑249.
TARKOS, Chistophe. CHRISTOFFEL, David. Entretien [1998], partiellement retranscrit dans Écrits poétiques, p. 361‑389 ; fichiers audio de l’entretien complet fournis par D. Christoffel.
TARKOS, Christophe. CASANOVA, Pascale. Entretien, « Les jeudis littéraires », France Culture, 08/07/1999, reproduit sur le DVD de L’enregistré.
QUINTANE, Nathalie. FARAH, Alain. « Trois questions pour Nathalie Quintane », entretien réalisé le 2 février 2008, reproduit dans FARAH, Alain. « La Possibilité du choc : invention littéraire et résistance politique dans les œuvres d’Olivier Cadiot et de Nathalie Quintane ». Thèse de doctorat, Lyon/Montréal, ENS de Lyon / UQAM, 2009, p. 290‑300.
QUINTANE, Nathalie. PRADOC, Roland. « Les eurêkas littéraires de Nathalie Quintane », Chronic’art, 25/05/2009. Lien.
QUINTANE, Nathalie. FARAH, Alain. « Poudre de succession, pensée de la bombe ou désamorçage des avant-gardes », dans GORRILLOT, Bénédicte (dir.). LESCART, Alain (dir.). L’Illisibilité en questions, Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, « Littératures », 2014, p. 177-182.
QUINTANE, Nathalie. PRIGENT, Christian. « D’une génération l’autre (1) », dans GORRILLOT, Bénédicte (dir.). LESCART, Alain (dir.). L’Illisibilité en questions, Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, « Littératures », 2014, p. 183-191.
QUINTANE, Nathalie. GLEIZE, Jean-Marie. « D’une génération l’autre (2) », dans GORRILLOT, Bénédicte (dir.). LESCART, Alain (dir.). L’Illisibilité en questions, Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, « Littératures », 2014, p. 193-198.
QUINTANE, Nathalie. « Il n’y a pas qu’une seule manière de vivre », entretien avec ventscontraires.net, 23/11/2014. Lien.
QUINTANE, Nathalie. AUCLERC, Benoît. « À inventer, j’espère », entretien avec AUCLERC, Benoît (dir.). Nathalie Quintane, Paris : Classiques Garnier, « Écrivains francophones d’aujourd’hui », 2015.
QUINTANE, Nathalie. BORTZMEYER, Gabriel. « Comment planter des tomates avec une caméra », Débordements, 01/02/2016. Lien.
QUINTANE, Nathalie. TRUONG, Nicolas. « Une partie de l’extrême gauche lit davantage de littérature », Le Monde, 14/03/2018. Lien.
QUINTANE, Nathalie. RICHEUX, Marie. « Nathalie Quintane : “Trahissons la littérature pour qu’enfin elle vive” », Par les temps qui courent, France Culture, diff. 29/03/2018. Lien.
QUINTANE, Nathalie. FRANZONI, Andrea. « Intatti fantasmi chiedono il realismo : Jack Spicer », Nazione Indiana, 04/07/2018. Lien. Version française remise par A. Franzoni.
QUINTANE, Nathalie. JAWAD, Emmanuèle. « Les grands entretiens de Diacritik (5) : Nathalie Quintane (Un œil en moins) », Diacritik, 25/07/2018 . Lien.
QUINTANE, Nathalie. LORIS, Marius. WAJEMAN, Lise. « Boussole. Entretien avec Nathalie Quintane », Écrire l’histoire, n°18, 2018, 187‑194.
Interventions, conférences, rencontres
QUINTANE, Nathalie. « oubli ET littérature », DDC / Jean-Pierre Criqui, Centre Pompidou Paris, 26/02/2014. Lien.QUINTANE, Nathalie. « Rencontre-lecture avec Nathalie Quintane », séminaire Benoît Auclerc, Université Lyon 3, 21/02/2017. Lien.
QUINTANE, Nathalie. « Rencontre avec Jacques Rancière et Nathalie Quintane au TNBA ». Lien.
QUINTANE, Nathalie. Conférence à l’École Supérieure d’Art Pays Basque (ESAPB), 12/02/2019. Lien.
Sources (ordre alphabétique)
Articles, recensions, monographies, mémoires et thèses sur les auteurs du corpus principal
AUCLERC, Benoît (dir.). Nathalie Quintane, Paris : Classiques Garnier, « Écrivains francophones d’aujourd’hui », 2015.AUCLERC, Benoît. « Lecture, réception et déstabilisation générique chez Francis Ponge et Nathalie Sarraute (1919‑1958) ». Thèse sous la direction de Jean-Yves Debreuille, soutenue à l’Université Lumières Lyon 2 en 2006.
BERTRAND, Jean-Pierre. CLAISSE, Frédéric. HUPPE, Justine. « Opus et modus operandi : agirs spécifiques et pouvoirs impropres de la littérature contemporaine (vue par elle-même) », COnTEXTES [En ligne], n°22, 2019. Lien DOI.
BOISNARD, Philippe. « D’un mot-au-mot poétique ». Lien.
BOISNARD, Philippe. « Poésie de face sans fond : quelle fut la prétention de la poésie faciale ? ». Lien.
BOURASSA, Lucie. « “Il n’y a pas de mots” et “Ma langue est pleine de mots” : continu et articulations dans la théorie du langage de Christophe Tarkos. », Études françaises, vol. 49, num. 3, 2013, p. 143‑166. Lien DOI.
BOUQUET, Stéphane. « Le pirate du litanique. C. Tarkos écrit des poèmes flux pour dire la violence du monde, et que la guerre vient de finir, "il y a quelques jours" », Libération, 01/06/2000. Lien.
CAILLÉ, Anne-Renée. « Théorie du langage et esthétique totalisante dans l’œuvre poétique de Christophe Tarkos ». Thèse sous la direction de L. Bourassa & A. Farah, soutenue à l’Université de Montréal (Faculté des arts et des sciences) en 2014.
CAILLÉ, Anne-Renée. « Faire entendre » (compte rendu de Christophe Tarkos, L’enregistré), dans Liberté, n°308, Montréal, 2015, p. 58‑59.
CASTELLIN, Philippe. « Christophe Tarkos. “Poète de la lecture” », introduction Christophe Tarkos, L’enregistré, éd. Ph. Castellin, Paris : P.O.L, 2014, p. 13‑93.
CASTELLIN, Philippe. « Tout-se-tient », entretien avec Jérôme Mauche, Cahier critique de poésie, « Dossier Christophe Tarkos », Marseille : Centre international de poésie Marseille, 2015, p. 5-12.
CHARRON, Philippe. « Du "métier d’ignorance" aux savoir-faire langagiers. L’environnement de la littéralité chez Emmanuel Hocquard, Pierre Alferi et Jérôme Mauche ». Thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal, 2014. Lien.
CHRISTOFFEL, David. MOLNÁR, Katalin. Il est important de penser, 2009 (01h01). Lien.
EGO, Renaud. « D’un langage perpétuel », La pensée de midi, 2001/2, n°5‑6, Arles : Actes Sud, 2001, p. 206‑222.
EGO, Renaud. « Poésie-infinie-réalité. La poésie de Christophe Tarkos », La pensée de midi, vol. 28, n°2, Arles : Actes Sud, 2009, p. 185‑190.
FARAH, Alain. « La Possibilité du choc : invention littéraire et résistance politique dans les œuvres d’Olivier Cadiot et de Nathalie Quintane ». Thèse de doctorat, Lyon/Montréal, ENS Lyon / UQAM, 2009.
FARAH, Alain. Le gala des incomparables. Invention et résistance chez Olivier Cadiot et Nathalie Quintane, Paris : Garnier, 2013 (adaptation de la thèse ci-dessus).
FARAH, Alain. « Situation de l’écrivain en 1997 : Christophe Tarkos, commentateur de son émergence », @nalyses, Vol. 5, n°3, aut. 2010. Lien DOI.
GIRARD, Xavier. « Christophe Tarkos : Les écrits poétiques », Journal Sous-Officiel, n°39, ventôse 2009. Lien.
HANNA, Christophe. Nos dispositifs poétiques, Paris : Questions théoriques, « Forbidden beach », 2010.
GORRILLOT, Bénédicte. THUMEREL, Fabrice. Christian Prigent : trou(v)er sa langue, Paris : Hermann, 2017.
HAMEL (Jean-François). « De Mai à Tarnac. Montage et mémoire dans les écritures politiques de Jean-Marie Gleize et Nathalie Quintane », dans Le Roman français contemporain face à l’Histoire. Thèmes et formes, sous la direction de Gianfranco Rubino & Dominique Viart, Macerata, Quodlibet Studio, « Ultracontemporanea », 2014.
HUPPE, Justine. « L’insurrection qui vient par la forme », COnTEXTES [En ligne], n°22, 2019. Lien DOI.
LAVERDURE, Bertrand. « La pensée liquide / Christophe Tarkos, Anachronisme, P.O.L, 223 p. », Spirale, n°183, mars-avril 2002, p. 9. Lien URI.
LEQUETTE, Samuel. « Ecrits poétiques de Christophe Tarkos », Sitaudis. Lien.
LYNCH, Eric. « Nathalie Quintane : « Nous », le peuple », Marges [En ligne], n°21, 2015. Lien DOI.
MAGNO, Luigi. « Seuils prosaïques (notes sur quelques faits de poésie) », Revue italienne d’études françaises [En ligne], n°5, 2015. Lien DOI.
MALUFE, Annita Costa. « The Poetics of Christophe Tarkos : the Word-Paste », Bakhtiniana, Rev. Estud. Discurso, vol. 10, n°1, p. 137‑155, São Paulo, avril 2015. Lien DOI.
MAUCHE, Jérôme (coord.). Cahier critique de poésie, « Dossier Christophe Tarkos », Marseille : Centre international de poésie, 2015.
PINSON, Jean-Claude. « Où va la poésie ? », Critique, vol. 846, n°11, 2017.
PROULX, Gabriel. « Fluidité générique dans Tomates de Nathalie Quintane : poésie, roman, essai littéraire. », Études littéraires, vol. 46, num. 3, aut. 2015, p. 157–168. Lien DOI.
THOLOMÉ, Vincent (dir.). « Tarkos et compagnie », TTC, n°3, 1997.
WOURM, Nathalie. Poètes français du 21e siècle : entretiens, Leiden ; Boston : Brill Rodopi, 2017.
Poésie/poétique
ALFERI, Pierre. CADIOT, Olivier. « La mécanique lyrique », Revue de littérature générale, n°1, « 95/1 », Paris : P.O.L, 1995.ALFERI, Pierre. Chercher une phrase [1991], Paris : Bourgois, 2007.
ANTIN, David. Accorder, Genève : héros limite, 2012.
ANTIN, David. je n’ai jamais su quelle heure il était [i never knew what time it was], Genève : héros limite, 2008.
BADIOU, Alain. Petit manuel d’inesthétique, Paris : Seuil, 1998.
BADIOU, Alain. Que pense le poème ?, Caen : NOUS, 2016, et l’intervention du même nom à la Maison de la poésie de Paris (Lien).
BARTHES, Roland. Le degré zéro de l’écriture [1953], dans OC, t. 1, éd. É. Marty, Paris : Seuil, 2002 [1993].
BATAILLE, Georges. La littérature et le Mal [1957], Paris : Gallimard, « folio/essais », 2013.
BRIAND, Michel. « Inspiration, enthousiasme et polyphonies : ένθεος et la performance poétique », Noesis, n°4, 2000, p. 97‑154.
BRIAND, Michel. « L’invention de l’“enthousiasme” poétique », Cahiers « Mondes anciens » [En ligne], n°11, 2018. Lien DOI.
COSTE, Florent. Explore. Investigations littéraires, Paris : Questions Théoriques, « Forbidden Beach », 2017.
DUCASSE, Isidore (dit Comte de Lautréamont). Œuvres complètes, éd. H. Juin, Paris : Gallimard, « Poésie », 1973.
GLEIZE, Jean-Marie. « Où vont les chiens ? », Littérature, « De la poésie aujourd’hui », Paris : Larousse, n°110, 1998, p. 70‑80.
GLEIZE, Jean-Marie, Les chiens noirs de la prose, Paris : Seuil, « Fiction & Cie », 1999.
GLEIZE, Jean-Marie. Littéralité, Paris : Questions théoriques, 2015.
GLEIZE, Jean-Marie. Sorties, Paris : Questions théoriques, 2014.
HANNA, Christophe. Nos dispositifs poétiques, Paris : Questions théoriques, 2010.
HOCQUARD, Emmanuel. ma haie, Paris : P.O.L, 2001.
KRISTEVA, Julia. La révolution dans le langage poétique, Paris : Seuil, 1974.
MESCHONNIC, Henri. Célébration de la poésie, Lagrasse : Verdier, 2001.
NOVALIS. Œuvres complètes, trad. A. Guerne, Paris : Gallimard, 1975.
PINSON, Jean-Claude. Habiter en poète, Seyssel : Champ Vallon, 2001.
PINSON, Jean-Claude. Poéthique. Une autothéorie, Seyssel : Champ Vallon, 2013.
PONGE, Francis. Œuvres complètes, t. 1 (1999) & 2 (2002), dir. Bernard Beugnot, Paris : Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade ».
PRIGENT, Christian. Ceux qui merdRent, Paris : P.O.L, 1991.
PRIGENT, Christian. La langue et ses monstres, Paris : P.O.L, 1989.
PRIGENT, Christian. Retour à Bataille, entretien avec Sylvain Santi, Paris : P.O.L, 2010.
PRIGENT, Christian. Salut les anciens / Salut les modernes, Paris : P.O.L, 2000.
PRIGENT, Christian. Une erreur de la nature, Paris : POL, 1996.
ROUBAUD, Jacques. Poétique. Remarques – Poésie, mémoire, nombre, temps, rythme, contrainte, forme, etc., Paris : Seuil, 2016.
SPICER, Jack. C’est mon vocabulaire qui m’a fait ça, trad. É. Suchère, Bordeaux : Le bleu du ciel, 2006.
SPICER, Jack. GIZZI, Peter (éd.). The House That Jack Built : the Collected Lectures of Jack Spicer, Middletown : Wesleyan University Press, 1998.
SPICER, Jack. Trois leçons de poétique, trad. B. Rival, Courbevoie : Théâtre typographique, 2013 (version française du précédent).
STRACK, Friedrich. EICHELDINGER, Martina (éd.). Fragmente der Frühromantik, Berlin/Boston : De Gruyter, 2011.
VALÉRY, Paul. HYTIER, Jean (éd.). Œuvres, t. 1,Paris : Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1957.
Inspirations épistémologiques & outils méthodologiques
ALTHUSSER, Louis. « Du “Capital” à la philosophie de Marx », dans Lire le Capital [1965], vol. 1, Paris : Maspero, 1973.CASSIN, Barbara (dir.). Vocabulaire européen des philosophies, Paris : Seuil / Le Robert, 2004.
CERTEAU (de), Michel. L’invention du quotidien [1980], t. 1, « Arts de faire », Paris : Gallimard, « Folio essais », 1990.
DETIENNE, Marcel. Les Maîtres de Vérité dans la Grèce archaïque [1967], Paris : Le livre de poche, 2006.
FOUCAULT, Michel. Leçons sur la volonté de savoir – Cours au Collège de France, 1970‑1971, Paris : Gallimard/Seuil, 2011.
LIBERA (de), Alain. Penser au Moyen Âge, Paris : Seuil, 1991.
VEYNE, Paul. Comment on écrit l’histoire, Paris : Seuil, 1971.
VEYNE, Paul. Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? [1983], Paris : Seuil, 2014.
Critique & philosophie du langage
ADORNO, Theodor Wiesengrund. Jargon der Eigentlichkeit, dans GS, t. 6 : Negative Dialektik. Jargon der Eigentlichkeit, éd. R. Tiedemann, G. Adorno, S. Buck-Morss, K. Schultz, Francfort-sur-le-Main : Suhrkamp Taschenbuch, 1997.AUSTIN, John Langshaw. Quand dire, c’est faire [How to do Things with Words (1955, 1962)], trad. G. Lane, Paris : Seuil, 1970.
BOURDIEU, Pierre. « L’ontologie politique de Martin Heidegger », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 1, « La critique du discours lettré », n°5‑6, nov. 1975, p. 109‑156.
BOURDIEU, Pierre. Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques, Paris : Fayard, 1982.
CASSIN, Barbara. L’effet sophistique, Paris : Gallimard, 1995.
CASSIN, Barbara. Quand dire, c’est vraiment faire, Paris : Fayard, 2018.
GOLDSCHMIDT, Georges-Arthur. Heidegger et la langue allemande, Paris : CNRS éditions, 2016.
KLEIST (von), Heinrich. « De l’élaboration progressive de la pensée par le discours » [« Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden », v. 1805], Petits écrits, dans OC, t. 1, Paris : Gallimard, « Le Promeneur », 1999.
MESCHONNIC, Henri. Le langage Heidegger, Paris : PUF, 1990.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophische Untersuchungen [1953] (fr. : Recherches ou Investigations philosophiques), Francfort-sur-le-Main : Suhrkamp Verlag, 1971.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus [1921], Francfort-sur-le-Main : Suhrkamp Verlag, 1969.
Philosophie
ADORNO, Theodor Wiesengrund. HORKHEIMER, Max. La dialectique de la raison [Dialektik der Aufklärung, 1944], Paris : Gallimard, « Tel », trad. É. Kaufholz, 1974.AGAMBEN, Giorgio. Le feu et le récit [Il fuoco e il racconto, 2014], trad. M. Rueff, Paris : Payot & Rivages, 2015.
ARISTOTE. Sauf indication contraire : PELLEGRIN, Pierre (dir.). Œuvres complètes, Paris : Flammarion, 2014. Pour le texte grec, nous nous sommes référé au site de la Tufts University (lien).
CUES (de), Nicolas. De la docte ignorance. [De Docta Ignorantia (1440)], Paris : Payot & Rivages, 2011.
ECKHART (von Hochheim, dit Maître). Sermons-traités, trad. P. Petit, Paris : Gallimard, 1987.
HEIDEGGER, Martin. Gesamtausgabe, Francfort-sur-le-Main : V. Klostermann, 1975‑2019 (publication toujours en cours).
LIBERA (de), Alain. La querelle des universaux : de Platon à la fin du Moyen Âge, Paris : Seuil, « Des travaux », 1996.
LYOTARD, Jean-François. La condition postmoderne, Paris : Minuit, 1979.
LYOTARD, Jean-François. Le différend, Paris : Minuit, 1984.
MARX, Karl. Manuscrits de 44, trad. J.-P. Gougeon, éd. J. Salem, Paris : Flammarion, « GF », 1996.
PLATON. Sauf indication contraire : BRISSON, Luc (dir.). Œuvres complètes [2008] Paris : Flammarion, 2011. Pour le texte grec, nous avons consulté en parallèle l’édition de John Burnet Platonis opera, Oxford : Clarendon, « Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis », 1900.